Introduction au droit et aux sciences politiques M.. le 13-01-05
1) Les facteurs d'émergence de cette science
ü Quelles sont les possibilités d'investigation
ü Espaces de développement
ü Exigences intellectuelles
2) Le territoire de la science politique
ü acteurs,
ü processus,
ü perspective.
Introduction :
La science politique est la dernière venue des sciences sociales. La science politique se constitue autour de trois repères
Sujet→objet→discipline scientifique que si sont présent ces 3 étapes.
Cela explique le grand débat des années 70-80 quand le travail social essaie d’émerger en tant que discipline. Hors le travail social est une pratique professionnelle qui utilise seulement les méthodes. Aujourd’hui, on essaie de transformer le travail social en intervention sociale. (La médecine n’est pas une discipline mais un art qui utilise plusieurs disciplines).
Ces trois repères permettent la création d'une discipline.
La politique n’est pas née uniquement au siècle dernier :
1) Une œuvre majeure : "Le prince" de Machiavel" [1] (1513)
2) Montesquieu avec "L'Esprit des Lois" 1749 [-Démarche systématisant l'observation] Montesquieu observe les formes de divers gouvernements et essaie d’élaborer des lois. Il tente d'expliquer leurs caractéristiques par la différence de climat. c'est peu le résultat qui nous importe mais la démarche qui systématise l’observation.
3) L'ouvrage de Montesquieu annonce l'œuvre de Tocqueville, qui étudie la démocratie en Amérique (Tocqueville se voulait un moraliste. Il étudia la démocratie en Amérique, comprenant à la fois que l'avènement de ce régime politique est inéluctable mais que, en même temps, il ne nous met pas à l'abri du despotisme. Il cherche à réfléchir d'une façon quasi sociologique sur l'égalisation des conditions, retenant l'idée qu'il ne s'agit plus de choisir entre démocratie et aristocratie mais de choisir entre une démocratie désordonnée et même despotique et une démocratie ordonnée et morale.) Sa préoccupation : pourquoi les Etats sont ils si différents, qu'ils donnent des formes de gouvernements de nature si dissemblable, voire opposées, alors que ces Etats sont parfois si proches géographiquement et historiquement ?
4) Marx va introduire une rupture profonde dans la politique, avec l'apport du concept des modes de productions. Ce qui reste de Marx[2], c'est sa philosophie et l'historien (Capital tome 1). Althusser[3] montre que l'élément essentiel de la pensée marxiste n'est pas remise en cause par l'utilisation qui en a été faite (Régime de Pol Pot [4]) et il propose une grille de lecture de certains écrits de Marx.
Gramsci[5] , qui lutte contre le fascisme de Mussolini [qui tente de penser] bouscule les arguments d’autorité en posant : "Qu'est-ce que dirait Marx aujourd'hui ?"
Les pièges du marxisme ont été d’une part, l’internationale ouvrière qui figea la pensée et, d’autre part, l’émergence de modèles en des lieux auxquels Marx n’aurait jamais pensé. Selon lui, un pays ne possédant pas de classes ouvrières ne pouvait opérer de révolution marxiste. Alors qu’en réalité, les révolutions d’inspiration marxiste se sont développées en pays à domination rurale (révolution soviétique).
Au début du 20 ème siècle naissent les (premiers véritables classiques) grands auteurs des sciences politiques :
Pareto[6] écrit le traité de sociologie générale;
Weber pose des questionnements extrêmement divers :
-étude sur les modes de légitimation du pouvoir ;
- la bureaucratie ;
-étude sur les variables culturelles et sociétales : "l'éthique protestante et capitaliste" ;
- des problèmes épistémologiques : "le savant et le politique".
Roberto Michels a écrit sur les partis politiques.
André Siegfried [7] se fit connaître a travers ses travaux de recherche qui lui valurent la célébrité, au premier rang desquels son magistral Tableau de la France de l’Ouest, publié dès avant la guerre, qui renouvelait profondément la science politique française.
Tous ces auteurs et ouvrages vont donner naissance à la science politique.
A la fin du 19ème siècle, l'opinion dominante est que la science politique est au carrefour des autres sciences humaines (histoire, psychologie, ethnologie, économie, etc…). D’où, l’expression de sciences politiques au pluriel.
En 1948, l'UNESCO propose une nomenclature pour cerner la science politique.
Sociologie politique ( pas encore)
1. la théorie politique : elle récuse les jugements de valeurs et formule des hypothèses sur les faits et leur système d’explication. On y classe aussi l'histoire des idées politiques
2. les institutions politiques, étude monographique du gouvernement central et gouvernements locaux, l'administration publique, l'observation des différentes fonctions que ces institutions assument
3. Les groupes et l'opinion publique : les groupes de pressions, les élections, la propagande
|
Les relations internationales |
|
4. les relations internationales (la politique étrangère, les organisations intergouvernementales – ONU- la coopération entre états, la défense, les conflits, les zones d'influences |
2 et 3 sont regroupés sous l’étiquette de sociologie politique. On sort l’administration publique qui est devenue la science administrative. Ce qui nous donne comme nouveau classement :
1. la théorie politique
2. la sociologie politique
3. la science administrative
4. les relations internationales
Problème : il y a surcharge de sens du mot politique. Il faut opérer une distinction de genre. Est-ce LE ou LA politique ?
Le politique désigne un champ social de contradictions et d'intérêts (réels ou imaginaires, matériel ou symbolique), mais aussi de convergences et d’agrégations partielles régulés par un pouvoir disposant du monopole de la coercition légitime.
La politique, c'est la scène où s'affrontent les individus ou groupes qui sont en compétition pour conquérir le pouvoir d'État [ou] et ses démembrements (le pouvoir dans une commune, un élément plus éloigné comme un cabinet ministériel…)) ou pour l'influencer directement. Dans la politique, nous y classons les partis politiques ; les Lobbyings (groupe qui défend des intérêts qu’il estime légitime) ; les mouvements sociaux…
La vie politique est caractérisée par un débat permanent (réactivé par les échéances électorales) qui se nourrit des problèmes issus de la société globale, mais ces problèmes sont codés en fonctions de ses exigences propres.
Les objets de la science politique : ce sont les modes de productions d'injonctions socialement légitimes
Intérêt pour les dispositifs (institutions, la vie politique) et ce qui les alimentent (conflits, contradiction, convergences d'intérêts parfois) et à ce qu'ils produisent< (lois, réglementations politiques et publiques, messages et symboles)
Intérêt pour tout ce qui est rétroactif (processus et acteurs) sur les acteurs et les processus.
Dans la société, il existe 3 grandes catégories de mode de reproductions qui fonctionnent en interférence.
1. Les biens matériels et services
Les échanges sont définis par la production et la commercialisation. Ils ont une structure organisationnelle de type entreprise et c'est l'objet de la science économique.
2. Les modes de productions d'objets culturels et symboliques
Ils sont indispensables à la constitution et au fonctionnement des groupes (les œuvres littéraires, artistiques, les langues, croyances, valeurs…). Ils sont élaborés et diffusées par les grandes institutions de socialisation (famille, école, église, travail, médias) Il y a interaction avec le premier mode
3. Le mode de productions des injonctions socialement légitimes
Ce sont des choix politiques qui permettent la résolution de conflits. L'institution, c'est l'état moderne et c'est précisément cela l'objet de la science politique.
|
Science politique
Mode de productions des injonctions socialement légitimes |
|
Science
économique
Mode de productions des biens matériels et services |
|
Sociologie
Mode de productions des objets culturels et symboliques |
|
Monnaie Pouvoir
|
|
Pouvoir Rôles
|
|
Rôles Monnaie
|
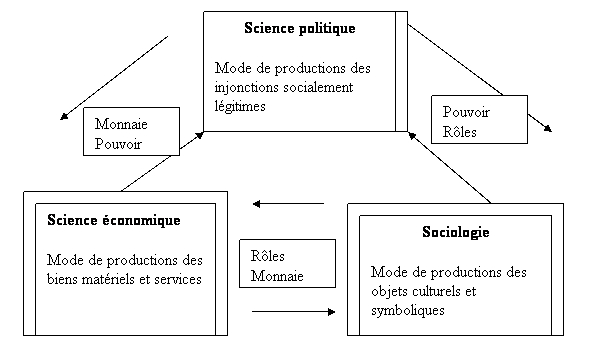
Les modes sont des systèmes en interaction réciproques constants et généralisés.
Les modes de productions économiques et politiques échangent entre eux de la monnaie et du pouvoir.
Les modes de productions culturels et symboliques échangent des pouvoirs et des rôles (symboles, grandes figures historiques)
Les modes de productions économiques et culturels échangent entre eux de la monnaie et des rôles.
L'école reproduit les rapports sociaux. Elle adapte les futurs producteurs aux modèles de productions qui préparent les producteurs et les consommateurs. L'entreprise reste le principal lieu de socialisation.
L'objet de la science politique c'est l"étude du champs politique sans pour autant empiéter sur les sciences humaines.
![]()
[1] Machiavel, en ital. Niccolo Machiavelli, homme politique, écrivain et philosophe italien (Florence 1469 - id. 1527). Secrétaire de la République de Florence, il remplit de nombreuses missions diplomatiques (en Italie, en France et en Allemagne) et réorganisa l'armée. Le renversement de la république par les Médicis (1513) l'éloigna du pouvoir. Il mit à profit cette retraite forcée pour écrire la majeure partie de son œuvre d'historien et d'écrivain : le Prince (1513, publié en 1532), Discours sur la première décade de Tite-Live (1513-1519), Discours sur l'art de la guerre (1519-1521), l'Histoire de Florence (1525), les comédies la Mandragore (1520) et la Clizia (1525). L'œuvre théorique de Machiavel constitue un retournement de la philosophie politique héritée des Grecs. Machiavel ne se préoccupe pas de concevoir le meilleur régime possible : démasquant les prétentions de la religion en matière politique, il part des réalités contemporaines pour définir un « ordre nouveau » (moral, libre et laïque) où la raison d'État a pour objectif ultime l'amélioration de l'homme et de la société.
[2] Marx (Karl), philosophe, économiste et théoricien du socialisme allemand (Trèves 1818 - Londres 1883). S'inspirant de la dialectique de Hegel, tout en critiquant sa philosophie de l'histoire, il découvre la critique de la religion chez Feuerbach, le socialisme chez Saint-Simon et l'économie chez Adam Smith. Il élabore ainsi progressivement le « matérialisme historique », c'est-à-dire la théorie scientifique de toute science sociale (Thèses sur Feuerbach, 1845 ; l'Idéologie allemande, 1846 ; Misère de la philosophie, 1847). Entré en contact avec les milieux ouvriers, il rédige avec F. Engels le Manifeste du parti communiste (1848). Expulsé d'Allemagne, puis de France, il se réfugie en Grande-Bretagne, où il rédige les Luttes de classes en France (1850), Fondements de la critique de l'économie politique (écrit en 1858 ; édité en 1939-1941) et jette les bases de son grand ouvrage, le Capital . En 1864, il est l'un des principaux dirigeants de la Ire Internationale et lui donne son objectif : l'abolition du capitalisme. Pour Marx, l'histoire humaine repose sur la lutte des classes : le prolétariat, s'il veut faire disparaître l'exploitation dont il est victime, doit s'organiser à l'échelle internationale, s'emparer du pouvoir et, au cours de cette phase (dictature du prolétariat), abolir les classes elles-mêmes, ce qui amènera la phase ultérieure, où l'État s'éteindra de lui-même (le communisme). La doctrine de Marx a été baptisée contre son gré le marxisme .
[3] Althusser (Louis), philosophe français (Birmandreis, Algérie, 1918 - La Verrière 1990). Il a renouvelé l'étude du marxisme ( Lire « le Capital », 1965).
[4] Pol Pot (Saloth Sor ou Sar, dit), homme politique cambodgien (prov. de Kompong Thom 1928). Secrétaire général du parti communiste khmer (1962), Premier ministre (1976-1979), il est le principal responsable des atrocités commises par les Khmers rouges.
[5] Gramsci (Antonio), philosophe et homme politique italien (Ales, Sardaigne, 1891 - Rome 1937). Avec Togliatti, il créa le journal L'Ordine nuovo (1919). Secrétaire du parti communiste italien (1924), il fut arrêté en 1926 et mourut quelques jours après sa libération. Dans ses Cahiers de prison, rédigés entre 1929 et 1935, il a substitué au concept de « dictature du prolétariat » celui d'« hégémonie du prolétariat », qui met l'accent sur la direction intellectuelle et morale plus que sur la domination d'État.
[6] Pareto (Vilfredo), sociologue et économiste italien (Paris 1848 - Céligny, Suisse, 1923). Successeur de Walras à Lausanne, il fonda l'économie sur les méthodes mathématiques et approfondit le concept d'optimum économique.
[7] Siegfried (André), géographe et sociologue français (Le Havre 1875 - Paris 1959). Il fut le promoteur de la sociologie électorale. (Acad. fr.)