


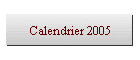


LA NOTION DE BESOIN EN QUESTION ?
Le 16/03/06 - Notes de cours prises par Stéphane
Le concept de besoin – Pourquoi ?
Le concept de besoin est une définition centrale de l'action sociale, au cœur de nos cultures professionnelles. C'est aussi une référence centrale de la politique de ville qui fait la fortune des consultants via les enquêtes de besoins, enquêtes de participation, etc…
1. Besoin et économie politique
2. Petite phénoménologie du besoin
3. Du besoin à la demande
4. Besoin et société de masse
Préalable :
Ce cours fait la jonction avec le séminaire sur l'exclusion, notamment des séances concernant la problématique autour la tension intégration/exclusion. C'est corrélatif des logiques égalitaires et la montée des états de droit.
Introduction :
Nos sociétés européennes traditionnelles ont appris à s'accommoder des statuts d'extériorité, d'étrangeté, de retranchements. Jusqu'à la révolution française, la révolution des droits de l'homme, les parias, les fous, les déviants, etc… disposaient d'un cadre symbolique qui leur donnait une place dans l'ordre social et le paysage collectif qu'il ne faut pas confondre avec l'intégration. Ils étaient tolérés parce qu'ils étaient radicalement autres, étranger à l'humain dans l'ordre interhumain. Cet ordre naturel voulu par Dieu où la différence, l'altérité, l'inégalité constituait la matière même du rapport social. La révolution de l'identité, du regard et de l'appartenance qui produit avec le 18éme siècle à la fois le projet démocratique, la naissance de l'asile moderne avec le traitement moderne de la folie et la problématique actuelle de l'inadaptation. Tout ceci s'articule autour de la question du sujet démocratique de droit, du conflit entre l'inégalité de droit et l'inégalité de fait. Si les hommes naissent égaux en droit, (personne n'a jamais dit qu'ils naissaient égaux de fait), on ne peut que postuler une identité essentielle des hommes entre eux qui est d'abord égalité de droit qui s'oppose à l'inégalité de fait, qui exclut certains de la jouissance ou de la pratique ordinaire de la socialisation. (Inégalité de fait).
Le conflit central, récurent et irréductible entre l'égalité de droit et l'inégalité de fait va ordonner les mentalités du 18 et 19 ème siècle. Ces mentalités vont être polarisées par la double logique des logiques égalitaires et individualistes. Si moi c'est potentiellement l'autre, si l'autre c'est virtuellement le même, alors toute différence et altérité proche qui est transformée en égalité/identité de principe, devient insoutenable parce que trop menaçante.
A partir de la révolution française, il existe désormais une instance dans la société au regard duquel tous sont virtuellement égaux en droit en tant que sujet politique. De là, l'idée de l'égalité de droit qui est contenue implicitement dans le fait même de la nouvelle constitution de la société.
Citation d'un ouvrage Gaucher . M - Pratique de l'esprit humain
"Aux systèmes de dissemblances antérieures, la révolution égalitaire véhiculée par l'Etat moderne substitue un système de l'appartenance réciproque contraignant les êtres à se retrouver substantiellement les uns dans les autres au lieu de simplement devoir reconnaître et admettre l'existence des une et des autres"
Nous sommes tous des sujets rois
Deux principales conséquences de la révolution de l'appartenance :
|
l'invention du rapport moral ou le traitement psychique. C'est la naissance de l'asile moderne, l'invention de la psyché et son traitement qui se pose en cadre inversé du traitement de la folie. | |
|
l'extension et l'accélération du développement économique de la société nouvelle qui polarisé par l'idéal égalitaire. Ce que l'on constate c'est que légalité de principe des sujets politiques ne pouvait que migrer au plan des sujets économiques. C'est Hegel in Principe de la philosophie du droit, Gallimard, décrit comment cette situation nouvelle ne pouvait que susciter les revendications égalitaires généralisées. Dans une société d'abondance et de croissance, l'égalité de droit implique, pour Hegel, d'améliorer ses conditions de vie par imitation des conditions de l'autre. Hegel dit en ce sens que le besoin naît finalement du droit d'acquérir ce que l'autre a acquis. Hegel dit "même où originellement l'homme n'éprouve de besoins réel, celui-ci peut virtuellement ou réellement naître comme par contagion ou récurrence du droit de posséder ce que l'autre possède" Caractère polémogène du droit. |
Le concept de besoin n'existe qu'à travers le concept de besoin/désir. Le mimétisme, le droit de profiter ce dont l'autre possède vient de cette révolution des logiques égalitaire et de la migration du sujet politique au sujet économique. Il ne peut fonctionner qu'avec l'essence de la société de consommation et le système des objets.
L'égalitarisme démocratique a donc produit par effet pervers la revendication de droit de ce que l'on a pas primairement besoin. Hegel a beaucoup réfléchit sur le caractère indéfini du besoin, ce que Marx n'a pas compris. Marx a cru en un optimum indépassable et fermé de la satisfaction qu'il a projetée dans l'utopie de la société communiste ou associative.
1. Besoin et économie politique
"La théorie du besoin" selon Julien Freund.
Il constate que le besoin est totalement imminent aux conditions immédiates de la vie, mais par contre constate que la notion de besoin est tout à fait peu étudiée en tant que telle.
Cette une notion extra juridique, c'est à dire qu'elle a un statut d'inclusion et d'exclusion. Elle n'est jamais vraiment définie alors qu'elle est une notion centrale de l'économie politique.
Marx, définit à propos de la marchandise (concept central dans le Capital) que c'est d'abord un objet extérieur qui, par ses propriétés satisfait les besoins humains de n'importe quelle espèce.
G. Pirou, économiste, dit que "l'économie politique à pour objet l'étude de ses faits d'échange par lequel l'individu abandonne à un autre ce qu'il détient pour obtenir en contrepartie ce qu'il désire, processus grâce auquel est établi le pont entre la production des richesses et la satisfaction des besoins"
Les besoins ont-ils à être satisfaits, peuvent ils être satisfaits ?
Guiton Henri dit que "l'économie par la forme de l'activité humaine par lesquels les hommes luttent pour réduire l'inadaptation de la nature à leurs besoins"
Il existe peu d'analyse critique de cette notion, le besoin étant considéré comme tantôt essentiellement matériel ou physiologique, ou comme des combinaisons qui permettent de suppléer aux carences de la nature.
J. Freund constate qu'il y a deux courants chez les économistes qui ont traité de cette notion comme Hegel, Marx, ou encore Henri Lefèvre.
L'école psychologique du marginaliste (1870) a travaillé sur cette notion du besoin. Le marginalisme[1] a pour objet l'étude les comportements résiduels hors rationalité (en relation avec la consommation) qui s'avèrent décisifs dans l'économie générale de la vie.
La théorie de l'utilité marginale, qui est actuellement au cœur des enseignements dispensés des les écoles de commerce, s'oppose à la théorie marxiste (primat à la valeur travail = la valeur des marchandises est déterminée par l'utilité, et par la quantité de travail nécessaire pour la produire). Cela a donné le postulat de la pénibilité au travail et aussi "à chacun ses besoins".
Les marginalistes disent que la valeur dérive de cette utilité, mais donnent une autre définition de l'utilité. Pour eux c'est un processus psychologique d'estimation subjective qui relie l'individu aux choses. L'utilité incorpore la dimension du plaisir, une valeur de satisfaction. C'est une liaison avec la société de masse et industrielle, et la montée de ce phénomène moderne qu'est la production et la diffusion de la consommation.
Dans ce contexte économique, ils développent la relativité de la satisfaction. Ils donnent une définition de l'utilité subjective bouleversant les notions de valeurs : c'est le degré d'importance que le sujet accorde à une quantité donnée d'un bien. Il a donc associée à cette affaire de valeur, une fonction décroissante liée à une nouvelle productivité de masse et industrielle. Plus le bien est abondant moins il a de valeur, mois il est désiré. Cette économie politique a beaucoup été critiquée parce qu'elle s'appuie sur une société individualiste, c'est à dire, qu'elle voit la société comme un ensemble d'individus en concurrence pour des biens en quantité limitée. C'est une vision libérale, américaine de la société.
2. Petite phénoménologie du besoin
La phénoménologie[2] étant l'étude des phénomènes.
· Sur le plan psychophysiologique
Caractéristique fondamentale : le besoin est un état de manque. C'est un étalement ou un manque ressenti par l'individualité physiologique, mais aussi la tendance à le faire disparaître par tous les moyens possibles.
Le besoin est co-extensible à la vie, donc l'homme est un être de besoin que nous ne trouvons pas en nous même. Il n'y a pas d'autosuffisance. Le besoin serait une manifestation de vie, une tension permanente, une dialectique entre l'intérieur et l'extérieur. Le besoin peut avoir une action intermittente (faim, soif, sommeil) ou une action plus continue comme la régulation de la température.
L'ambivalence du besoin : le manque a des effets extrêmement différents selon les individus. Il n'y a pas d'unicité ni de l'insatisfaction, ni des effets du manque et qu'il n'y a pas de règles à en tirer.
Le besoin a aussi le rôle de régulateur dans la survie dans les espèces, c'est l'essence même de la vie. Tout comportement met en jeu une combinatoire de manque et de satisfaction qui fait appel à des éléments de la personnalité, des éléments à développer. Le besoin est matrice d'actions. C'est une critique des conceptions des pays riches qui voient le besoin comme un signe de faiblesse, obstacle à la liberté.
· Sur le plan philosophique
Le besoin ne se réduit jamais à un mécanisme psychophysiologique parce que l'humain est un être de langage, et que le langage permet l'accès à l'état de conscience. Le besoin est toujours lui même valorisé par le désir, c'est à dire, la conscience que nous en prenons. Dans ce contexte, il faut souligner le caractère plastique du besoin. C'est à dire, que le besoin ne peut pas être une donnée fixe ni une donnée invariable, qu'il est toujours matériel à l'origine, parce qu'il se développe dans les circuits de la conscience et de l'inconscience. Il s'accompagne toujours d'une volonté de le satisfaire. Le besoin s'exprime toujours dans un milieu par rapport à des objets avec des rites particuliers. Le besoin ne se réduit jamais à une réponse simple.
Il y a toujours une solidarisation et cette distinction qui est faite entre le besoin primaire et secondaire est idiote. Il y a une relativité dans la satisfaction. Il existe de multiples façons de se satisfaire. La satisfaction du besoin n'est pas uniforme. Le rapport entre besoin et satisfaction n'a strictement rien de mécanique. Il n'y a pas de rapport entre le besoin et la satisfaction.
La tension ou la frustration du manque pousse au progrès technique et technologique.
Plus les cadres régulateurs psychiques, mentaux, sociaux, sont élaborés, (expérience, culture, l'éducation...) plus le besoin primaire peut distancié, assoupli ou sublimé.
On a l'habitude de faire une distinction entre les besoins :
Ø les besoins dits vitaux dits primaires qui en cas de non de satisfaction s'ensuivrait une mort physique.
Ø Les besoins dérivés, dits secondaires dits aussi besoins socioculturels, qui séparerait les besoins matériels de ceux qui sont immatériels, ces derniers étant considérés moins urgents et moins essentiels que les premiers.
Le distinction en tient pas car il impossible d'évaluer le contexte dans lequel les seconds sont aussi urgents que les premiers.
Le besoin est indéfini, extensible et qu'il se déplace. C'est à dire, que pas plus que la manifestation n'est unique, la satisfaction n'est pas définitive. Le besoin renaît sans cesse.
Il faut admettre l'existence d'une indissociable liaison avec la question du désir. C'est à dire, que le besoin serait couplé et n'existerait pas sans connexion avec l'instance du désir (appétit avec conscience de lui-même - Spinozza). Ricoeur poursuit avec une autre citation :" je peux ne pas manger, mais je ne peux pas avoir faim".
C'est la conscience qui choisit l'objet de satisfaction et la façon de le combler ou de ne pas le combler. Le plus souvent on agit que tout a fait indirectement sur le besoin. On agit le plus souvent en aval sur le désir, le désir se caractérisant par la représentation du manque et l'anticipation de la satisfaction. Il ne peut pas y avoir de désir sans anticipation de la satisfaction. Donc le besoin, en amont parce qu'il est valorisation immédiate de mon corps et de ma vie, il est valorisation du monde extérieur et du sujet qui trie, hiérarchise, privilégie, choisit de désirer. Le désir est du coté de la subjectivité alors que le besoin serait plutôt du coté de la nécessité. Le désir c'est un moyen de différenciation du monde, par la représentation. Le désir, c'est l'information du besoin (P.Ricoeur).
La socialisation des besoins : l'Homme construit son mode matériel, culturel et la société non pas par rapport à ces besoins mais par rapport à ces désirs, c'est à dire, qu'il y a une ambivalence besoin/désir et que l'économie toute entière fonctionne sur ce principe parce qu'elle gère spécifiquement la rareté et les moyens de la satisfaction.
Pour appuyer cette thèse sur l'ambivalence/désir Marx écrit à propos du prolétaire non pas par la situation mais par la conscience des classes ; "Est prolétaire celui qui adhère à l'idéologie, aux valeurs et aux représentations prolétariennes, même s'il ne l'est pas par ses origines ou ses convictions économiques" On voit là que même dans une théorie qui est complètement opposée à l'utilité subjective, au marginalisme, etc… La représentation qui fait la conscience du manque en soi, le désir peut le susciter par la représentation.
3. Du besoin à la demande
Le besoin est de l'ordre des nécessités organiques, il est lié au manque radical. La pulsion est une force constante qui vise à supprimer les états de tension, avant toute représentation dans le psychisme. Le passage à l'acte est une mise en œuvre de la pulsion.
Le désir, selon Lacan c'est ce qui oriente tout l'appareil psychique selon une perception binaire : de l'agréable ou du désagréable. Lacan dit en substance que faisant suite au manque essentiel le désir, pour Lacan, tend a colmaté la faille, la castration, la séparation d'avec la mère. L'enfant désire être le désir du désir de la mère. Face à cette béance, le désir se porte sur des substituts de la mère. Lacan ajoute que le désir se produit toujours dans l'au-delà de la demande, c'est à dire, dans le langage. Le désir est par essence impossible à satisfaire, ne cesse de déborder la demande apparente (le défilé de la parole). Le désir se produit aussi dans son en deçà :"d'en deçà de la parole (demande) tout en mimant sa frénésie lui signifie son manque à être radical". C'est à dire, que la parole ne peut jamais rendre compte de la demande, de l'objet ou de la cause du désir. Dans cette dialectique sans fin qui signifie que la parole ne cesse de dérober et de camoufler le désir, et qu'en même temps en étant incapable de le combler le fait toujours renaître déplacé toujours autrement. La demande ne rend compte jamais du désir et que le couple besoin/désir est toujours en train de déborder la demande, qu'il est instable, qu'il se déplace et qu'il jamais satisfait définitivement.
La demande déborde toujours parce que le désir de l'homme c'est que l'autre le désire, et que la demande en tant que relais est toujours un leurre du désir.
Le désir et sa limite symbolisée ne sont pas à la portée de tout le monde et que l'on peut croire à des besoins non satisfaits. Effectivement, c'est tout le travail ou désire qui ne cesse de fonctionner.
4. Besoin et société de manque
Le besoin est une notion fourre-tout que l'on manipule aisément particulièrement dans les enquêtes de besoin. Par contre, le besoin a un rôle moteur et central, et que c'est aussi un mode de technologie particulière, de gestion de production du social. Le couple besoin/désir fonctionne et travaille le social. Il est au cœur du lien social.
Effectivement ce que l'on peut remarquer avec les lois sur la décentralisation de 1981, c'est qu'elles toutes viser de rapprocher les décisions du politique des besoins de la populations. Simultanément on avait un retour au local, au "micro", à la proximité. Outre le risque de clientélisme[3], c'est aussi inventer une nouvelle administration, de nouveaux services sociaux qui devaient avoir en charge l'administration de la proximité autour du mythe des besoins "plus vrais, plus authentiques, plus proches des gens".
Est-ce que le besoin des gens peut-il être à la base d'une politique sociale ?
Bien que la réponse de Bernard Lory lorsqu'il écrit en 1975 "La politique d'Action sociale" est sans équivoque : Tous est construit sur les besoins.", la réponses est plutôt Non.
Ce qu'on l'on appelle le besoin, le besoin/demande, le désir social, échappe par nature à l'ordre politique. Par contre c'est un élément fondateur du lien social qui est issu d'une méconnaissance commune. Ce besoin/désir que l'on voit à l'œuvre dans les grands magasins le samedi, ou les gens s'agrègent, désirent être ensemble. Cela crée du lien social qu'on pas l'habitude de reconnaître.
C'est une forme de médiation flexible et multiple qui crée des liaisons sociales. Cela crée la représentation illusoire et tout a fait fallacieuse d'un consensus, d'une paix civile, d'une unité, d'une forme politique. Ca créé un langage et un but commun se produisant sur l'espace public. En ce sens, ce couple besoin/désir en créant du lien et créé un imaginaire collectif (le plaisir d'être ensemble à certains moments). C'est un moteur qui aménage des liaisons fluides, qui régule, qui produit en même temps de l'unité dans une société parfois abstraite de réseaux et de transit, de flux, de trafic de masse. C'est un processus clé d'identification. (Lire le bonheur des dames de Zola l'extrait sur le magasin de tissus)
Le besoin/désir est un processus clé d'identification, un apprentissage des conduites sociales, mimétique pour les jeunes en quête d'identification. C'est un médiateur instable, éphémère, fourre-tout. Cela ne veut pas dire que c'est mauvais parce que cela vient humaniser l'espace machinique des transports en commun par exemple, détermine les conduites de masse, et en particulier celles d'achat. Le besoin/désir agit comme un attracteur de la masse. C'est un espace à la fois imaginaire et imaginé qui vient subvertir la fonction au profit des sociabilités particulière en nombre. On peut considérer le besoin comme une forme d'esprit de nos sociétés contemporaines de masse parce qu'il présente un certain nombre de caractéristiques de différents ordres :
Ø C'est une liaison floue entre le connu et l'inconnu et tout à fait en dehors de l'espace fonctionnaliste tel que nous l'avons construit dans notre modernité,
Ø C'est un principe clé d'intégration (porte d'entrée en société) par la mimétique sociale. Il y a une initiation au code de l'espace public.
Ø C'est une recherche d'appartenance
Ø C'est une initiation au jeu infini de l'offre et de la demande, ce qui permet de déplacer les tensions en déplaçant les objets de désir. Il n'y a pas que de la frustration.
Ø Ce couple besoin/désir qui traverse les foules est aussi la légitimation de toute autorité politique. De tout temps, l'autorité à chercher à s'assurer de la capture du multiple Le politique a toujours eu peur des foules émeutières.
![]()
[1]
marginalisme
nom masculin
Théorie économique selon
laquelle la valeur d'échange d'un produit donné est déterminée par l'utilité
de sa dernière unité disponible. - Petit Larousse -
[2] phénoménologie : Philos. Méthode philosophique qui vise à saisir, par un retour aux données immédiates de la conscience, les structures transcendantes de celle-ci et les essences des êtres. La phénoménologie de Husserl, de Merleau-Ponty. - Petit Larousse -
[3]
clientélisme
nom masculin
Péj. Fait, pour un homme
politique ou un parti, de chercher à élargir sa clientèle par des procédés
plus ou moins démagogiques.
- Petit Larousse
-