


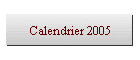


Le 20 avril 2004 – Notes de cours - HENRY Stéphane et Martine GATINEAU
Le 20 avril 2004 – Notes de cours HENRY Stéphane
Rapport aux valeurs : la dimension éthique
La demande éthique
Depuis une 10 ans, la demande éthique apparaît comme un besoin. Les mutations que connaît le monde, bousculent nos certitudes.
1) La bioéthique nous interroge de plus en plus sur la vie (manipulation génétique, le clonage)
2) La question du développement durable : nous ne sommes que locataires de la Terre et il serait préférable de ne pas l'endommager pour les générations futures. En 2050 il y a pénurie de pétrole. Doit on faire le tout nucléaire, ou y a-t-il d'autres solutions
3) La mondialisation n'est pas heureuse, mais elle est un fait. Globalement, notre pays est l'un de ceux qui bénéficient le plus des effets de la mondialisation. Elle est pour les français souvent associée au libéralisme, et elle fait peur. Pour les étrangers au contraire, ils n'ont pas les mêmes craintes par rapport à ce processus. La mondialisation est un fait ; le mouvement alter mondialiste apparaît comme une perspective intéressante puisqu'il travaille en réseau. L'alter mondialisme est un fait reconnu mais on essaie de le modifier.
4) L'apparition de conflit régionaux : on se demande s'il n'y a pas de fractures à caractère culturel (voir M. Huntington dans son livre écrit après la chute du mur de Berlin, "nous sommes entrés dans une ère de conflits entraînent des fractures religieuses et culturelles et non plus politiques comme traditionnellement. Il évoque le fracture entre le l'islam et le christianisme/bouddhisme.) la ligne pour cet auteur, part du moyen orient jusqu'en Afghanistan. Il est très violement critiqué. L'un des opposant au conflit en Irak était le pape JP II, ce qui contredit la thèse de Huntington. Bush utilise cette pensée (fracture entre le bien et le mal ; l'ex-guerre froide entre l'Est et l'Ouest. Tous ces éléments se recoupent sous l'idéologie des néo-fondamentaux, "born again" plutôt protestant La guerre en Irak, notamment la guerre entre sunnites et chiites vient contredire cette thèse. Les guerres a caractère régional provoque plus de morts que les guerres mondiales.
5) La fin des idéologies : est elle synonyme de la fin de projets collectifs ?
Depuis la seconde guerre mondiale , nous avons besoin d'utopie, d'optimisme, c'est à dire de projets collectifs, projets qui sont eux-mêmes rattachés à des idéologies, des références sur lesquelles nous appuyer.
Les logiques occidentales se pose des questions face aux logiques productivistes. Ce modèle a-t-il de l'avenir ? Nous sommes passés dans une société post-moderne
Le déclin de la sphère politique et publique
· Au niveau local beaucoup de personnes s'engagent mais il y a un désenchantement au niveau national.
Les grandes institutions ne sont plus aussi performantes dans leur fonction d'encadrement de la population. (Églises, syndicats, école, partis politiques) Se pose la question de l'âge de la classe dirigeante politique où pour se faire entendre il faut être âgé.
Les transformations sociales : fragilité de la démocratie et généralisation de l'individualisme. La démocratie n'est pas facile à construire et reste fragile. Elle ne peut perdurer que si l'on l'entretient. Notre démocratie s'est construite sur le siècle des Lumières. Elle s'épuise pour plusieurs raisons : officiellement, notre République est une république universaliste qui considère qu'il ne doit pas y avoir de corps intermédiaires. Tout le travail de la révolution et de la République a été de les supprimer…pour les reconstruire ensuite Les corps intermédiaires (syndicats, écoles…) sont trop limités d'où la question de leur représentation. Dans l'exemple de l'élection présidentielle, on dénombre 25 % de non votants. Sur les 75 % de votants environ 25 % votent sur les extrêmes. Le candidat gagnant sur environ plus ou moins 50 % des suffrages exprimés ne représentent finalement qu'un quart des électeurs. Cela fragilise la démocratie car plus de la moitié de la population estime ne pas être représentée. L'individuation va contre le pacte républicain, le vouloir vivre ensemble. Le bien public collectif a tendance à disparaître. La somme des intérêts particuliers est toujours inférieure à la somme produite par l'intérêt général.
Les plus individualistes vont souhaiter qu'il y ait une reconstruction qui à l'extrême reconnaît l'individualisme et en même temps les dépasse. Il y a des craintes de voir apparaître des tendances communautaristes. Notre modèle français à l'inverse des autres pays comme la Grande Bretagne, est universaliste. Nous toujours pensé que notre modèle était le meilleur. Nous avons véhiculé l'Europe de cette façon, que l'Europe était la France ! Il y a un chevauchement entre la mémoire, le vérité et l'histoire : ce n'est pas en opposant les indigènes à la République que l'on peut construire la vérité et le "vivre ensemble". L'erreur, c'est de ne pas avoir des indigènes des citoyens. Au nom de la civilisation il y a eu beaucoup de dégâts. Il faut revisiter nos fondamentaux. Les conditions qui faisaient le contrat social après la seconde guerre mondiale ne sont plus actuelles aujourd'hui : il manque un projet collectif.
Un certain nombre de personnes ont essayé de chercher dans l'éthique des réponses : (L'éthique des pratiques sociales et déontologie des travailleurs sociaux, rapport 2001)
Qu'est-ce qui va pouvoir asseoir une bonne réponse professionnelle sans être dans l'empathie et dans un traitement codifié de la situation. Peut-il y avoir un terrain commun d'éthique.
Les différents types de conflits éthiques :
L'opposition entre loi et éthique : prise en compte de la demande du sujet en souffrance qui se heurte à la loi. La question qui se pose alors est celle du rapport du professionnel à la loi. Le professionnel à rappeler la loi. Au nom de l'éthique peut on transgresser la légalité ou la contourner ou encore en suspendre l'application.
stratégie d'action et la loi (le rappel de la loi par l'institution entraîne une conflictualité qui obérer toutes possibilités d'actions à moyen ou à long terme.)
conflit intérêt des acteurs. Il est possible que des acteurs sur une question ou une personne ont des avis différents mais pour autant tout a fait légitime. Comment prendre en compte cette contradiction, cet antagonisme.
conflit méthodologique et éthique. Il s'agit d'une démarche émanant d'un usager ou professionnel qui est en contradiction avec le mode d'approche d'une équipe ou d'un système de référence. Jusqu'ou le professionnel peut il s'engager ? sur quoi fonder un arbitrage de ce type de conflit
Ces quatre types de conflits permettent une localisation générale du conflit sans pour autant l'épuiser. On trouve ces conflits… loi et désir d'aide, valeur et technique, appelle une réflexion professionnelle et collective.
Pour aller plus loin il faut faire une analyse conceptuelle en termes de valeur, norme morale déontologie, éthique.
La Valeur au sens philosophique est une recherche d'une certaine perfection, ce devrait être par rapport à ce qui est. Pour P. Ricoeur les valeurs visent la vie bonne. Le sens étymologique du mot valeur a une racine indo-européenne étymologique très ancienne wal qui a signifié force et puissance et qui devient vaillance bravoure, conduite d'excellence au moyen âge. Au 18ème siècle on passe des personnes aux objets possédés. Au 19ème on théorise autour de l'analyse des valeurs marchandes, de l'échange marchand.
Au 19 éme la théorie de la valeur, = tout ce qui peut revêtir une importance, pour qui que ce soit, de quel que point de vue qu'il se place et dans quel contexte qu'il est situé.
Aujourd'hui, la valeur est un principe de jugement qui exprime ce qui importe. De manière constante, l'usage du mot valeur renvoie à un absolu et pourtant renvoie à une norme culturelle. La valeur est subjective et relative car selon le contexte, le temps historique elle varie. L'emploi du mot est fortement dépendant de l'environnement socio-culturel. Il y a une tension permanente entre absolu et relativité des valeurs.
Morale : Ethique et morale sont interchangeables et ont la même la signification sur le plan étymologique en grec et latin. "ethos et mores" sont la traduction de l'un et de l'autre.
La morale est un ensemble de jugements relatifs au bien et au mal destiné à conduire la conduite des hommes. Le propre d'une morale est d'être sciemment bonne. Il y a deux composantes à la morale : la théorie du juste et la théorie du bien. C'est aussi un ensemble de restrictions pour permette une vie en commun.
La morale est un ensemble de valeurs absolue dont l'observance constitue une fin en soi. La morale c'est l'ensemble de nos devoirs. Le jugement moral c'est comparer ce qui est avec ce qui devrait être.
Kant caractérise la morale (ensemble de valeurs absolues et de devoirs) d'impératif catégorique. Pour Comte Sponville et Luc Ferry la morale est un minimum obligé nécessaire mais incapable à lui seul de nous satisfaire. Ils ajoutent que dans nos sociétés occidentales, l'élargissement de la laïcité a eu pour corollaire l'affaiblissement des religions. Cela est arrivé en même temps que la chute les grandes idéologies. Cela ne permet pas de véritable dynamique sociale : il n'y a donc plus de "véhicule" pour porter la morale
La morale est considérée par certains comme trop catégorique renvoyant à des valeurs trop normatives. Pour d'autres elle considérée comme non universelle, s'imposant sans respect à des cultures. La morale peut être discutée en ce sens qu'elle ne peut suffire à nous satisfaire. Le mot est délaissé, car décriée bourgeoise, trop normative. Cela frappe d'obsolescence un certain nombre d'éléments que l'on considérait comme étant moral. Il n'y a pas d'universalité dans la morale. Cela rejoint l"affaiblissement d'un certain nombre d'idéologies et de religions, notamment dans nos sociétés individualistes.
La norme : ethym = instrument d'une mesure géométrique norma = équerre au 19éme siècle la norme c'est le caractère régulier d'un phénomène d'apparition. (voir Quetelet : physique sociale). Il essaie de mesurer la régularité au sens statistique avec laquelle un phénomène revient.
La norme va permettre de discriminer de ce qui se fait de ce qui ne se fait pas. La norme permet de concrétiser la valeur dans l'action. La norme joue un rôle de premier plan dans les groupes (acculturation[1]). Les normes sont cœur du changement social
Le processus de normalisation permet de comprendre pourquoi une société se transforme. Le travail social est particulièrement concerné par ce processus. Dans le travail social, elle est travaillée par ce processus tout en étant vecteur de changement social. La revue "Esprit" définit le travail social comme corps social au travail. L'enjeu fondamental de la réflexion éthique est d'ouvrir une brèche dans la norme qui est un processus qui fonctionne en aveugle. C'est à dire qu'au coeur de nos pratiques professionnelles et institutionnelles, nous sommes en quelque sorte en "pilotage automatique".

L'éthique
La morale sera plutôt du coté social et l'éthique plutôt du coté du sujet. Une éthique répond à la question comment vivre.
Pour Comte et Sponville, l'éthique est toujours particulière à un individu ou à un groupe.
Paul Ricœur défend l'idée " avant la morale des normes, il y avait l'éthique du souhait de vivre bien". Cela ne veut pas dire que l'éthique n'est pas normative, mais ce sont des normes hypothétiques. L'éthique est intérieure alors que la morale s'impose de l'extérieur. L'éthique liée ainsi sujet, elle est nécessairement plurielle dans une société. L'étique tend vers le bonheur alors que la morale tend vers la vertu.
Selon Paul Ricœur qui est dans le droit fil d'Aristote, il existe trois temps de la visée éthique.
1) la relation à soi même : croyance à la liberté qui fait autre chose que de subir des déterminismes naturels et sociaux. "la culture du JE"
2) la relation à l'autre, aux proches, qui inspire le respect et à la reconnaissance de sa liberté "la culture du TU"
3) le relation aux tiers anonymes qui exige la médiation d'institution juste "la culture du IL"
L'éthique c'est un questionnement sur la pratique, qui s'éprouve dans l'acte. Ce n'est pas un prêt à penser : sagesse pratique. La difficulté que nous avons dans une société démocratique ouverte, très individualiste, c'est comment faire vivre ensemble des personnes qui vont partager un minimum de valeurs, et qui peuvent avoir des positions au quotidien extrêmement différentes voire contradictoires.
La déontologie : termes grecs déon (devoir) et logos (science). A la différence de l'éthique qui met en valeur une vision de "l'agir bien" la déontologie donne une conscience des limites. Elle précède l'acte et le sujet. Elle appartient à la règle instituée. C'est la science des devoirs professionnels qui inscrit la personne dans un collectif de référence. C'est un encadrement des actions d'une profession, des pratiques professionnelles. C'est une étude des usages professionnels en vigueur ou le contexte social et la conformité aux valeurs admises par le corps professionnel concerné. La déontologie n'est pas uniquement un code, mais aussi des règles de fonctionnement, une sorte de " jurisprudence". Le code de déontologie à une fonction collective et politique. (cf code de déontologie médical). Le code porte un sens politique en direction des institutions et de la société toute entière.
Il est toujours important de faire une approche sémantique et conceptuelle, de chercher le sens des mots pour en comprendre le sens caché, chercher l'entier du concept avec tel ou tel auteur qui appuiera notre démonstration.
Trois axes qui structure l'éthique
1. La responsabilité
2. La conviction
3. Discussion
Weber en 1919 dans "le savant et le politique" s'interroge sur la responsabilité des pacifistes allemands dans le déclenchement de la seconde guerre mondiale et plus gravement sur la responsabilité des fonctionnaires et des politiques. L'idée défendue par Weber, c'est que contre l'éthique de pure conviction, l'homme politique doit s'imposer une éthique de responsabilité qui admet l'irrationalité éthique du monde et par conséquent reconnaître que la politique est le lieu d'exercice de violence. L'Etat a le monopole de la violence légitime. C'est dans ce monde de violence légitime que l'homme politique doit rendre compte de ces actes. La responsabilité est fondée sur une acceptation du réel tel qu'il est et des moyens dont dispose l'homme politique.
L'éthique de responsabilité est conséquencialiste et découle de la situation. Elle implique le principe de réalité à atteindre.
L'éthique de conviction [2] et l'éthique de responsabilité[3] sont dans une opposition irréductible. Elles se complètent mais il y a un abîme qui les sépare. Et c'est cette conciliation, qui est impossible et nécessaire en même temps ; du bien et du juste, des principes et des conséquences. Cette conciliation reste toujours une tâche inachevée de la conscience : voilà ce qui est juste, mais quelles sont les conséquences ? J'ai des principes mais si je les applique que se passera-t-il ?
Il est plus facile d'être dans une éthique de conviction quand on n'a pas à répondre de responsabilité. Tout comme, n'avoir que de la responsabilité sans conviction peut être dangereux.
Ethique et principe de communication : éthique procédurale d'Habermas
Il faut discuter librement entre les membres d'une communauté respectueuse et désireuse de les faire jouer des mêmes règles, où le discours cherche a atteindre la vérité, jusqu'à aboutir à une délibération collective, un certain consensus. Puisque nous sommes dans une perspective où le discours doit atteindre la vérité, le langage peut jouer dans une certaine réciprocité. Le discours est libre. Il faut préalablement accepter que le discours de l'autre soit entendable. Cela est plus difficile à faire fonctionner dans une société individualiste.
Le travail social doit aussi voir d'autres courants philosophiques, l'universalisme [4] des valeurs et le relativisme [5] (le contraire d'universalisme). C'est parce que je crois qu'il existe un universalisme des valeurs que je peux fonder la Déclaration des Droits de l'Homme. L'ensemble de ces droits va être exprimé à une époque donnée, dans un vocabulaire donné et par des hommes et des femmes d'une époque particulière. Un certain nombre d'Etats dont les caractéristiques et historiques sont différentes tendent à les relativiser, sinon à les contester.
Comment peut on hiérarchiser les droits de l'homme ?
Le relativisme prône la totale relativité des valeurs des sociétés et des individus. Le relativisme prône le principe d'une pluralité de rationalités.
Le communautarisme selon (Taylor, Walzer – penseurs Nord américains) prône une reconnaissance sociale à travers l'affirmation de l'identité culturelle, considérée comme un bien social.. Les normes publiques doivent affiliées très étroitement aux valeurs partagées par la communauté sociale de référence. Tout point de vue est a priori respectable et doit être accueilli de la même façon. Notion de reconnaissance de l'autre.
Plus une société est individualiste plus elle besoin de "communautariat" selon l'expression de Charles Taylor (Québécois)
Ce courant provoque des critiques, notamment en raison de la sectarisation. Une communauté est porteuse de signes d'identification qui font que les autres sont considérés comme des étrangers. Il y a un risque à l'abandon de la bienveillance.
En France, le communautarisme est perçu comme une idée d'exclusion et de rejet. Dans une société se voulant universelle, toute tentative de repli, d'obstacle entre le citoyen et sa représentation universelle apparaît comme un retentissement de l'Ancien Régime, un risque de repli communautaire.
La justice sociale (J. Rawls – la théorie de la justice). Il tente de répondre à la question qu'est que la société juste ? "le voile d'ignorance".
Comment déterminer si une redistribution des revenus est acceptable ou non. Il organise systématiquement norme et valeurs. Son point de départ, c'est qu'une société doit avoir un consensus sur un nombre minimal de valeur. Une société ne pas fonctionner sans un nombre minimal de valeur. Il faut établir un régime de tolérance dont les principes doivent être assez neutres par rapport aux valeurs qui entre dans des visions du monde concurrentes. Rawls est un fervent partisan de la laïcité, notion très critiquée aux Etats-Unis. Il estime que sans laïcité, on ne peut fonctionner. La laïcité permet de son point de vue l'expression
Dans ce cadre là, la référence ultime, c'est la liberté. Il propose un nouveau contrat social entre des personnes libres et rationnelles. Il pose deux principes de base :
1) Egalité des droits et des devoirs de base : chacun doit avoir un droit à la liberté la plus large possible compatible avec celles des autres.
2) La juste égalité des chances. Cette juste égalité des chances doit fonctionner avec un principe de différence qui fait que les inégalités sociales et économiques doivent être organisées.
L'équité est possible si elle permet une plus grande égalité c'est à dire donner plus à ceux qui ont le moins pour réduire les inégalités et l'écart existant. Ce qui est intéressant chez Rawls, c'est qu'il conjugue les problèmes de reconnaissance et d'égalité avec une défense du pluralisme social sous toutes ses formes dans une perspective d'égalité.
La pensée de Rawls ne peut fonctionner que s'il existe un Etat fort et des institutions fortes. Il n'est pas contre les personnes fortunées a condition de pouvoir leur prendre une partie de leur revenu pour le redistribuer.
Histoire des valeurs professionnelles du travail social
La morale professionnelle.
L'assistance sociale de 1900 à la seconde guerre mondiale fondée sur une pratique confessionnelle est issue du catholicisme social ou humanisme laïque. Elle est en rupture avec la charité où traditionnellement il fallait aller au pauvre pour l'amener à être citoyen. Derrière, il y a une volonté de normalisation, de clase tourné vers la recherche d'une paix sociale. On prolonge la métaphysique chrétienne sous une forme sécularisée.
L'éducation spécialisée est apparue pendant la seconde guerre mondiale en développant une autre approche, celle de l'enfance inadaptée et la PJJ avec la doctrine de la neuropsychiatrie.
Le modèle d'après-guerre est basé sur une observation des besoins et la recherche de sens.
Dans les années 70 apparaît le terme de travail social. Un certain nombre de hauts fonctionnaires vont essayer de promouvoir une vision unitaire du travail social
Le modèle de René Lenoir, technico-administratif, va interférer avec les valeurs du travail social et va permettre leur reconnaissance et leur légitimation (les grandes de 1975, création de l'IRTS, développement d'un type d'administration centrale)
L'onde de choc de 1968 et le militantisme des années 1970 qui s'en suivit, dénoncent le contrôle social, la collusion des intervenants sociaux avec l'appareil d'Etat. On va refuser certains modes d'action, comme par exemple la visite à domicile. Il y a une confusion entre l'éthique et l'idéologie.
Les années 1980 connaissent une phase de désenchantement au moment de la réforme de la décentralisation. Apparaît également une nouvelle pauvreté générant de nouvelles réponses en termes d'insertion, de mission de solidarité et de développement social. On renouvelle également les formes méthodologiques : le projet, la démarche contractuelle, le partenariat…
En 1990 on s'interroge sur les valeurs et l'éthique : le suivi social devient l'accompagnement social, on évoque plutôt la relation à la place du projet, l'évaluation est plutôt qualitative.
Le travail social entre dans une logique de mission sur un mode contractuel et partenarial. Est-ce que le travail social est un gestionnaire de l'exclusion ? La question éthique reprend son sens.
Valeurs humanistes : les valeurs attachées au travail social = intérêt pour autrui, foi en l'homme et ses potentialités. Le travail social s'attache à la fois à la personne au sujet et à la personne. Ces valeurs qui sont aussi démocratiques et républicaines (droit, dignité, justice, citoyenneté, cohésion sociale, solidarité) se trouvent au fondement du travail social.
Dans l'article 1 de la loi cadre de 2002, il est rappelé ce qu'est la dignité humaine et que le fait que les usagers sont des citoyens qui ont des droits. Les gens sont pauvres parce que leurs droits sont bafoués.
Dans le préambule du code international de déontologie du service social "Le service social des ???? idéaux humanitaires, religieux et philosophiques s'inspire de la philosophie démocratique. Il s'applique universellement à travailler au bien être des êtres humains, à mettre en valeur les ressources qui dans chaque société sont susceptibles de répondre aux aspirations et aux besoins nationaux et internationaux de l'individu ou du groupe ainsi qu'à promouvoir la justice sociale."
Plus généralement, tous les travailleurs sociaux sont interrogés par la nature de la question sociale. Cela les amène a travailler sur la relation entre la valeur et le droit : appliquer le droit, prendre appui sur lui est plus sur que de s'appuyer sur les valeurs. Le droit étant un ensemble d'ordres et de règles statutaires qui règle les conditions et les rapports sociaux, fonde les libertés et les obligations de chacun. L'un des axes du travail social est bien l'accès aux droits des usagers. Les travailleurs sociaux cherchent à humaniser la société en la rendant plus tolérable même aux plus faibles.
Les valeurs liées à la position des travailleurs sociaux détermine la position professionnelle : connaissance, rigueur, responsabilité, efficacité.
Le lien entre les valeurs et leur adhésion. Les valeurs ne sont intériorisées que si elles sont portées avec une conviction qui cherche à les faire partager.
Comment transformer la valeur de référence en valeur d'usage ? Avec quelles valeur et quelle éthique les travailleurs sociaux vont-ils fonder leurs interventions ?
Chacun d'entre nous participe à un système de valeurs, habitus sur lequel s'est greffé une formation et une activité professionnelle.
Les questions éthiques aujourd'hui correspondent à des changements de société.
L'individualisme
Pour Lipovestky qui a écrit en 1983 "L'ère du vide, essai sur l'individualisme contemporain" pense que l'occident serait passé de l'idéologie de la conquête du monde à une philosophie narcissique privilégiant le bonheur individuel. Cette montée de l'individualisme affecte la question éthique en diminuant les appartenances collectives (religion, syndicalisme, politique porteuses de valeurs collectives) vers le repli, en réduisant les injonctions morales. Chacun de nous doit les construire individuellement. Nous sommes plus libres, mais il faut chaque jour les construire : pour certains c'est un poids, pour d'autres c'est un gain.
Le néolibéralisme et l'Etat social (Erhenberg, Gauchet, Castel)
La société salariale s'affaiblit et est rentrée en crise. La prédominance économique du marché produit des effets sociaux L'action sociale se trouve confrontée à une massification des problèmes sociaux, insatisfaisant pour les usagers et les professionnels. Il convient de penser autrement "agir local et penser global".
Ethique et droit
Le droit a tendance à devenir le seul mode de régulation sociale (judiciarisation). On passe d'un droit démocratique à un droit procédurier. Nous sommes passés des droits des libertés à des droits des mœurs. Perçue comme révisable la loi a de plus en plus tendance à devenir réglementaire. Il existe de plus en plus de lois, de plus en plus contingentes et mal écrites.
Le droit ne remplace pas la responsabilité du sujet. Les conflits de valeurs sont souvent porteurs d'un nouveau droit en gestation. Est-ce que les mœurs (IVG Loi Veil) précédent le droit et inversement (loi sur l'abolition de la peine de mort) ? Il semble nécessaire de déterminer ce qui relève de l'ordre moral et de ce qui relève de l'ordre politique.
Le bouleversement de l'action publique
Avec la décentralisation, les politiques désignent des personnes, attribuent des étiquettes sur des publics cibles (chômeurs, rmistes, toxicomanes, SDF, handicapés) auxquels les citoyens se réfèrent et les usagers s'identifient. La rationalité instrumentale et la logique opérationnelle l'emportent de plus en plus. Les actes du travail social sont de plus en plus cadrés par des mesures administratives et normatives et amènent à :
· Une réduction de l'espace de délibération, de la marge d'autonomie du travail social
· Empilement des dispositifs
Cela amène à des choix de priorité, et c'est donc reconnaître que l'on a plus de choix…
Le discours a tendance à être un discours de gestion, de rationalité, de management : culture bureaucratique d'une société administrée, alors que le travail social s'efforce de comprendre la personne avant de la définir comme problème social.
L'instrumentalisation des associations pose aussi le débat sur la qualification des professionnels :
|
Dérégulation du recrutement des travailleurs sociaux | |
|
Le recrutement par le bas entraîne une déqualification des diplômes | |
|
L'introduction de la VAE est un bon outil, mais il peut être utilisé négativement |
Les mutations du travail social questionnent à la fois les compétences collectives et personnelles.
L'irruption des droits de l'usager, où la figure de l'usager peut apparaître comme "partenaire". L'usager a le droit d'être informé, entendu et peut participer. En réalité, le travail social ne peut être que renforcé par le droit des usagers. Il existe cependant des risques de distinction des usagers entre les bons et les mauvais, qui deviendraient alors des sous usagers "hors normes"
Quelles perspectives dans une éthique engagée ?
L'éthique est toujours sous tendue par un imaginaire social qui privilégie certains idéaux, certaines valeurs et utopies. Il convient au travail social de les distinguer et de les identifier clairement. Les travailleurs sociaux doivent être des acteurs engagés. L'étique va se situer dans la confrontation avec un professionnel engagé dans une action avec une autre personne. Ce qui nous intéresse c'est de savoir ce qu'il est advenu de cette action. L'éthique professionnelle n'est pas seulement relative au caractère plus ou moins juste des interventions ou en fonction des capacités de créativité (on ne peut reproduire à l'identique une décision éthique, ce n'est pas la même personne ni le même cas) et d'expertise, elle est aussi à comprendre du point de vue de l'orientation de la société (société donnée qui a une histoire différente de celle d'une vingtaine d'année)
Une éthique engagée nécessite la critique. C'est un lieu de la réflexion sur le rapport de la société à l'individu et de l'individu sur la société. Cela implique de réagir avec le réel, de choisir une orientation. On peut décider d'agir ou non. On touche notre liberté de choix.
Cela nécessite des repères :
1) codification et écrits de régulation (code de déontologie et charte). Le souci c'est que ces éléments participent au mouvement du contrôle social et introduisent de l'éthique dans la société.
2) Le code ne peut régler les problèmes quotidiens, il ne doit empêcher de penser personnellement. La rigidité d'un code nuirait à la souplesse requise pour le travail social qui nécessite de l'interprétation. Ce qui fait la richesse du travail social.
|
Le code doit rester général. La rigidité nuirait à la souplesse requise par le travail social. | |
|
Le code peut renforcer le corporatisme | |
|
Il pourrait aussi devenir un bouclier |
Les chartes sont des écrits déclaratif qui prennent acte d'un engagement moral d'un groupe ou d'une institution pour réaliser une mission.
La décision étique en situation
Délimiter le problème
Identifier les possibilités de résolution du problème
Evaluer les alternatives
Choisir les interventions les plus efficaces
Mettre la décision en action
La délibération intime :
1) Elle passe par la clarification de ses propres valeurs, ce qui nous pousse à agir
2) Elle passe par la clarification des valeurs de la société car certaines situations peuvent justifier d'aller à l'encontre des valeurs prônées par la société.
3) Elle doit tenir compte de facteurs spécifique :
a. notre position sociale et professionnelle,
b. l'organisation dans laquelle on travaille,
c. le savoir acquis
La décision est une recherche de compromis qui s'appuie sur 4 principes
1) Le respect de l'autonomie du sujet
2) Le fait que l'action ne doit pas nuire
3) La bienfaisance
4) La justice de l'action dans toutes décisions
Néanmoins, dans toute décision, il y a toujours une part d'imparfait que sont les effets pervers.
Les travailleurs sociaux sont confrontés à une dialectique :
|
Des valeurs entre responsabilité et devoir. | |
|
Conflit entre intérêt privé et intérêt collectif | |
|
Demande de l'usager et commande institutionnelle | |
|
Entre aide et institutionnalisation | |
|
Entre secret et transparence | |
|
Entre secret et information partagée | |
|
Entre logique de mission et logique de gestion | |
|
Entre logique économique et logique sociale | |
|
Entre qualité de l'intervention sociale et rationalisation financière |
L'arbitrage doit se faire entre 3 parties
1) Porteur en tant que professionnel de l'institution
2) Intérêt des missions
3) Intérêt des usagers
Chacun des niveaux a sa légitimité :
· L'intérêt collectif prime sur le privé (dès que la protection et la justice sont entravées, en danger)
· L'intérêt du professionnel et la qualité des prestations
· L'intérêt des personnes relève de la liberté
Des choix sont à faire entre des responsabilités, des décisions et des libertés. La décision éthique met en jeu l'éthique personnelle et professionnelle et une vision de la société démocratique. Ces trois visions sont toujours en formation et en construction. Le positionnement du professionnel et éthique ne va pas de soi. Il faut toujours l'appuyer sur une démarche fondée collectivement qu'il faut sans cesse réactiver par des questionnements.
![]()
Bibliographie :
Le travail social en débat (s), dir. J. ION, la découverte, 2005
Rapport annuel de l'IGAS, l'intervention sociale, le travail de proximité, La documentation française, 2006
![]()
Définitions du Petit Larousse
[1]
acculturation
nom féminin
Sociol. Processus par lequel
un groupe entre en contact avec une culture différente de la sienne et
l'assimile totalement ou en partie.
[2] Ethique de conviction : se mettre inconditionnellement au service d'une fin, sans concessions
[3] Ethique de responsabilité : Elle inclut le principe de réalité dans le but à atteindre
[4]
universalisme
nom masculin
Opinion qui ne reconnaît
d'autre autorité que le consentement universel.
[5]
Relativisme
nom masculin
1.
Philos. Doctrine soutenant
la relativité de la connaissance.
2.
Attitude de celui qui pense
que les valeurs sont relatives.