


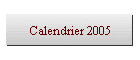


La sociologie des institutions (incomplet) le 23/02/06 Notes de Stéphane
Références :
|
Simmel G : Comment les formes sociales se maintiennent ? sociologie et Epistémologie – Puf 1991 | |
|
E. HUGHES : Le regard sociologique - EHESS 1996 | |
|
H. Becker : Outsiders chap 7 et 8 |
Zone d'incertitude:C'est souvent une faille administrative, c'est souvent quand on ne sait pas comment traiter un phénomène qui peut apparaître "gênant ou dérangeant" sur un plan sociétal, administratif ou législatif, quelqu'un a une initiative pour traiter le problème.
Institutions : Groupe de personne qui s'assemble et qui s'organise en fonction d'un but
Les présupposés des institutions : c'est l'institution qui crée la demande et s'inscrit en contre par rapport à la demande sociale.
La demande sociale n'est pas définie par la population, mais les institutions ont besoin d'une clientèle. Elle se procure la clientèle en détournant un usage de la justice, par exemple : la correction paternelle est un principe juridique venant du droit romain. Le père détient la puissance paternelle et la justice est au service du père de famille, sauf dans le cas de mauvais traitements (exceptionnel).
En 1823, pour trouver la clientèle les assistantes sociales détournaient les demandes de la correction paternelle adressée au juge en indiquant que peut-être les mineurs ne sont pas totalement responsables. Ils donnent ainsi plus de pouvoir au juge qui peut rendre des décisions différentes de la "puissance paternelle" notamment en vérifiant les propos du père par des enquêtes sociales.
Réflexions sur la sociologie des associations
|
Laville et Saint Saulieu sont des sociologues des associations, des organisations à l'épreuve du changement social. | |
|
Le rapport de Block Lainé | |
|
J.M Belorgey qui a fait un livre sur le centenaire des associations |
L'apport heuristique[1] qui prend les associations comme objet. Cela cependant prendre l'association comme un objet unique enferme car il y a des a priori.
Les associations font valoir des innovations, vecteur de lien social, production de services …
Mais tout cela sont des a priori.
Un article de JP Riou : "l'association en politique" in René Remond "Pour une histoire politique " éd seuil 1988.
Il explique que la sociologie de l'association a démarré à la fin des années 70 au moment de la critique de l'état providence (voir A. Meister. B.EME - LAVILLE .B)
Rousseau ne voit pas l'utilité des associations. C'est l'Etat qui garantit la citoyenneté et l'égalité et qui doit définir la juste place des citoyens. Il ne devait pas exister par l'Etat.
En 1791, il y eu la loi le Chapelier interdisant toutes les réunions. Très lentement par la suite s'est rétabli ce phénomène avec l'industrialisation sous formes de mutuelles, ou mouvements présyndicaux. Cependant des sociétés philanthropiques qui essayent de temporiser le climat social par une prise en compte de l'indigence continuent à exister.
Le droit de l'association s'est libéralisé dans les années 1850. La formation des syndicats a été autorisée en 1889, par les républicains. C'est le regroupement des mouvements mutualistes et philanthropiques qui a permis l'avènement de la loi 1901.
Les vertus socialisantes et réformatrices des associations. Durkheim voit l'association comme un corps intermédiaire reliant l'individu et l'Etat pour lutter contre l'anomie[2], et que les individus s'inscrivent dans la société.
![]()
Heuristique : Didact. Qui a une utilité dans la recherche, notamment la recherche scientifique et épistémologique ; qui aide à la découverte. Hypothèse heuristique.
[2]
anomie
nom féminin
(grec anomia,
violation de la loi)
État de désorganisation, de
déstructuration d'un groupe, d'une société, dû à la disparition partielle ou
totale des normes et des valeurs communes à ses membres.