
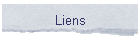


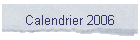

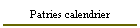
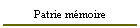
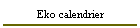

L'Ecole de Chicago, naissance de l'écologie urbaine"
par Yves Grafmeyer et Isaac Joseph. Editions du champ urbain.
Collection "Essais". Paris, 1979.
Cet ouvrage est un recueil de textes issus d'un courant de recherche original en sociologie urbaine apparu dans les années 1920
aux Etats-Unis. Ils sont traduits et présentés par Y. Grafmeyer et I. Joseph sous le titre : "la ville-
laboratoire et le milieu urbain".
Ce recueil s'ouvre sur une présentation de la genèse et des travaux de "l'Ecole de Chicago" et se compose des écrits de :
_ Georg Simmel : "Digressions sur l'étranger"(1908) et "Métropoles et mentalité"(1903).
_ Robert Ezra Park : "La ville. Propositions de recherche sur le comportement humain en milieu urbain"(1925).
"La ville comme laboratoire social"(1929).
"La ville, phénomène naturel"(1952).
"La communauté urbaine : un modèle spatial et un ordre moral"(1926).
_ Ernest W. Burgess : "La croissance de la ville. Introduction à un projet de recherche"(1925).
_ Roderick D. MacKenzie : "L'approche écologique dans l'étude de la communauté humaine"(1925).
"Le voisinage. Une étude de la vie locale à Columbus, Ohio"(1921).
_ Louis Wirth : "Le phénomène urbain comme mode de vie"(1938).
_ Maurice Halbwachs : "Chicago, expérience ethnique"(1932).
Robert E. Park (1864-1944) est un ancien journaliste-reporter à Detroit, Minneapolis, Chicago et New York et
a été l'élève de Georg Simmel à Berlin quand il rejoint l'université en 1913. C'est à partir de ses "Propositions de recherche
sur le comportement humain en milieu urbain", écrites en 1916, que "se constitue autour de Park une véritable école, ayant
une problématique écologique commune et un champ de recherches (un laboratoire) commun"[...] sans rupture avec le passé
journalistique de Park. Pour lui en effet, le sociologue est "une espèce de super-reporter"[...]
dont "le travail"[...] doit "nous permettre
de comprendre ce que nous lisons dans le journal"[...], affirmant ainsi le caractère
à la fois scientifique et pédagogique de la démarche
sociologique spécifique de l'Ecole de Chicago dont Park est le fondateur.
Pas de rupture non plus entre d'une part, son passé militant : il a été secrétaire de Booker Washington
et de son association de défense et de promotion des Noirs du Sud, et d'autre part la place centrale de la figure
"simmelienne" de l'étranger dans les travaux de l'Ecole de Chicago. C'est la véritable clef de voûte théorique de ce courant de recherche
dans son analyse des mécanismes et processus de socialisation en milieu urbain : à travers l'étude du rapport individu-environnement, mais
aussi par intérêt pour la question de l'immigration.
L'ancrage des recherches de l'Ecole de Chicago dans le modèle simmelien nous semble pouvoir expliquer le choix de Grafmeyer et Joseph
de faire figurer les deux écrits du sociologue allemand dans le présent recueil.
Ernest W.Burgess, R.McKenzie, Louis Wirth sont trois des collaborateurs de "l'Ecole" dont les textes sont présentés dans cet ouvrage.
Maurice Halbwachs, sociologue français, s'est intéressé très tôt à l'Ecole de Chicago et aux "inspirateurs de ces
travaux sur la vie urbaine"[...]"MM.Park et Burgess"[...]. Il note dans l'attention qu'ils portent aux "formes matérielles" de la société
une référence explicite à l'analyse morphologique durkheimienne : autre inspiration théorique majeure présente
dans l'oeuvre de l'Ecole de Chicago.
"S'il existe à l'Université de Chicago, une école de sociologie originale, cela n'est pas sans rapport avec le fait
que ces observations n'ont pas à chercher bien loin un sujet d'étude. Sous leurs yeux se déroulent, de dix ans en dix ans,
et presque d'année en année, de nouvelles phases d'une évolution urbaine sans exemple." écrit ici M.Halbwachs.
Mais nous reviendrons plus tard au texte du sociologue, à son intérêt pour les hommes et les idées de l'Ecole de
Chicago; à sa propre analyse des processus à l'oeuvre dans le développement de cette "grande ville en train de
s'accroître"[...]"ville d'immigration"[...]qui "s'est développée en parfait contraste avec[...]nos grandes villes
européennes."[...]"plus particulièrement (à) Paris"[...]"une vieille cité grandie lentment." écrit-il dans "Chicago,
expérience ethnique.
"La ville. Propositions de recherche sur le comportement en milieu urbain" de R. Park, est pour
Grafmeyer et Joseph un véritable manifeste : un texte de base et de référence "jetant les bases
d'une série de travaux représentatifs d'un courant original de la recherche en sociologie urbaine : l'écologie ".
"La ville[...]est[...]plus qu'une agglomération d'individus et d'équipements collectifs[...]plus qu'une constellation
d'institutions et d'appareils administratifs[...]". "C'est plutôt un état d'esprit, un ensemble de coutumes et de traditions[...]"
.[...]"pas simplement un mécanisme matériel et une construction artificielle. Elle est impliquée
dans les processus vitaux des gens qui la composent : c'est un produit de la nature et, particulièrement, de la nature humaine."
L'écologie humaine, "par opposition à l'écologie végétale ou animale" est ainsi désignée par les auteurs
de l'Ecole de Chicago, comme la science qui s'intéresse aux forces à l'oeuvre dans ce processus de production : à
l'intérieur d'une communauté urbaine ou de "n'importe quelle aire naturelle d'habitat humain".
Est ici explicitement posé le rapport société/espace. La ville est définie comme une unité géographique,
écologique mais aussi économique fondée sur la division du travail ("multiplication des emplois et des professions au sein de la population urbaine") ; un "tout organique" ayant sa propre dynamique.
Les principaux facteurs de "l'organisation écologique" de la ville sont "les transports et les
communications [...]les journaux et la publicité, les édifices[...]" devenant "[...]partie prenante de la ville
vivante [...]par interaction avec les forces vives des individus et des communautés,
exactement comme un outil à la main de l'homme".
"En somme, la ville est l'habitat naturel de l'homme civilisé et, par là même[...]une aire culturelle caractérisée
par son type culturel particulier.
Les concepts de nature et de culture sont ici non pas en opposition, mais mis en relation dans une analyse originale
voire novatrice de l'urbanisation en tant que phénomène social.
Qualifiée en effet de "phénomène fondamental de l'existence humaine", la ville est définie par Park comme
le produit du caractère "bâtisseur "de l'homme.
"La ville[...]"pose en outre l'historicité de la démarche de l'Ecole de Chicago : "[...]jusqu'ici, l'anthropologie,
la science de l'homme, s'est consacrée principalement à l'étude des peuples primitifs"[...]et non à "l'homme
civilisé[...]objet de recherche tout aussi intéressant[...]". La vie urbaine contemporaine a "essentiellement
intéressé les romanciers mais [...]elle réclame une analyse plus fouillée".
Notre avis:
Penser l'urbanisme en terme d'écologie constitue au premier abord une démarche audacieuse pour trois raisons au moins :
- Au regard de l'époque à laquelle l'Ecole de Chicago développe ses travaux : dans les années 1925_30,
c'est-à-dire, à une période où l'industrialisation et l'urbanisation sont en plein essor dans les sociétés occidentales.
Le rapport ville/nature est alors un rapport de contraste marqué : il y a la ville d'un côté et la campagne de l'autre,
deux univers distincts que tout semble opposer ; modes de vie et mentalités en particulier.
Sur le plan des idées c'est pourtant à cette période que R.Park et les auteurs de l'Ecole vont s'intéresser au caractère
fondamentalement et spécifiquement créatif de la nature humaine, à travers l'observation et l'analyse
des mécanismes de production urbaine,
particulièrement mais non exclusivement citadine.
_ Les travaux de Park et de ses collaborateurs témoignent d'une prise de recul et d'une oeuvre de conceptualisation
certes propres à toute démarche de recherche, mais qu'il convient de saluer ici en raison du fait que R.Park est issu du journalisme
et non pas de l'université...qu'il n'a rejointe qu'à l'âge de 49 ans. Les emprunts théoriques à des courants sociologiques
(le fonctionnalisme de Durkheim en particulier) ou philosophiques majeurs (Marx) constituent en effet la trame du développement
de la pensée de l'Ecole de Chicago.
_ Ces études se sont attachées à saisir l'ensemble des facteurs d'émergence et de développement de ce qui
constitue une ville ; d'en repérer toutes les dimensions et de les mettre en lien (territoire, mobilités, économie, immigration...),
dans une proposition sociologique pionnière préfigurant le concept contemporain d'environnement.
En effet, si l'on se réfère à la définition étymologique du terme "écologie" extraite du Larousse 1997: "du grec
oÏkos : maison, et logos: science,
l'écologie est la science qui étudie les relations des êtres vivants entre eux et avec leur milieu",
"l'écologie humaine " de l'Ecole de Chicago
apparaît bien comme un concept avant-gardiste.
A présent, nous allons nous centrer sur ce qui, dans les textes présentés dans cet ouvrage, est plus
spécifiquement en lien avec "Les petites patries".
"Digressions sur l'étranger", de Georg Simmel, 1908.
La forme sociologique de l'étranger se présente comme la synthèse de la distance et de la proximité, associant en
quelque sorte mobilité et sédentarité dans un même mouvement créatif.
Distanciation et proximité sont caractéristiques de toute relation humaine, en particulier dans la relation avec
l'étranger dont "toute l'histoire économique montre qu'il fait partout son apparition comme commerçant" : comme
intermédiaire entre le groupe et l'extérieur lorsque les biens de consommation sont en effet produits à l'extérieur
du groupe et qu'il n'y a de ce fait plus autosuffisance.
"Seul le commerce rend possibles ces combinaisons illimitées par lesquelles l'intelligence trouve des prolongements
[...]et de nouveaux territoires".
Par son apparentement à la "forme sublimée" du commerce intermédiaire : la pure finance, l'étranger en acquiert
la principale caractéristique : la mobilité. Par son entrée dans un groupe fermé, elle produit "cette synthèse de
proximité et de distance qui constitue la position formelle de l'étranger."
La relation de l'étranger avec les autres individus peut encore se traduire par de l'objectivité : attitude spécifique
déterminée par cette meme distance, propre au fait que l'étranger n'a par définition ni racines ni attaches
organiques avec le groupe. Pour autant, il est membre du groupe et c'est la spécificité de son rapport au groupe
qui détermine la cohésion de ce dernier.
Notre avis :
Il nous semble que Simmel développe ici l'idée selon laquelle l'étranger, en tant que figure sociologique, est de par
le fait qu'il introduit de l'altérité, à l'origine du processus d'urbanisation...voire de civilisation?
Par extrapolation , ce point de vue donne à penser que la figure simmelienne de l'étranger incarne de par sa fonction
tout facteur d'interrelation entre un groupe social et l'environnement qui lui est extérieur, entrainant ainsi le
développement d'autres interrelations...etc. Si l'on transpose ce qui est décrit à l'échelle d'un groupe à un
niveau plus large, on se représente alors le processus d'urbanisation comme un ensemble quasi illimité de ramifications
prenant la forme d'un réseau en expansion permanente.
En présentant sa description du mécanisme particulier : le rapport groupe/étranger, et de ce qu'il produit : une synthèse
de proximité et de distance, le texte de Simmel trouve une place centrale dans l'ouvrage que nous abordons :"L'école
de Chicago". Ce rapport est en effet au coeur meme du processus de production urbaine.
"Métropoles et mentalités", de Georg Simmel, 1903.
Situant son propos dans le contexte paradigmatique de la division et de la spécialisation du travail du 19° siècle,
Simmel postule que "le ressort fondamental" de l'accomplissement individuel réside dans la[...] "résistance que le sujet
oppose à son nivellement et à son usure dans un mécanisme social et technique"[...].
C'est son adaptabilité qui permet à l'invidu de procéder aux accomodations nécessaires. C'est en milieu urbain
que l'individu est le plus fortement soumis à une stimulation nerveuse intense et incessante ; et c'est ainsi en premier
lieu sur le plan sensoriel que le sujet s'organise et s'adapte en tant "qu'etre de différence", dans un contraste
profond entre ville et campagne.
A la différence de l'habitant rural, analyse Simmel, c'est par son intellectualité plutot que par son affectivité
que le citadin-type parvient à la fois à se protéger de la "violence de la grande ville" et à s'adapter aux
changements permanents auxquels il est confronté en milieu urbain. Parce que "[...] les couches les plus élevées de
notre psyché, transparentes et conscientes, sont le siège de l'intelligence qui, de nos forces internes, est la plus
capable d'adaptation." par opposition aux [...] "couches psychiques les plus inconscientes (dans lesquelles)
s'enracinent la sensibilité et les rapports affectifs" [...] propres aux habitants des campagnes et petites villes.
Les manifestations individuelles de cette intellectualité "citadine" sont multiples, dans l'échange et plus
particulièrement dans l'économie monétaire,[...]"spécificité historique des grandes villes" [...].
"L'habitant des grandes villes calcule [...] avec des personnes qui appartiennent à son réseau social d'obligation"
dans des relations interpersonnelles qui excluent l'individualité et l'affectivité ; des relations objectives
caractéristiques du marché urbain où producteurs et acheteurs ne se connaissent pas.
[...]"L'esprit moderne est ainsi devenu de plus en plus calculateur"[...] en conformité avec [...]"l'idéal de la
science[...]". De plus, l'étendue des distances ajoute au caractère méthodique et ponctualisé des activités et relations
d'échange urbaines, la nécessité d'un ordonnancement rigoureux.
Il existe ainsi dans toute localité une attitude psychique citadine typiquement blasée, forme d'adaptation aux stimulations
incessantes de "la grande ville", mais qui n'est pour autant ni de l'indifférence ni irrémédiable.
Cette mentalité est [...] "le reflet subjectif de l'économie monétaire [...]intériorisée [...], l'argent (étant) avec
son absence de couleur et son indifférence, le niveleur le plus effrayant ; (vidant) de sa substance le noyau des choses,
leur particularité, leur valeur spécifique, leur incomparabilité."[...]
A l'instar de l'évolution d'un individu vers plus de liberté et d'autonomie au sein d'un groupe social en formation
(restreint et délimité puis s'élargissant et s'ouvrant avec son accroissement), l'habitant d'une ville gagne en
mobilité à mesure que le "cercle" s'élargit sous l'effet des "[...]relations d'échange et (des) connexions [...]".
Mais ce n'est pas seulement l'importance de la superficie de son territoire ou du nombre de ses habitants "[...] qui
fait de la grande ville le siège de la liberté personnelle[...]".
En effet, au-delà de l'expansion visible de la ville, son extension est un phénomène dynamique en raison du fait
qu'ainsi la ville acquiert de la valeur, "[...]d'une façon similaire à la forme de développement de la fortune[...]"
et sa zone d'influence s'accroit en fonction de cette plus-value. Ce point est défini comme caractéristique des grandes villes.
Ce processus d'expansion-extension est lié à la division et à la spécialisation économique du travail en général et
en ville en particulier, où "[...]le combat avec la nature pour la subsistance (est transformé) en un combat avec
l'homme [...] dont le bénéfice (est accordé) non pas par la nature mais par les hommes [...]".
"[...]la nécessité de spécialiser la production, pour trouver une source de revenus[...]"conduit à une différenciation économique
qui elle-meme entraine une individualisation des qualités humaines...et son corollaire : le développement et l'accomplissement de la liberté individuelle.
Dans son analyse, d'une part Simmel se fonde sur l'opposition ville/campagne, particulièrement
marquée mais néanmoins déjà en mutation à la fin du 19°siècle-début 20° (avec l'avènement de l'industrialisation) ;
d'autre part il associe des mécacanismes de nature différente : psychologique, économique, historique ou géographique
tantot à l'échelle individuelle, tantot sur un plan collectif. Dans cette démonstration le sociologue établit une
corrélation entre les processus d'urbanisation et l'accomplissement de la liberté de l'individu dans la société moderne.
Sur le plan théorique, Simmel s'inscrit dans la continuité de la pensée durkheimienne et développe la sienne propre :
la psychologie sociale ; pensée qui a inspiré l'Ecole de Chicago, ce qui explique sans doute la place de ce texte dans le présent ouvrage.
"La croissance de la ville.
Introduction à un projet de recherche". E.W.Burgess, 1925
Dans ce texte, Burgess propose une analyse plus spécifiquement centrée sur les mécanismes d'expansion des villes.
Depuis la fin du 19°, l'industrialisation a entraîné de fortes mutations sociales avec, en particulier, la croissance des grandes villes.
"Alors que le passage d'une civilisation rurale à une civilisation urbaine est survenu plus tard aux Etats-Unis qu'en Europe [...] les manifestations
spécifiquement urbaines de la vie moderne - le gratte-ciel, le métro, le grand magasin, le journal quotidien [...] sont typiquement américaines."
Des études statistiques comparatives (ville/campagne) effectuées par des chercheurs comme Weber ont mis en lumière certains effets de la croissance
urbaine sur la population. Ainsi la proportion de femmes ou d'individus d'âge moyen est-elle plus grande en ville qu'à la campagne,
de même que le taux d'immigrés y est plus élevé.
Cette évolution est révélatrice des mutations sociales profondes en cours dans la société.
Telles sont les réflexions préalables de Burgess dans cet article.
Mais son propos se rapporte non pas au "[... processus d'agrégation urbaine [...] décrit par Weber et BÜcher, mais plutôt
aux mécanismes humains qui "produisent" en quelque sorte l'expansion urbaine en terme de métabolisme et de mobilité.
Le concept d'expansion territoriale, en ce qui concerne les villes notamment, appartient habituellement au champ
de l'urbanisme : logement, transports, développement... L'auteur entreprend dans sa réflexion de l'aborder en tant que
phénomène physique ayant sa dynamique propre.
Burgess utilise pour représenter la croissance de la ville de Chicago, un schéma constitué de 5 cercles concentriques.
Un premier cercle figure le centre-ville : le "loop", lui-même encerclé par une deuxième zone désignée comme "factory zone".
Puis vient la "zone of workingmen's homes", aire de transition, entourant la précédente. Une quatrième aire représente "the residential zone" ;
et la cinquième et dernière : "the commuters zone" (zone des banlieusards) représente "[...]les aires suburbaines ou villes satellites [...]".
Ce schéma propose donc une représentation graphique de la tendance de chacune de ces zones à étendre son territoire selon un processus
défini comme "succession" en écologie végétale. Ajoutons que cette différenciation de la ville en aires résulte du processus
de distribution-sélection qui s'opère entre les individus ou les groupes sociaux en fonction de leur lieu de résidence ou de leur
profession notamment (effet de la division du travail
Ainsi le phénomène d'expansion urbaine se réalise en même temps par extension et par succession
Ce processus serait la traduction de la tendance naturelle des habitants d'un lieu à rechercher hors des zones surexploitées
ou dégradées de meilleures conditions d'existence, tout en s'assurant des moyens de subsistance ; tendance elle-même de ce
fait puissant facteur de mobilité
Toutefois note Burgess, des mécanismes complémentaires de concentration et de décentralisation
compliquent l'analyse. En effet, dans sa description du développement de la ville de Chicago, l'auteur
observe l'existence d'un mouvement de convergence qu'il qualifie de naturel, vers les lieux d'activités tels
que les gares, commerces, bureaux, théâtres ou encore musées ; et en même temps, plus récemment, l'apparition
de "centres d'affaires secondaires" dans des zones excentriques témoignant d'une tendance décentralisatrise à l'œuvre
Cependant cet accroissement en devenant excessif produirait des perturbations dans le "métabolisme" social, écrit Burgess,
empruntant termes et concepts au(x) champ(s) relatif(s) au développement individuel – médecine ou psychologie-. Et de donner
comme exemple de perturbation "[...]l'excédent d'hommes sur les femmes [...]" ou inversement.
Mais la désorganisation sociale est pour Burgess, donc en psychologie sociale (école de Chicago), préliminaire à la "[...]réorganisation
des attitudes et conduites[...]" et cette relation réciproque doit être considérée comme un facteur de progrès car "[...]le changement donne
tôt ou tard un sentiment d'émancipation et incite à poursuivre de nouveaux objectifs.[...]". Dans son article, Burgess propose une analogie
entre les processus individuels de socialisation et "[...] les processus d'organisation et de désorganisation [...] d'une société donnée : à l'échelle
de la personne comme à celle de la société, ces processus ont leur ancrage dans un environnement préexistant et produisent de la croissance.
Commentaire : nous sommes sans doute ici au coeur-même du mécanisme d'adaptation, producteur d'évolution, d'expansion,de croissance.
Articulant les concepts d'organisation-désorganisation et celui de mobilité, Burgess s'attache à démontrer, statistiques à l'appui, que l'accroissement
de la mobilité propre à la vie urbaine génère une augmentation des stimulations qui elle-même entraîne de la désorganisation
Proposant de concevoir la mobilité comme "[...]le pouls de l'agglomération[...]", Burgess postule qu'elle agit comme un révélateur
de ses changements "d'état
On peut mesurer la mobilité à l'aune des déplacements et des contacts ; éléments entrant dans sa composition.
Les valeurs foncières reflètent les déplacements et constituent (de ce fait) un indicateur sensible de mobilité. Mis en
corrélation, les différents indices de mobilité témoignent ainsi de "l'état de santé" d'une ville, de l'état de son métabolisme,
pour reprendre l'analogie biologique employée par Burgess dans sa démonstration.
Conclusion :
Expansion, métabolisme et mobilité sont les termes et concepts-clés de l'exposé de Burgess qui tente, en 1925, dans sa réflexion,
par son écrit et à l'aide d'une comparaison "naturaliste" audacieuse parfois émouvante, de saisir et de rendre compte du caractère vivant,
dynamique, paradoxal des processus à l'oeuvre dans le phénomène d'expansion urbaine. Tout comme R.E.Park, Burgess procède en
qualité "d'enquêteur-sociologue" à "[...]l'observation du changement (...)quasiment la seule fonction scientifique du laboratoire [...]" nous
indiquent Grafmeyer et Joseph dans le texte de présentation de "L'école de Chicago", dans une sorte d'avertissement de lecture.
Cet ouvrage a en effet pour objectif de présenter les textes de chercheurs qui se sont efforcés de comprendre et de rendre compte des
mutations sociales majeures du début du 20°siècle, alors même qu'ils en étaient contemporains ; témoins éclairés s'il en fût, s'inscrivant
ainsi dans la continuité de pensée sinon théorique des "découvreurs" que furent Durkheim ou Weber.