Le 14 octobre 2004
Module : La Société Française
· Point de Repère sur la Société française
· Regard Sociologique sur notre société
Pacte Social ð Libération 1945ðDémarrage du Baby Boom
La France comme modèle de colonisation ð Mutation avec l’Europe – Ensemble hétérogène ðPlace de l’Etat moins central ðDécentralisation de l’Etat – Mondialisation.
Dés institutionnalisation des institutions : Exemple : l’Ecole – l’Eglise
La JAC la JEC la JOC
Agricole Politique Syndicale
Caractère normatif prescription de l’église- Militance de l’église.
Désinstitutionnalisation du religieux – du Politique 1950 clivage politique – des syndicats ( France, Europe plus de partis Syndicaux mais de moins en moins d’adhérents). Importance d’avoir des centrales syndicales fortes pour avoir un contre pouvoir.
Partage de pactifordiste : Sorte de pacte, accord entre patronat et salariat : on travaille dur, mais il y a des politiques sociales, l’ascenseur social.
Passage d’une société Holiste à une société individualiste.
Influence et sous culture
| Consommation | |
| Loisirs, Vacances | |
| Propriété | |
| Animisme |
Paradoxe : Tocqueville 19ème siècle
« Plus des besoins sont satisfaits, plus apparaît injuste la situation de ceux qui en sont privés »
La Mondialisation fait peur – Mouvement d’Alter Mondialiste-Problème inhérent à la mondialisation. Nouveaux Schémas apparaissent « Autoroute de l’information… ».
Recomposition des groupes sociaux.
Nouveau façonnage de la France « un monde paysan » qui s’ancre dans un monde sans paysan. Nouvelle question sociale : Travail – Salaire de misère.
Expression question sociale 19ème siècle.
Droit dignité humaine : Devoir réciproque entre les droits et les devoirs
Trace des oubliés :
· Disfonctionnement de l’Etat providence « Il est trop petit pour les grandes choses et trop grand pour les petites choses ».
· Déconcentration des institutions
· Décentralisation des pouvoirs politiques « Elus locaux » différences des égalités.
· Etat ðDiscours de pouvoir. Société de victimisation
Pacte social : Mutualisation des responsabilités ðDifférentes avec aujourd’hui.
Changement de mode de vie : Politique de la Ville – Territoires administratifs recoupements difficiles - Réseaux.
Société tertiaire – Société de services : 70% en France dont 80% en région parisienne.
Transformation du modèle de la famille en fonction des trajectoires de vies. « Ce qui fait la famille c’est l’enfant. Il y a 50 ans c’était le couple qui faisait la famille.
Vieillissement de la population française . Lien social distendu – Citoyens consommateurs.
![]()
Le 21 octobre 2004
Module : Territorialité et Intervention Sociale
La Territorialité c’est l’apparition d’un lieu d’identité dans l’espace, une trace essentielle, une forme qui donne à voir une manière d’être et de faire.
Action différent d’analyse
Territorialité ð Découpage d’un site territoire ð Cadre d’une action sociale
Action sociale à définir . Globalisation des territorialités
1. Sectoriel
2. Territorialité
3. Globalisation
Problème Psychosociologique des personnes. Prendre en compte les éléments d’un récit pour en faire une photographie d’une problématique.
Observer le ou est possible ou terrain porteur d’identification et témoin ðJe peux prendre ces traces comme identification d’une trajectoire. Prise en compte du lieu comme espace de médiation. Ou comme signifiant d’espace temps.
Territorialité :
· Découpage administratif.
· Ritualité de l’ordre
Microsociologie & Macrosociologie « Dialectique l’un est le multiple de l’autre ». Paradoxe des valeurs « Mal et le Bien » .
Territorialité question de langage en corrélation au lieu.
Diaspora Le Larousse définit une diaspora comme "la dispersion d'un peuple ou d'une ethnie à travers le monde".
· Socio politique urbaine
· Intégration exclusion
· Espace
· Mise en perspective de l’évolution historique du travail social
Intérêt d’identification des lieux de vie et des trajectoires de son public.
Espace du Péri urbain nébuleuse qui s’étend à la classe moyenne. Nébuleuse individualiste avec montée en puissance de l’entre soi. Fin de la mixité sociale.
La mixité sociale est ascendante dans la mobilité. Chorégraphie des gens – Valeur régularité commune – Ritualité collective.
![]()
Le 21 octobre 2004
Module : Evolution des formes de l’action sociale
Préambule :
L’action sociale comme lieu ou réduire l’intervention sociale au présent
· Inflation et multiplication des lois
· Hétérogénéité des métiers – Manque de lisibilité du champ social
· Aspect flou des représentations « Instrumentalisation politique »
D’où l’intérêt de faire référence à l’histoire « Posture – Approche »
· Histoire institutionnelle
· Histoire sociale
Bibliographie : Yvonne KNIEBIEHLER « Invention des Sentiments»
Histoire Economique Méthode de BRODEL Méthodologie
Effet de contexte- Le temps cyclique – le temps long
L’histoire permet de donner de la distance, un autre regard, de mieux élucider et de donner du sens.
Paradigme : Concept - Courants de pensées
Il n’y a pas de fait il n’y a que des interprétations. Contrôle des interprétations par étapes.
Schéma Théologique ð Passé – continuité évolutionniste
Schéma Evénementiel ð Rupture légitimation des pratiques
Dispositif théorique ð Principe de cohérence – tentation de l’unité - principe de distorsion.
Dispersion hétérogène voir conflictuelle
Bibliographie : Arlette FARGE « Vivre dans la rue »
Principe de délimitation du champ ( séparer l’objet de ce qui nous intéresse pas).
Assistance satisfaction des besoins
Définition de l’assistance :
Dans le Travail social on peut repérer 3 systèmes d’assistances qui se sont succédés.
1. Redistribution
2. Charité
3. Intervention sociale
Redistribution : Donner – Recevoir - Rendre (Fondement de l’échange)
Bibliographie : Marcel MAUSS « Essai sur le Don »
Le Pouvoir est associé à la faculté de se dessaisir de certaines richesses. Recherche du prestige social « Sahlins ».
Potlash : Système de dons échangés pour l’honneur non pour le profit.
Agonales ð Respects des règles
Agora ð Lieu de la démocratie
![]()
Module : Histoire du Travail Social
I
I – Institutions et Doctrines
II – Les Processus de Professionnalisation
I – Institutions et Doctrines
1789 : Révolution
1792 : Première République
1804 : 1er Empire apparition du Code Civil
1815 : Restauration des Monarchies
1848 : Seconde République
1852 : Second Empire
1870 : 3ème République –La Commune
1939 : Régime de Vichy
1944 : 4ème République
1958 : 5ème République
| Avant 1789 : Charité Chrétienne – Période Métaphysique du Travail Social | |
| 1789-1804 : Institutionnalisation de Principes « Naissance de l’ Assistance Publique » | |
| 1815-1870 : Période Philanthropique - Idée de Charité toujours omniprésente marquée par le développement d’un humanisme Laïc « Même chez les chrétiens » |
Naissance des Patronages, sillage du siècle des lumières « Laïc »
Apparition des premières Maisons de correction (1842) Méthodes coercitives
Mise en place des colonies correctionnelles et pénitentiaires Légitimées en (1850)
| 1870 : Base de la fabrication du droit social - Avènement de la 3ème République |
Fin 19ème , premières initiatives en faveur du logement et de la protection des nouveaux nées
| 1900 : Apparition des premiers métiers du travail social – Début de la professionnalisation du Travail Social (Infirmières Visiteuses reconnues en 1922) |
| 1944 : Apparition de la Notion d’Action Sociale ; Avant 1953 cette notion reste encrée dans une idée d’Assistance et après 1953 elle prend toute sa signification dans l’idée d’aide aux personnes et ce afin de transformer les comportements « déviants » donc d’Action Sociale |
| 1815-1970 : Période d’enfermements « Michel FOUCAULT – Histoire de la Folie à l’âge classique »* |
| 1960-1970 : Apparition de la sectorisation et de la territorialisation |
| 1980 : Début des politiques de proximité ( Développement Social Urbain – Développement Social des Quartiers) |
Le Champ historique : Une discipline qui a une fonction
D’après *Marc BLOCH grand historien, fondateur des Annales en 1924 – Fusillé en 1944 victime de Klaus BARBIE.
*Critique des théories d’Economistes : On ne peut pas se contenter de remonter à 10 ans dans l’histoire - Apologie pour l’Histoire
« On ne peut comprendre ce qui se passe dans le présent avec le présent seul. Une réalité ne se comprend jamais mieux que par ses causes. L’ignorance du passé ne se borne pas à nuire à la connaissance du présent, elle compromet dans le présent l’action même »
Différentes postures du champ historique
| L’histoire comme un éternel recommencement ? | |
| L’Histoire comme une évolution progressiste ? |
Il existe différentes postures préconisées par les historiens :
Histoire en boucle
Histoire en évolution linéaire
Histoire en spirale ( Alternance de progrès et de régressions )
L’histoire du travail social est alimentée par une croyance au progrès qui solutionnerait les problèmes sociaux. Ex la médecine et la science avec l’éradication de la tuberculose.
Il est à noter que le Travail Social ne peut pas être considéré comme une science à part entière. Le travail Social dépend de différentes sciences ( Sciences Politiques, Sociologiques Economiques, Humaines…) donc pluridisciplinarité de chacune.
En 1950 le Case-Work est apparu en France et a essayé d’exister en qualité de savoir autonome en sachant qu’une première tentative avait émergée en France vers 1915.
Le Travail Social ne peut pas exister et évoluer en s’auto référent. Il est donc interdépendant des autres sciences, même si l’on parle de d’une entité du travail social.
a) Les controverses autour du traitement social de la question sociale :
Peut-on apparenter la charité au travail social ?
Dixit le sociologue contemporain Georges SIMMEL émanant du courant de pensée d’Emile DURKHEIM ( Courant de pensée différent, opposé à toute tendance moraliste) fin 19ème Siècle.
« Lorsque l’on donne aux pauvres, on ne le fait pas pour le pauvre mais pour soi, pour le salut de son âme »
· Pratique de charité libre et facultative
La Révolution marquera une rupture fondamentale avec les pratiques de charité. Avènement du travail social entre les républicains et l’église et entre les républicains eux-mêmes.
Adam SMITH ( Pro libéral) « l’intérêt personnel joint au fonctionnement libre de l’offre et de la demande constitue un heureux mécanisme de régulation de l’économie » Le marché génère de la richesse (Théorie capitalisme).
VOLTAIRE (Siècle des lumières 18ème Siècle) Se bat contre le fanatisme religieux mais n’est pas pour autant particulièrement social. Fervent défenseur des intérêts de la bourgeoisie.
John LOCK ( libéral ) Opposition face à l’intervention de l’Etat dans les domaines privés ( Famille, religieux et industrie).
Les plus sociaux
MONTESQUIEU : Il jette les bases des pouvoirs exécutifs. Séparation du pouvoir législatif, exécutif et judiciaire.
ROUSSEAU : Précurseur du Concept du Contrat Social. Principe d’unité pour régir la vie des hommes en société et combattre les inégalités.
b) Fabrication de la doctrine sociale des révolutionnaires
Construite autour de l’idée de dette inviolable et sacrée qui est conférée à la puissance publique.
Les révolutionnaires prônent que tout être humain à le droit d’assurer sa propre subsistance notamment par le droit au travail. Robert CASTEL le démontre dans « les Métamorphoses de la question sociale ».
Résultante : Le principe de charité est évacué par le principe de droit à l’assistance.
Sur quels critères ? Découpage typologique « Enfance- Vieillard – Handicap … »
Selon R CASTEL déterminé par la valeur travail.
Droit de la rééducation par le travail : Les indigents valides relèvent de la rééducation par le travail ( Création d’Ateliers nationaux, maisons du travail ).
L’oisiveté est condamnée par les révolutionnaires ( bons et mauvais pauvres).
Pour évoquer l’exclusion, R CASTEL parle de désaffiliation ou le phénomène d’exclusion est en corrélation à la crise de l’emploi.
Le Duc de la Rochefoucauld- Liancourt grand philanthrope, aristocrate visionnaire et lucide, avait prévu la révolution. Il est à l’origine de grandes innovations : système scolaire et réformateur des prisons.
II a patronné des comités de mendicité.
Le Catholicisme Social : Suit une voie étroite avant de se développer considérablement.
1ère étape : La Révolution destitue l’église de ses institutions charitables (hôpitaux, asiles…) Naissance de l’assistance publique. Maintien du personnel religieux en place afin de faire fonctionner les établissements.
2ème étape : 1891 Evolution ð l’encyclique Rerum novarum écrite par le pape Léon XIII autorise ses fidèles à aller au peuple « chose nouvelle » et les invite à s’engager sur les questions sociales.
3ème étape : 1905 Séparation des Eglises et de l’Etat. Fin du Concordat
Acte par lequel il est signifié que l’Etat ne reconnaît, ne salarie et ne subventionne aucun culte.
Parallèlement, mise en place de la loi de 1901 relative au milieu Associatif. Loi qui permettra à l’Etat de contrôler les oeuvres confessionnelles et philanthropiques évoluant sur le terrain et ce en leur accordant reconnaissance et financement. Celles ci ont pour vocation de remplir des tâches que l’Etat ne peut ou ne veut pas prendre en charge.
Les catholiques Sociaux ont :
· Constitué un frein au « libéralisme sauvage » expansion effrénée du capitalisme.
· Eviter le piège de doctrines issues du syndicalisme « Marxisme, anarcho-syndicalisme »
L’Eglise repousse des modèles sociaux tout en fabriquant de la Doctrine.
L’abbé LAMENAIS 1782-1854 : Désaccord avec le pape. Vision moralisatrice, il s’est particulièrement intéressé à la classe ouvrière pour la moraliser.
Banni par le pape, il défendait la liberté de l’Eglise contre la papauté et prônait la liberté de conscience. Il avait deux alliés LACORDAIRE et de . leaders catholiques célèbres.
Vicomte VILLENEUVE BERGEMONT 1784-1850 : Fondateur de la Société des établissements charitable.
Armand de MELUN royaliste enclin aux réformes sociales. Fondateur des annales de la charité.
Frédéric OZANAM 1813-1853 : Fondateur des œuvres de Saint-Vincent de Paul « 4 500 membres actifs »
Fort de constater que les catholiques sociaux se sont ralliés à la république
C’est la révolution qui a reconnu les juifs comme citoyens à part entière. Un certain nombre sont devenus des personnes importantes d’Etat.
Les radicaux socialistes et les solidaristes se sont fortement inspirés de la doctrine de DURKHEIM et de Léon BOURGEOIS « théoricien du radicalisme- Elu député de la Marne en 1888 » pour construire le travail social avec les catholiques sociaux.
Les Doctrines sociale d’Etat l’Hygiénisme social et le catholicisme social sont à l’origine du travail social.
II – Les Processus de Professionnalisation
Courants sociologiques :
· Modèle Fonctionnaliste
Cherche à définir de grandes règles d’organisation de la société.
· Modèle Interactionniste
Observer les tendances qui laissent place aux variables
Ces deux modèles permettent de faire la sociologique de la Profession.
Le modèle fonctionnaliste emprunt du courant de pensée de DURKHEIM, considère la société comme un grand corps. C’est une vision biologique qui accorde beaucoup de place aux sociétés organisatrices de lien collectif donc de lien social.
Le modèle fonctionnaliste définit 6 critères pour dire qu’une profession existe comme telle.
1 Etre exercée à plein temps
2 Comporter des règles d’activités (Aspect déontologique)
3 Inclure une formation et des écoles spécialisées (1940-1945)
4 Posséder des organisations professionnelles (ANEJI 1947)
5 Se doter d’une protection légale de la légitimité des actions (Monopole du champ d’intervention)
6 Avoir établi un code déontologique (Secret professionnel)
![]()
Cours de C.Humbert le 4/11/04
Évolution de la fonction cadre
Introduction sur les groupes et les individus, l'interaction entre le groupe et les individus.
En psychosociologie, on estime qu’il existe des entités spécifiques qui sont les groupes. La psychologie sociale est plus tournée vers l’individu. Le groupe comme entité spécifique en psychosociologie n’est pas réductible à la somme des fonctionnements et influences des individus de ce groupe. Il existe des groupes qui amènent des individus à fonctionner selon certaines façons.
Le groupe ne doit pas être réduit à la somme des individus qui le compose. Un groupe est structuré par un fonctionnement. La réalité, (configuration de la salle par exemple) (structure spatiale) participe aussi à la structure du groupe.
Nous avons tendance spontanément à interroger l'individu, sans faire référence au groupe auquel il appartient. Cela est trop réducteur. Il faut interroger l'histoire du groupe, son organisation, ses modes de fonctionnement.
Le groupe a une dimension culturelle et structurelle(ce qui est formalisé par le groupe).
L'étude du groupe sous son aspect clinique (définition de clinique : être au chevet de, être auprès de,).Au sens étymologique, clinique vient du mot grec kiné qui veut dire lit, chevet. Celui qui est dans la clinique est celui qui est au chevet de …
Ceux qui sont sur le terrain sont des « cliniciens » cad au chevet des populations.
La clinique se réfère aussi à la psychanalyse qui essaye de comprendre ce qui se passe à l'insu du groupe, à son inconscient. Étudier la répétition, les causes qui se répètent, les conflits dans les équipes.
Plan du cours
A travers le même mot, on peut identifier plusieurs choses
|
|
Le statut (c'est l'instituant, c'est l'étiquette) |
|
|
la fonction (c'est l'exercice d'une responsabilité) |
|
|
la structure |
Le statut
Dans une institution le cadre est différencié des employés, par le fait qu'il cotise à un régime de retraite pour les cadres.
L'avancement de carrière et la catégorie socioprofessionnelle sont différents des employés.
La fonction
Il faut distinguer le cadre technique ou fonctionnel du cadre hiérarchique.
La loi Aubry à intégré : les cadres dirigeants
les cadres heurés
les cadres forfaités
La spécificité française intègre des cadres qui ne peuvent pas être dirigeants (psychologue) et encadrer des personnes
On peut être cadre quand le diplôme est reconnu comme étant un diplôme de cadre, notamment le DESS de psychologue.
Le cadre comme désignant une structure, comme contenant
C'est le rappel de la règle, des limites. Il existe un rapport étroit ente le contenant et le contenu. Le cadre, dans sa fonction symbolique, limite et protège de l'extérieur. De quoi est constitué la fonction symbolique du cadre ?
C'est dans la psychanalyse que nous pouvons trouver des réponses. Le cadre de la psychanalyse est le suivant :
|
|
C'est un lieu organisé |
|
|
C'est des participants avec des fonctions particulières (l'analysant et l'analysé) |
|
|
La notion de temps fixe limite (si elle n'est pas limitée, elle sera donc annoncée comme telle avant le début de la séance |
|
|
C'est un coût |
|
|
Une règle du statut de l'expression (tout peut être dit et tout doit se dire à travers la parole) |
C'est paradoxalement dans un espace aussi contraignant que tout peut être dit.
Dans le secteur social, la fonction du cadre est de réfléchir à quel cadre peut on proposer à des usagers pour qu'ils puissent s'exprimer et être entendus sans pour autant briser ou détruire les autres usagers, ni épuiser les professionnels.
Il existe plusieurs type de cadre : bureaucratique, technocratique et coopératif. Le coopératif implique nécessairement une évaluation de la pertinence du cadre, une réflexion de stratégie de changements.
Le statut de la subjectivité
Lorsque l'on travaille dans le social, on y engage sa subjectivité. La question est de savoir comment l'objectiver, afin de produire des connaissances, des savoirs.
Quelles sont les modalités de la connaissance, d'appropriation, d'évaluation et d'évaluation du cadre.
Suivant le type de structure organisationnelle (bureaucratique ou coopératif) le type de réponse, de conduite, et surtout d'association de personnes variera d'un mode à l'autre.
Qui détient le pouvoir pour transformer et évaluer ? Qui a élaboré le cadre ?
Dans le secteur social, nous entretenons des relations ambiguës avec le cadre. C'est plus complexe que dans les autres secteurs.
En 1945, le ministre du travail Alexandre Parodi a pour mission de réorganiser les différentes catégories socioprofessionnelles, et en ce qui concerne les dirigeants crées la catégorie d'ingénieurs et de cadres. Les critères de cette catégorie sont le diplôme, l'expérience professionnelle (l'expertise dans la tache elle-même).
Les types de cadres sont : débutant, confirmé, supérieur, direction). Dans la fonction publique, c'est la catégorie A qui désigne les cadres.
Voir aussi le "Principe de Peter"
Le statut de cadre est apparu dans le privé puis ensuite dans la fonction publique
En 1947, il est créé des régimes spéciaux pour les cadres, avec notamment la création de l'AGIRC (caisse de retraite pour les cadre du Privé).
En 1954, création de la FNAC, Fédération Nationale pour l'Achat des Cadres
Il y a là une volonté manifeste de se démarquer de la classe ouvrière.
1980 - Valorisation de l'entreprise où la progression professionnelle est rendue possible pour des employés, ou la culture d'entreprise est très fortement entretenue. Ce sont les années "Tapie" où les cadres ne connaissent pas le chômage.
1990 - C'est les années de "l'horreur économique" Les cadres découvres qu'ils ne sont pas à l'abri du chômage. L'APEC se développe fortement dans ces années là et on évoque de plus en plus le terme de managers pour désigner des dirigeants.
(Réf : l'horreur économique / Viviane Forrester. - éd. Fayard, 1996)
2000 - Nous ne sommes toujours pas sorti de "l'horreur économique" à laquelle s'ajoute l'age des cadres. Néanmoins après la période des jeunes cadres dynamiques en opposition aux cadres âgés sortants et sortis, l'entreprise a constaté que l'expérience, l'histoire était importante dans la gestion d'une entreprise. L'entreprise essaie de rétablir la pyramide des ages.
Dans le secteur social, notamment associatif, les associations à vocation sociale sont des structures crées par des militants pour faire face à des carences de l'État financées par des fonds publics. Nous sommes sur un modèle très paternaliste et familial, où la professionnalisation n'est apparue que très récemment, et vivement contestée par les militants qui voyait la professionnalisation une implication qui ne serait pas la hauteur des difficultés à résoudre.
Sur la question des directeurs, on observait des directeurs de fait (militant avec expérience certaine) qui animaient des équipes, un peu sur le modèle familial.
En 1973, on introduit "l'économique" dans le travail social, notamment avec la loi du 30 juin 1975 qui reconnaît et organise les institutions sociales, réformée par la loi du 2 janvier 2002 .
En 1980, apparaît le terme des entreprises du social. Ce que l'on appelle aujourd'hui des institutions sont aussi des entreprises avec un but à atteindre, des budgets, du patrimoine et du personnel à gérer et à former..
Le CAFDES est le premier diplôme pouvant répondre à ces nouvelles exigences. Ce diplôme en priorité ouvert à des acteurs du social, cherchent maintenant des candidats de tous secteurs confondus. Ceci afin de prévenir la pénurie de cadre dans ce secteur.
Un autre diplôme très récent le CAFERUIS : Certificat d'Aptitude aux Fonctions d'Encadrement et Responsabilité d'Unité d'Intervention Sociale
Dans les années 2000, et notamment avec la loi du 2 janvier 2002, qui engage les institutions sur la recentration auprès des usagers et sur la qualité du service rendu auprès des ces publics.
La responsabilité des cadres est renforcée.
![]()
le 4/11/04
Dans nos sociétés modernes, la question du lien social se pose dans la mesure où l'individualisme est de plus en plus prégnant.
PLAN
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dans nos sociétés pleines de changements, il est assez difficile de garder des repères traditionnels et de les transmettre aux générations suivantes. Les changements affectent le rapport entre l'individu et la Société donc le lien social.
Quels sont ces changements ?
C'est une Société où l'individu prime sur le groupe (valeur d’autonomie et de liberté), et c'est aussi une société de massification (masse de consommation, de consommateurs).
C'est une société où le rapport au travail est différent ou le temps libre devient de plus en plus important. Le travail devient le moyen de faire autre chose.
Nouveau rapport au travail, nouveau rapport à la migration donc à la nation.
C'est une société de migrations, c'est à dire traversée et questionnée par les phénomènes migratoires.
Le rapport à l'institution est de plus en plus questionné. Le "mariage" est remis en cause, le sens de la famille est à reconstruire.
Nous sommes dans une société fragmentée ou les microsociétés s'oppose aux classes sociales, mais où les moyens de communications deviennent de plus en plus important.
Ces éléments de changements semblent plus désintégrateurs, plus désaffiliant que réunificateur.
Société moderne suffit largement pour dire que nous ne sommes plus dans une société traditionnelle, en opposition à une société post-moderne qui aurait été marquée par une rupture importante dans développement.
Norbert Elias qui a écrit : La société des individus - ed fayard 1991
La civilisation des mœurs - poche février 2003
Dans son livre sur "La société des individus", Elias écrit qu'il ne faut pas opposer la société et les individus, car il n'y a pas d'individus sans société et réciproquement. Il y a une nécessaire articulation ente la société et l'individu.
Chaque individu subit ou profite d'une éducation qui inculque repères, valeurs qui sont autant d'éléments ayant pour origine la société.
Le philosophe Gilles Lipovetsky a écrit :
L'Ere du vide,1983 Le Crépuscule du devoir, 1992 et L'Empire de l'éphémère sont disponibles en Folio
Il est proposé à travers la lecture de "l'Ere du vide", 2 lecture l'un positive et la seconde moins optimiste.
Lipovetsky écrit c'est une ère de l'individu, une ère de consommation et de la consommation de masse, où le choix est sans cesse offert et omniprésent. Mais il est impossible de tout choisir devant tant de profusion. Nous donc obligés de faire des choix. En faisant des choix, il y a donc nécessité de s'identifier, c'est à dire de s'interroger sur qui on est !
La lecture pessimiste est que de cette consommation et de cette masse, rien n'est créé, rien n'est apporté, il ne reste que le vide.
Dans le crépuscule du devoir, il lie l'individu aux valeurs du marché, où la société individualiste ne serait plus fondatrice de valeurs morales, mais se trouverait plutôt dans l'éthique, où chaque individus construit son propre système de valeurs. Nous sommes donc dans une société éthique et hédoniste (culture du beau) où l'on travaille pour son épanouissement personnel, ou l'on est en cohérence avec ses sentiments, où la notion de plaisir est importante.
Nous sommes dans l'intolérance jusqu'à l'indifférence
Louis Dumont , anthropologue Homo Hierarchicus, Homo Aequalis
A théorisé l’individualisme en opposant la société de la hiérarchie (castes en Inde) à la société de l’individualisme qui prône et essaie de mettre en œuvre les principes de l’égalité et de la liberté.
Cette société individualiste est arrivée par l'économie libérale (le chacun pour soi). C'est la pensée économiste du 19éme siècle, (amorale) qu'est née la pensée individualiste.
La société traditionnelle hiérarchique est basée sur la propriété foncière et immobilière (au sens de terre) et la société individuelle sur la propriété mobilière, l’argent et les actions.
A.Touraine sociologue, a beaucoup travaillé sur les mouvements sociaux des années 70, qui semblent ne plus exister aujourd'hui a cause peut être de l'individualisme. Touraine traite l'individu comme sujet, ou le sujet est conscient, responsable et ne dépendant que de lui-même, absolument pas déterminé par l'environnement social, le sujet acteur. Cela rejoint la théorie du personnalisme.
"Si la société individualisée n'est pas capable de promouvoir le sujet, alors la société serait en déclin.
Ces modèles théoriques sont déterminés par le courant historique.
La notion d’individus a beaucoup d’acceptions.
Dans cette société individualiste, il n'y a pas disparition du lien social mais transformation.
Définition du concept : outil théorique, chargé de théorie, qui permet d'interroger la réalité
Différence entre communauté et société
Le lien social de la communauté est caractérisé par des liens affectifs et des liens de proximité
Le lien social de la société, c'est du lien qui vient essentiellement par le travail, quand notre société a commencé son industrialisation.
Chez Emile Durkheim, il y a opposition de la communauté à la société. La communauté est régie par des liens affectifs et de proximité et dans la société, ce sont des liens d’industrialisation et de liens liés au travail.
Quand une société s’industrialise, les liens d’individualisation s’accentuent et la communauté s’efface. La communauté se rapproche de la société traditionnelle. (cf. société mécanique et société organique).
Quand des groupes sociaux d'origine étrangère viennent en France, ils tentent de reconstituer des communautés.
Selon C.Camillière, il n'est pas possible en France de transposer des communautés issues des sociétés traditionnelles, car tout s'oppose au phénomène de communauté en raison du mode de vie français centré sur l'individu.
Selon C.Camillière, il y a communauté que lorsque l'on est dans un groupe à configuration totale, c'est à dire lorsqu'il y a autosuffisance du groupe social, c'est à dire que toutes fonctions d'une société sont remplies, et qu'il y en plus communion, adhésion, sentiment d'appartenance, représentation de valeurs communes et fusion et suffisance économique..
En raison de ces critères, il existe fort peu de communautés.
L'identité collective sont des liens d'appartenance et/ou de ressemblance, de représentations collectives et souvent une conscience collective (sentiment d'appartenance). Ce sont des liens moins fusionnels que pour la communauté.
Ces liens peuvent s'ancrer dans une mémoire commune, projets communs et valeurs partagées, une culture commune et un territoire (d'origine ou présent). Par exemple l'identité ouvrière de la banlieue rouge ou tous les ouvriers travaillaient dans la même entreprise, côtoyaient les mêmes lieux de rencontres et de loisirs, adhéraient au même parti ou syndicat dans lequel ils menaient le projet de la lutte des classes.
Les identités collectives se désagrègent dès lors que l'objet central disparaît, comme dans le cas ou l'usine ou que les mines ferment.
Le lien social à travers le réseau
le Réseau, ce terme est venu du ferroviaire, d'internet constitués de nœuds de liaisons.
C'est un lien social plus lâche que celui de l'identité collective, et encore plus éloigné des communautés. C'est un lien labile, distancié par l'informel, fait de distances. Il n'a pas besoin de territoire, mais il se fonde, sur une appartenance et une histoire commune. A une caractéristique : il n’a pas besoin de territoire.
Il existe les réseaux relationnels et les réseaux autocentrés (le réseau des motards avec ses rites, ses codes).
La caractéristique d’un réseau est que cela renvoie à des individus, chaque individu pouvant appartenir à différents réseaux.
Chaque individu possède une série de réseaux
![]()
le 18/11/04
Module : Histoire du Travail Social
Mise en perspective historique de l'action sociale liée à l'assistance (suite)
Rappel du plan de ce Module:
Le travail social est déterminé structurellement par trois formes d'assistance qui s'est constitué successivement :
1. La redistribution
2. La charité
3. L'intervention sociale
Redistribution
L'économie de la réciprocité est la source de la pensée structuraliste, parce que, selon Mauss "Quelles sont les règles de droit et d'intérêt dans les sociétés traditionnelles, fait que le présent reçu est obligatoirement rendu ?" - "Quelle force il y a t-il dans les choses que l'on donne pour qu'il y ait obligation de rendre ?"
Dans le Potlach, on trouve une notion de crédit qui est une forme archaïque, mais noble d'un marché sans marchand. C’est une marchandise singulière : l’honneur.
Dans le "Potlatch ", c'est l'échange qui créer l’alliance et ceci détermine le statut.
Les produits de l'activité sociale sont rendus comparables entre eux s'ils ont en commun un caractère comparable d'être transférable selon les modalités réductibles à des formes plus fondamentales comme l'Amour, l'estime, l'argent.
L’échange dans le Potlach est un fait social, c’est en quelque sorte la première forme de contrat social.
1) Société ou faire société ont des sens symboliques
2) La vie sociale est le produit rationnel de l'homme
Les Trois formes de redistribution à retenir
1) la famille au sens de foyer "oikos" ð Economie, parentèle.
Chaque membre composant la famille contribue à son niveau dans la famille ð Principe de la solidarité primaire.
A l'extérieur l’aide est proportionnelle au degré de parenté.
2) Le clientélisme ð Réseau de services ou dettes réciproques. Relation liée par contrat. Moyen efficace de promouvoir son prestige.
Le principe tient dans l’offre d’un présent qui ne peut se refuser.
« Pratique bien connue de la mafia ».
3) La munificence ð Ancêtre paradoxale de la catégorisation. Neutralisation de la puissance grégaire – Moyen de contrôle et d’affirmer sa supériorité sur les plus pauvres. Elle permettait de contrôler et gérer les foules, le peuple (les jeux du cirque dans l'antiquité.
Nous ne sommes pas dans une société holiste.
Dans une société holiste, le groupe prime sur l’individu et, la question du rang et de l’honneur y est important. Dans ces sociétés holistes où le consensus social se fait autour du cercle, de la communauté, la coutume peut devenir un dû. Par exemple, une réclamation des pauvres lors d’un mariage.
Elle se situe dans la période ou le christianisme prend son essor et triomphe à la fin du moyen age. Avant cette période la charité était facultative. Avec le christianisme, la charité devient le principe cardinal de la morale chrétienne. La charité point de vue global trouvant son essor dans la sphère centrale du théologique qui va s'exprimer jusqu'au 16éme siècle.
La charité se décline sous deux modes d'exercices :
1) l'aumône
Relation personnelle, originale et particulière, dans la mesure où il n'y a ni délimitation préalable des bénéficiaires, ni exigence de la réciprocité (Dieu nous le rendra). Incarne l'action du Christ.
Permet ou exige une extension indéfinie de la reconnaissance. Acte gratuit, obligation pour le riche.
Légitimation de la mendicité.
2) L'institution
Médiation de l'aumône, ces ressources viennent de donations. Elle apparaît au moment de la montée du christianisme.
Elle pour fonction de:
|
|
· Réparer les injustices les plus criantes |
|
|
· Prévenir des fléaux des hommes (guerres) ou de la nature (épidémie). |
Nécessité de développer une cohérence institutionnelle de la charité et en fait un appareil politique. Les institutions religieuses se multiplient et se structurent. La charité secoure les pauvres mais n’éradique pas la pauvreté. Ambivalence de la charité chrétienne par le fait qu'elle ne vise pas l'intérêt du pauvre mais le salut de l'âme du donateur – Rachat des péchés – La pauvreté fait partie de l’ordre social et échappe à la conscience morale. Résignation de son état de pauvre, c’est une humilité.
III. L'intervention sociale
Représenter et nommer une société ð Ensemble d’individus considérés comme un tout
ðConception du corps social au XVIII siècle.
Traduction du corps social – Politique – Etat – Nation.
La société ne doit plus être tenue par l’ordre sacré et par une constance naturelle
( Métaphore du Corps)
Nouvelle représentation : On passe de la toute puissance théologique au politique – Organisation rationnelle qui va permettre une emprise sur la société fin XVIII siècle avec en plus l’émergence de l’idéal de justice et d’égalité.
Trois logiques d ‘Assistance
1. L’unification
Pourquoi ? Renforcer la cohésion de l’édifice social
|
|
|
|
||
|
|
L’unification comme 1er référent la Nation. Rapprocher les hommes qu’éloignent tant de passions et de préjugés « Voltaire. Le politique est le mécanicien si la société est un corps. Objectif de restaurer, polir, de socialiser cette société déviante. Ergonomie du politique. Il en découle une première forme de l'intervention sociale effectuée par les notables qui font de "l'assistance charitable" et par l'Etat utilisant des systèmes solidariste ou mutualistes.
|
|
||
2) L'éducation
Apparaît comme une nécessité de prévention. Nous sommes en même temps dans le processus de laïcisation
La société est un ensemble fini d'individus ou chacun représente une richesse qu'il ne faut pas gaspiller, qu'il faut donc soigner. Principe Malthusien .
C'est la naissance des grands courant hygiénistes qui ont pour rôle de lutter contre les grandes maladies ou épidémies.
La société développe un souci de prévention, de prévoyance, de préservation.
C’est le début des caisses de mutualisations, de prévoyance.
« La charité est satisfaite lorsqu’elle a soulagé l’infortune. Le philanthrope ne peut l’être que lorsqu’il l’a prévenue. »
Cette prévention se diffuse à travers tous les groupes territoriaux, sous la forme de fêtes révolutionnaires civiques "Au nom de la nation"ou circulent les "Gazettes", ou le peuple accède aux loisirs par le biais des bals populaires.
La loi 1901 qui fonde les associations est le vecteur des sociétés de secours mutuels. Ce sont autant de lieux ou la circulation de l'information à caractère éducatif circule.
Les enfants par le biais de l'école, avec entre autre l'apprentissage d'une langue commune, qui facilite d'autant la transmission de l'information préventive.
La rééducation a pour fonction la prise en charge de la marginalité et de la différence, notamment chez les adultes dans un souci de réintégration.
3) La science
En 1825,l’intervention sociale devient une affaire de spécialistes.,
Etre capable d’évaluer les maux auxquels il faut apporter des remèdes, de calculer les modes d’interventions.
Il y a injonction de spécialisation et de professionnalisation qui condamne le bénévolat.
Cette spécialisation va en tirer sa légitimité à travers le corps social. Connaissance sur le terrain, d’une cohérence des interventions et de la maîtrise des moyens, champ de la technicité.
Dans la succession des ces trois formes (redistribution, charité et intervention sociale) il est à noter que chacune critique la précédente sans pour autant la remplacer.
Certains modes peuvent coexister avec l'intervention sociale comme par exemple la charité qui se pratique encore de nos jours.
L'attribution d’une signification doit être minimisée au risque de lui donner une signification erronée. Il n’y a pas de vérité ni d’objectivité en sciences sociales hormis les notions de contrôle et d’évaluation.
![]()
Module : Les mutations de l’interprétation jeudi 18 novembre 2004
Référence à la * maïeutique :
Platon, dans le Théétète, met en scène SOCRATE, déclarant qu’en sa qualité de fils d’une sage-femme et lui-même expert en accouchements, *il accouche les esprits des pensées qu’ils contiennent sans le savoir. PLATON le représente mettant en pratique cette méthode dans plusieurs dialogues, notamment dans le Ménon. Ce terme est resté usuel pour désigner, souvent une nuance d’ironie, l’art que SOCRATE disait pratiquer.
Problématique :
Caractère d’un jugement ou d’une proposition qui peut être vraie ( = qui est peut être vraie) , mais que celui qui parle n’affirme pas expressément. KANT en donne comme exemple l’attitude de l’esprit à l’égard des propositions élémentaires qui forment une proposition hypothétique ou disjonctive. « S’il y a une justice divine, le méchant sera puni.» - « Le monde est soit l’effet d’un hasard, soit celui d’une cause extérieure, soit le produit d’une nécessité interne. » Aucune de ces propositions, considérées séparément n’est affirmée : chacune d’elles est considérée comme assertion qui pourrait être soutenue.
Au sens courant : Douteux qui est affirmée gratuitement, sans preuves suffisantes, et que par suite, on doit considérer comme restant en question.
La problématique doit être comparée à un moteur de recherche ðComparaison à d’autres systèmes ð Questionnement sur un système que nous observons.
Toute ritualité peut être source d’aliénation et d’interprétation.
En effet, cette notion de ritualité est source de comportements codifiés encrés dans l’ordre de la répétition ð Système des valeurs encodés dans la ritualité.
Nous agissons par principe de rituel ( règles et habitudes ) encré dans des traditions et notre propre interprétation.
C’est pourquoi, afin d’effectuer une mutation de l’interprétation, il nous faut interroger nos habitudes et nos rituels. Rechercher les valeurs pour comprendre les habitudes car dans l’habitude, il peut y avoir ritualité.
mutation de l’interprétation comme processus d’échanges des cultures.
Toutes ritualités portent en elle une compréhension des valeurs de la société.
Il est important de savoir distinguer ce qui est de l’ordre du Rituel ou de l’habitude ( ex : le rituel du repas ≠ des habitudes alimentaires.) Le sociologue a pour objet principal de questionner les habitudes.
La parole a pour objet de détecter les représentations ð Référence à la Maïeutique.
La mutation de l’interprétation chez l’enfant : Changement du regard de l’enfant sur le monde, quand du passage à l’acte il en vient à verbaliser sa pensé.
Le travail éducatif est un métier de linguiste
Construction d’une Interprétation :
· Elle se décline en 3 étapes :
1. représentation : Expression d’images, de mises en scène, de situations
2. distribution : Observations de faits dans un espace temps
3. Attribution du sens : Par la prise en compte d’habitudes et de rituels
Il est à noter que la puissance symbolique caractérise une ritualité
Comprendre les valeurs en partant d’un rituel va nous permettre de saisir la valeur contraire - Antagonisme des valeurs.
Si je veux retrouver une liberté de penser, il me faut détecter dans l’habitude la valeur et son contraire.
Ex : c’est l’injustice qui me permet de penser la justice
Le christianisme : Dieu est incarné en chacun, chacun est souverain.
L’égalité est aussi une valeur chrétienne.
Religion musulmane : la puissance divine est extérieure. L’humain est dans sa communauté. Fondements très différents du christianisme.
Les mutations collectives de l'interprétation
Le concept d’appartenance à une nation qui pour sa sauvegarde on envoie, 1 million d'hommes se faire tuer sur les "chemins des dames". Exemple extrême d'une interprétation collective. Le deuil de cette "interprétation" n'est pas fait et demeure tabou. On commence depuis peu à en informer les nouvelles générations. On y voit les prémisses d’une mutation où la puissance symbolique de la nation est en mouvement « changement ».
Les mutations des représentations s'effectuent avec beaucoup de discernements, parce qu'elles sont en corrélation avec les habitudes et les ritualités. La mutation du sentiment du religieux s'est effectué en 1905 avec la loi concernant la séparation des Églises et de l'État.
La notion de foule transcende les conduites individuelles mais il est difficile d’affirmer qu’il s’agit bien d’une conduite collective. Quand on est dans une foule, on n’a pas forcément conscience de la conformité dans laquelle on est.
Ex : Dans les stades, certains groupes d’individus n’ont pas de mémoire et l’on peut observer une substitution de la conscience individuelle sur le collectif. La ritualité de la foule s’impose à eux.
Articulation entre les interprétations individuelles et collectives
Nous pouvons observer un lien entre l'interprétation individuelle et collective
Ex: la loi sur l’avortement a générée des changements collectifs et des changements individuels. Françoise Dolto avec ses différents travaux sur l’enfant a influée les comportements.
La notion de progrès implique des changements sociaux et génère des mutations de l’interprétation donc un changement de regard sur notre société.
Réfléchir aux mutations, dépend de l'importance que l'on attribut au passé. il est important d’apprendre à s’arrêter et de regarder le monde du passé.
![]()
Module : Elaboration de l'objet social Le 25 novembre 2004
Les âges de l'intelligence.
1. Elaboration de l’objet Social / Question de regard sur le Monde
2. Interprétation de l’Objet social / La Pensée comme outils d’élaboration et de construction
I- Elaboration de l’objet Social
Comme nous l’avons déjà vu, dans les sciences sociales, il n’y a pas de faits, il n’y a que des interprétations. Hypothèse antagoniste avec les théories de E Durkheim qui avance qu’il faille poser les faits comme des objets. Il tente par ce principe de ramener l’objet social à un fait.
Comment construit-on un objet dans le champ social ?
L’objet social procède toujours indissociablement du regard du sujet qui tente de le saisir. C’est donc en partant de cette détermination réciproque par l’esprit, d’une interaction de vérité relative entre l'objet et le sujet qu’une construction pourra s’élaborer pour se construire.
Définition de l’Epistémologie :
L’épistémologie désigne la philosophie des sciences, mais avec un sens plus précis. Ce n’est pas proprement l’étude des méthodes scientifiques, qui est l’objet de la méthodologie et fait partie de la logique. Ce n’est pas non plus une synthèse ou une anticipation conjecturale des lois scientifiques (à la manière du positivisme et de l’évolutionnisme). C’est essentiellement l’étude critique des principes, des hypothèses et des résultats des diverses sciences destinées à déterminer leur origine logique (non psychologique), leur valeur et leur portée objective. On doit donc distinguer l’épistémologie de la théorie de la connaissance, bien qu’elle en soit l’introduction et l’auxiliaire indispensable, en ce qu’elle étudie la connaissance en détail et a posteriori, dans la diversité des sciences et des objets plutôt que dans l’unité de l’esprit.
La validité scientifique ne peut se vérifier que dans le contrôle des interprétations en l’inscrivant dans cette méthodologie :
· Distribution
· Représentation
· Attribution du sens de la signification
Posture des différentes conceptions de pensées à travers l’Histoire
Moyen Ages
Les scolastiques considéraient l’objet comme totalement extérieur au monde qui l’entourait.
Réalisme – Chosisme qui vient postuler une rupture entre la forme et la matière-la forme et l’esprit et la forme et la nature.
XVI et XVII siècle
Emergence des sciences et des techniques ( loi de l’optique). Règne de la Métaphysique. L’homme a tendance à être considéré comme un automate. Nous sommes dans un modèle Positivisme et machiniste. (référence à Pascal et Descartes)
Fin XVIII Siècle
Kant Philosophe Normatif signifie que l’objet et le monde est une conception théorique de l’entendement ou la nature doit se plier au cadre de la raison. Le monde n’est plus une vérité copique mais une vérité codique. Il faut entendre que le monde se trouve désincarné et vidé de sa substance.
Vision moderne de l’objet
Affaire de Dialectique – Conception moderne de l’objet d’HEGEL.
Mouvement de dépassement de soi - Tout savoir est un dépassement de soi. De part ce concept, HEGEL abolit l’opposition de savoir pur et d’objet vu comme un « en soi ». Processus de l’expérience. Terme antagoniste. Par l’expérience j’accepte de modifier mon savoir pour l’adapter au monde.
Déterminalité du monde – Capacité à se transformer, logique du vivant, logique du social. Par ce processus d’expérience l’objet devient un être vivant pour soi et pour l’autre, ce qui implique des notions d’interactivité et structurelle. Cela introduit une intention aux phénomènes, un rapport à l’altérité et une croyance dans le dynamisme des objets et du savoir.
XVIIII Siècle : Essor du Positivisme
Spécialisation des disciplines scientifiques (Médecine, Mathématique, Physique, Astronomie)
Epistémè du Positivisme : La configuration du savoir rendait possible les différentes formes de sciences à une époque donnée. Socle à partir duquel on pense, on sent, on agit. Logique principale pour ordonner, hiérarchiser des priorités. C’est un modèle de pensée théorique que l’on retrouve dans bien des disciplines.
Dans l’Epistémè du positivisme on est dans la mise à mort du théologique des causes formelles.
Relation constante ð C’est le monde qui donne les lois : donc apparition d’une corrélation entre l’objet et les méthodes. C’est la conséquence des résultats qui va devenir le gage de toute objectivité. Auguste COMTE fondateur de la sociologie Positivisme.
Karl POPPER – A une conception divergente et argumente en disant qu’un modèle est crédible seulement quant il est falsifiable. La science doit être considérée comme un creuset de connaissances destiné à être dépassé.
Risque et Conséquences : Imposer aux faits sociaux leurs méthodologies et l’Epistémologie. Selon Max WEBER les faits sociaux ne doivent pas être considérés comme des choses. Actuellement on considère que l’objet est un réseau de relations, un ensemble de connaissances destinées à être dépassés.
Par cette théorie Max WEBER fait émerger un nouveau courant de pensée appelé déterminisme. La détermination d’un objet ne renvoie pas à une définition conceptuelle mais à une définition provisoire de limite pour la recherche, puisque la science est une notion non finalisée. Dans son cas contraire, il nous faudrait considérer l’objet comme un dogme.
BOUDON créer le concept d’effets pervers. Il s’agit d’un effet de composition contraire à un but recherché.
Méthode de comparaison, de relativité et de distanciation critique.
Objet et Méthode ð Méthode et objet
Pour Claude Levi-STRAUSS précurseur du structuralisme, la forme ne peut se dissocier du Fond.
« Race et histoire (1952) Introduction à l’œuvre de MAUSS (1952) , triste tropiques(1955) Entretien avec Georges CHARBONNIER, les structures élémentaires de la parenté, Anthropologie structurale. »
(Ex Victor HUGO « Le style s’est l’homme ») Il exprime incarne le fond.
Autres courants de pensées
« Phénoménologie de la perception ( 1945 )- Les sciences de l’homme et la phénoménologie(1953)… »
Phénoménologie : objet indissociable de la Noèse « Acte même de la connaissance » indissociable du mode de perception.
Noème : Objet perçu, représenté, construit dont le sens et la réalité sont indissociable. Il y a toujours une identité partielle entre le sujet et la connaissance.
II L’Interprétation
Méthode : 1er acte d’interprétation participe à 4 grands domaines
1. Le sensible
2. La représentation
3. La Distribution
4. Attribution de la signification
Représentation : Fondement du regard sociologique acte 1er de la fondation scientifique donner un sens – Acte de l’esprit qui tente de rendre intelligible les êtres et les choses en introduisant de la rationalité. Lecture des formes du phénomène. Acte de connaissance qui commence par un acte d’ordonnancement.
L’idéologie : Projection de grande représentation collective. L’idéologie n’appartient pas à la science.
Jean BAECHLER : « Qu’est ce que l’idéologie »
Les 5 fonctions qui en découlent
1. Fonction vise le ralliement. Fonction consensuelle
2. Fonction vise la justification( Vérifier, confirmer, infirmer) Multiplication des propositions idéologiques.
3. Fonction qui vise le voilement « La plus connue » Système de représentation idéal typique -opération de lois verbales ou écrites.
4. Fonction qui vise à la désignation et du marquage – Système normatif, système de hiérarchisation des valeurs.
5. Fonction qui vise à l’instrumentalisation du réel . Donner une image de la société simplifiée.
III LA DISTRIBUTION
Saisir les relations entre les phénomènes aléatoires et leur fréquence. Compréhension de la répartition d’un phénomène social dans l’espace, le temps et le nombre. L’interprétation se réduit au choix de la méthode avec au préalable une représentation de l’objet.
IV ATTRBUTION DU SENS DE LA SIGNIFICATION
Mettre en comparaison ou en rapport avec d’autres phénomènes et ce afin d’établir une proposition du sens. Pas systématiquement de causalité simple de rapport de causes à effets.
Donner du sens ð Elaboration ðSuspendre la réponse en interrogeant tous les liens de causalités.
La représentation est le 1er accès à un certain savoir sur l’objet.
La morphogenèse du regard permet de formaliser la forme et le concept, est un outil pour clarifier des représentations.
Les différences entre la notion de masse et de foule
|
Masse |
Foule |
|
Flux d’individus Ensemble d’individus sans relation Forte connotation individualiste Passivité et indifférence Mouvement centrifuge
|
Corps collectif et fusionnel Suggestibilité collective Sentiment d’appartenance Transgression Mouvement centripète |
![]()
Module : Modèles d’interprétations Le 25 novembre 2004
Epistémè : Modèles théoriques transversaux
Epistémologie : Rupture courant théorique « Foucault »
Paradigme : Modèle théorique en lien à une communauté scientifique – Convergence de pensée. Thomas Kuhn
Faire le lien entre l’état d’une société et le modèle théorique émergeant. Les liens peuvent être de dimension politique, économique, technologique et scientifique d’une société. Chaque modèle théorique vient d’une discipline et d’une philosophie sous jacente.
Repère de modèle philosophique dans une théorie.
Idée de généalogie – Inscrire les modèles théoriques dans un modèle généalogique.
I Cadre de Repère : Chaque époque doit être considérée comme une référence.
| 18ème siècle : Référence au Contrat social | |
| 19ème siècle : Référence à la notion de communauté et de lien social – Idée d’unification et de nation. | |
| 20ème siècle : Référence à la notion d’acteur. |
| 1er Modèle : Le Positivisme Auguste COMTE – Doctrine qui rejette la métaphysique pour ne s ‘attacher qu’aux phénomènes et aux lois qui les régissent. Le positivisme cherche à atteindre l’unité de la pensée en partant des données réelles. |
Discipline : Physique, Astronomie et Machinisme.
Positivisme logique : Doctrine de l’école de Vienne, selon laquelle la vérification par l’expérience est le seul critère de la vérité.
· 2ème Modèle : Le Fonctionnalisme E DURKHEIM – (Positivisme transformé)
· 3ème Modèle : Idéologique Issu du Marxisme – Pierre BOURDIEU
· 4ème Modèle : Sociologie Compréhensive - Max WEBER - Compréhension et idéal type sont les deux notions qui guident le sociologue dans sa recherche.
· 5ème Modèle : Structuralisme –Claude Levi - STRAUSS – Développement de la linguistique.
· 6ème Modèle : Contemporain Pierre BOURDIEU – Individualiste méthodologique R BOURDON
· 7ème Modèle : Théorie de l’acteur Michel CROZIER – l’Acteur et le système
· 8ème Modèle : Courant Pragmatique LA TOUR – Paul RICKER philosophe
Relatif l’action. Pour Kant est pragmatique ce qui concerne l’action utilitaire.
· 9ème Modèle : Ethnométhodologique
· 10ème Modèle : Interactionnisme symbolique
Jusqu’au 17ème siècle toutes explications étaient religieuses partant d’un socle de pensées religieuses.
Courant 16ème siècle, début de la laïcité et prémisse d’une pensée politique. Nicolas MACHIAVEL (1469 –1527) – Ecrit en 1513 et publié en 1531 le Prince ; Il tenta une analyse scientifique de la société. S’il préconise l’hypocrisie ou l’immoralité comme moyen de gouvernement, c’est parce que, dans un pays réduit à l’immoralité, pays qu’il faut sauver, le prince ne doit reculer devant aucun moyen. Secrétaire du gouvernement florentin, le retour des Médicis au pouvoir en 1512, le conduisit en prison.Il fut torturé et dut se retirer des affaires publiques.
Jean BODIN Né à Angers en 1530 et mort à Laon en 1596 – Il écrit La République 1576
Analyse de plusieurs formes de pouvoirs :Monarchique, Démocratique, Despotique.
Il fit profession dans l’ordre des carmes, et se consacra surtout à la théorie politique. Il tenta d’associer l’étude du droit et celle de l’histoire, et réfuta MACHIAVEL. Il s’efforça de justifier la monarchie absolue par le droit romain. Sa doctrine politique réclame une monarchie tempérée par les Etats généraux. En philosophie, il se rattache au courant platonicien. Il fut aussi économiste.
Thomas HOBBES Né en 1588 à Malmesbury et mort Hardwick en 1679 – Il écrit en 1654 Léviathan
L’œuvre de HOBBES est une théorie et une apologie fort logique du despotisme. Toutes les substances sont corporelles et la vie est mouvement. Le désir, fondement du monde animal est égoïste et guidé par l’intérêt. Il n’y a ni amour ni accord possible entre les hommes. Ceux ci sont naturellement insociables et méchants. L’Etat nature, c’est la guerre de tous contre tous. Mais les hommes, qui considèrent que la paix est le plus grand des biens, confèrent tous leurs droits à un seul souverain. Ils remplacent l’ordre mécaniste naturel par un ordre mécaniste artificiel, qui leur convient mieux : C’est l’Etat. Le salut de l’Etat s’identifie avec le salut du souverain. La souveraineté absolue d’un seul homme créer un déséquilibre qui, assure la stabilité. Le souverain établit les lois et définit la justice se plaçant ainsi au-dessus d’elles. Le bien et le mal dépendent de ses décisions. La vraie religion est celle qu’il autorise. Ainsi les hommes sont libres et heureux, puisqu’ils peuvent agir à leur gré dans le cadre des lois. Il dit que le souverain absolu n’est pas un tyran arbitraire ; le tyran est l’esclave de ses passions, alors que le souverain en est délivré par le caractère absolu de son pouvoir. Car les passions résultent de la finitude humaine. En somme le pouvoir du souverain est légitime parce qu’absolu. La pensée de HOBBES a eu une influence incontestable sur HEGEL.
John LOCKE Né à Wrington en 1632 et mort à Oates en 1704 –1690 Traités du gouvernement civil. « Fondement de la pensée politique. »
LOCKE réfute la thèse des idées innées ; Toutes nos idées viennent de l’expérience : Idées de sensations, perçues par les sens ; Idées de réflexions qui sont la faculté de notre âme, et même l’expérience par intuition. Ces idées sont fixées par une lumière naturelle raisonnable. Religieusement très tolérant, LOCKE est l’artisan d’un système dont la base est la loi de la nature humaine, qui est une loi de raison est qui est le principe même de l’existence de l’homme. L’homme a des obligations résultant de sa propre liberté. L’homme n’est libre que parce qu’il est raisonnable. Nous ne pouvons tout savoir, nous ne pouvons avoir aucune idée des substances des choses. La philosophie pratique de LOCKE aboutit à une véritable théorie du libéralisme politique. Toute communauté politique est fondée sur le consentement libre de ceux qui s’y engagent. L’homme a le droit de défendre sa liberté individuelle. Le pouvoir absolu arbitraire est condamné, car il se dresse contre loi de nature et engendre l’état de guerre. C’est la raison qui doit présider à l’accord de la morale avec la politique.
Jean Jacques ROUSSEAU Né à Genève en 1712 et mort à Ermenonville en 1778.- Il écrit en 1762 Du contrat social.
Sa philosophie n’est pas un système, mais une vision de la condition humaine. – Contrairement aux Encyclopédistes, l’homme, pour ROUSSEAU, est naturellement bon et juste. Il fut heureux lorsqu’il vivait sans réfléchir, au milieu de la nature, uniquement préoccupé des soins matériels de la vie quotidienne. Puis il a cherché à paraître, dominer. Il a inventé la propriété. Sont venus l’inquiétude d’esprit, le goût du luxe, l’ambition, l’inégalité, les vices, la philosophie. La société a corrompu l’homme en l’élevant à la moralité. La vie idéale n’est pas le retour à la vie nature, mais elle doit se rapprocher le plus possible de la vie naturelle. C’est le cœur qui fournit à l’homme la preuve des vérités morales et religieuses, qui lui permet de goûter aux plaisirs de la générosité, de la bienfaisance, de l’amitié. L’enfant est naturellement bon, doit être éduqué de façon « négative ». Il faut laisser libre cours à son propre développement. ( Référence à l’Emile ou de l’Education 1762).
Rousseau prône les vertus de l’intuition et de l’émotion. – Le fondement de toute société, c’est le contrat social, par lequel chaque contractant renonce à sa propre liberté au profit de la communauté et se soumet à la volonté générale. Rousseau pose ainsi le principe de la souveraineté populaire.
Tant en littérature qu’en philosophie ou en politique ( la Révolution française le revendiqua), l’influence de ROUSSEAU fut considérable. Il a véritablement transformé la sensibilité humaine.
MONTESQUIEU ( Charles-Louis de Secondat, baron de). Né au château de La Brède, près de Bordeaux en 1689, mort à Paris en 1755.
Œuvres principales : Les lettres persanes ( 1721), Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence(1734), l’Esprit des lois (1748).
Président à mortier au parlement de Bordeaux en 1716, il voyagea en Autriche, en Hongrie, au Tyrol, en Hollande et passa deux ans à Londres. Puis, il se retira pour se consacrer à son œuvre. Il mourut presque aveugle. Il s’intéressa aux sciences naturelles, à la physique, à la médecine, à l’histoire à la politique à la morale, et donne l’exemple d’une vie parfaitement équilibrée. – En se livrant à une critique magistrale des institutions de son temps, il a saisi l’importance fondamentale de la liberté. Mais, pour ne pas être destructrice et négative, la liberté doit avoir sa base dans les institutions politiques. L’étude de l’histoire Romaine et son voyage en Angleterre ont fortement influencé MONTESQUIEU.
L’essentiel de sa pensée se trouve défini ainsi par lui-même :
« Les lois, dans la signification la plus étendue, sont les rapports nécessaires qui dérivent la nature des choses …Ceux qui ont dit qu’une fatalité aveugle a produit tous les effets que nous voyons dans le monde, ont dit une grande absurdité ; car quelle plus grande absurdité qu’une fatalité aveugle qui aurait produit des êtres intelligents. Il y a donc une raison primitive ; et les lois sont les rapports qui se trouvent entre elle et les différents êtres, et le rapport de ces différents êtres entre eux. »
a) Despotisme fondé sur la violence et la crainte
b) Monarchie fondée sur l’honneur et les hiérarchies
c) République où le peuple est souverain.
Théories des climats : MONTESQUIEU s’interroge sur l’esprit général des nations – Institutions, droit, commerce, religions, coutumes, Mœurs donc sur la notion de culture des Nations. Prendre l’ensemble des composants d’une culture et le corréler au politique et au sociologique.
B) Du politique à l’économique
Apparition d’une Pensée Economique milieu 18ème siècle. Sorte de mutation entre la pensée Politique et Economique. Oeuvre d’une physiocratie dont Turgot, ou *Quesnay chef des Physiocrates, théorisent une pensée économique libérale.
Dans cette pensée économique ou l'agriculture est omniprésente, les propriétaires fonciers soutiennent cette doctrine.
Des lois naturelles régissent l’ordre économique. La terre est la seule richesse. La propriété est le premier des droits naturels. La société se divise en trois classes :
1. La classe agraire
2. la classe productive
3. La classe stérile
L’impôt ne doit porter que sur la propriété foncière. La circulation des biens doit être libre. « Laissez faire, laissez passer. »
Bernard de Mondevilles, illustre à travers "La fable des abeilles » la pensée économique libérale,"laissez chacun agir pour ses propres intérêts, il en ressortira du bien commun. »
Adam SMITH né à Kirkcaldy en Ecosse en 1723 mort à Edimbourg en 1790
Œuvres principales : Théorie des sentiments moraux (1759), Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations (1776).
Au cours d’un voyage en France, il rencontra les physiocrates. Il fut surtout l’un des fondateurs de l’économie politique. La terre n’est pas la source de toute les richesses, mais le travail. Les lois de l’offre et de la demande, celles de la division du travail, doivent jouer sans restrictions.
La pensée de SMITH est très nettement libérale
Louis Dumont tente à démontrer comment une idéologie peut conditionner des savoir-faire. Il a écrit l'Homo-hierachicus, et Homo Aequalis .
La pensée individualiste serait apparue au 18ème siècle.
La pensée libérale est à l'origine de la pensée individualiste.
Il oppose les sociétés holistes (société de hiérarchies) aux sociétés libérales (individualiste).
C )La Révolution
· 1er Modèle - le Positivisme
Auguste COMTE né à Montpellier 1798, mort à Paris en 1857
Il fit ses études à l’école polytechnique, puis donna des leçons de mathématiques. Il devint secrétaire de Saint-Simon en (1817) et une brouille les sépara (1824). Il ouvrit en (1826) « un cours de philosophie positive ». Atteint d’aliénation mentale, il dut être interné quelques mois, et sortit avec la mention « non guéri ». Il reprit son cours, devint répétiteur (1832) puis examinateur en (1837) à l’école polytechnique. De 1831 à 1848, il fit un court public et gratuit d’astronomie élémentaire à la mairie du IIIème arrondissement. Séparé de sa femme, ayant perdu son emploi, vivant de l’aide de ses amis, d’un caractère de plus en plus difficile, COMTE rencontra en 1845 Clotilde de VAUX. Ce fut « l’année sans pareille ». Atteinte d’une maladie mortelle, la jeune femme mourut l’année suivante. Il l’avait aimée, ; sa pensée philosophique tourna au mysticisme, et Clotilde de VAUX devint pour lui « Sainte Clotilde » patronne de l’humanité.
Fondateur du Positivisme, A COMTE a exercé une grande influence et a fait s’élever une grande espérance dans l’humanité. Sa doctrine est encore florissante au Brésil, dont le drapeau porte sa devise politique de 1848 : Ordem e progresso. Le « culte de l’humanité », aux rites compliqués, a été institué dans ce pays. En Suède le positivisme a pris une teinte politique et sociale. A Paris, « le Temple de l’humanité » est encore fréquenté. La base du Positivisme résume dans cet aphorisme : « Il n’y a qu’une maxime absolue, c’est qu’il n’y a rien d’absolue ».
Le système présente deux aspects :
· Un aspect scientifique
· Un aspect Politique et Religieux
COMTE nie la psychologie, le droit, les relations de cause à effet. Seuls, les faits l’intéressent, c’est à dire ce que l’expérience permet de constater et de contrôler, expérience des sens, il s’entend.
COMTE a défini lui-même la loi des trois états des sociétés occidentales : « Par la nature même de l’esprit humain, chaque branche de nos connaissances est assujettie dans sa marche à passer successivement par trois états théoriques différents :
1. l’Etat théologique ou fictif
2. l’Etat métaphysique ou abstrait
3. l’Etat scientifique ou positif
Plus l’objet d’une science est simple, plus celle-ci arrive rapidement à l’état positif ; l’ordre de complexité est : Mathématiques, astronomie, physique, biologie, sociologie.
COMTE distingue les sciences abstraites et les sciences concrètes. Le but des sciences abstraites est la connaissance des lois. La science finale est la sociologie qui se divise en deux branches :
1. La statique sociale ( étude de la famille et de la société )
2. La dynamique sociale ( étude du développement des sociétés)
Les sociétés doivent être organisées de manière positive ; un pouvoir spirituel, différent du pouvoir politique, doit exister ; une classe spéculative (penseurs et artistes) doit faire face à la classe active ( agriculteurs industriels et commerçants).
Le comtisme ( et c’est ce que Stuart MILL lui reproche) ne croit pas en un créateur du monde. L’objet unique du culte, c’est l’humanité. Elle est le Grand Etre.
Le culte revêt trois aspects :
1. Public (Adoration du Grand Etre)
2. Personnel (Adoration de la Femme)
3. Domestique
Ce culte domestique, au rite minutieux réglé par COMTE dans les moindres détails comprend neuf sacrements :
· La présentation, l’initiation ( à l’âge de 14 ans)
· L’Admission (à l’âge de 21 ans)
· La Destination (à l’âge de 28 ans)
· Le Mariage, la Maturité (à l’âge de 42 ans)
· La Retraite (à l’âge de 63 ans)
· La transformation ou mort, et l’incorporation au Grand Etre, qui a lieu sept ans après la mort.
La Terre s’appelle le Grand Fétiche et l’Espace le Grand Milieu.
La Morale d’Auguste COMTE peut se résumer Brièvement : Vivre pour autrui.
Alain GIRARD traite du choix des conjoints avec une approche Positivisme.
« Qui épouse qui ?»
Pour ce fait, Il construit un échantillon représentatif des ménages entre 1919 et 1959.
Il formalise un questionnaire à questions fermées (oui non) sur la localité, et des questions socioculturelles et professionnelles.
Dans l’élaboration de ce questionnaire, il a construit un étalonnage nommé Indice.
Indice de proximité –Indice de distance de proximité.
Ses conclusions font apparaître que les personnes qui se marient sont géographiquement et socioculturellement proches
Il en conclut à une loi de Proximité : attraction des semblables dans le choix des conjoints.
Cette enquête a été le soubassement à de nombreuses enquêtes où des critères revenaient de manière systématique comme l'homogamie.
En effet pendant de nombreuses années, nous avons fonctionné sur une loi d’homogamie conjugale : on ne prenait en compte que la profession du père dans les enquêtes.
On sait maintenant qu’un des critères déterminant pour les enfants c’est le niveau culturel de la mère.
![]()
Module : Introduction aux sciences économique Le 2 /12/2004
Intervenant : Philippe Semenowicz
1. Grande Evolution du Marché du Travail depuis ces quarante dernières années.
2. Deux cadres théoriques de l’analyse du travail.
· La théorie keynésienne
· La théorie néoclassique
3. Politique du Marché du travail depuis une trentaine d’années.
I - Grande Evolution du Marché du Travail depuis ces quarante dernières années.
a) Les transformations du marché du travail:
| Transformations profondes depuis 40 ans | |
| Niveau de chômage endémique et élevé |
Le chômage est la résultante d’un déséquilibre entre le nombre d’emplois disponibles dans l’économie et la population active.
Chômage = Population active – le nombre d'emplois
|
Population active |
Population Inactive |
|
Actifs occupés : Personnes ayant un emploi salarié ou indépendant.
Chômeurs : Force de travail, mobilisable.
|
Enfants Elèves Etudiants Femmes ou Parents au foyer Retraités |
Population active
Evaluation du taux d’activité :
Population Globale
Nombre de chômeurs
Evaluation du tauxde chômage :
Population active
Il est à noter que l ‘évolution de l’emploi est assez erratique.
Ces quarante dernières années la population active a augmenté de façon croissante de plus de sept millions d’actifs. Cependant le nombre d’emplois augmentent moins rapidement.
1964 : Chômage frictionnel (faible taux de chômage)
1981 : Fort taux de chômage- Arrivée des socialistes au pouvoir (François MITERRAND et son gouvernement de gauche ). Action Volontariste sur le thème de l’emploi sans résultat. « Politique Keynésienne » Glas pour ce type de politique déjà abandonné depuis quelques années par un grand nombre de pays européen.
1987 à 1990 : Amorce d’une reprise du marché de l’emploi. Diminution du nombre de Chômeurs (300 000 environ) avec une augmentation flagrante de créations d’emplois (700 000). Cependant l’augmentation de la population active ne peut réduire le delta entre le nombre de chômeurs et ces nouveaux viviers d’emplois; résultat le taux de chômage de l’époque ne variera pratiquement pas.
1997 : Taux de chômage historique 12,3% . Le chômage est considéré comme une fatalité et touche toutes les catégories professionnelles dont les cadres. « Fracture Sociale » dixit J. CHIRAC.
Dissolution du parlement et cohabitation. Retour par JOSPIN d’une politique volontariste de l’emploi :
· Dispositif emploi jeune / 350 000 emplois environ.( TRACE, Alternance…)
· Mise en place des 35 heures / 350 000 emplois environ. Il est très difficile d’en évaluer ses effets sur l’émergence d’emplois car une seule étude a été élaborée par le ministère du travail.
2001 : Conjoncture favorable et on parle du retour au plein emploi. Inquiétude de main d’œuvres dans certains secteurs d’activités : Informatique, Santé, Bâtiment…
2003 : Reprise du chômage malgré que l’on puisse avancer qu’il y aurait 300 000 emplois vacants :
· 100 000 considérés comme un chômage frictionnel
· 100 000 liés à des problèmes d’inadaptations au poste de travail
· 100 000 liés à un refus des chômeurs d’occuper les postes à pourvoir.
b) Transformation de la population active
1. Entrée dans la vie active de plus en plus tard
2. Féminisation dans la vie active (Année 60-70 modèle de l’alternance) « Travail - Education des enfants-Travail »
Temps partiel négatif et positif (1993 mesure de BALADUR)
3. Sorties de la vie active précoces
Retraite 60 – 65 ans
Pré retraite 55-59 ans
Outils de régulation du chômage ð Notion de valeur économique
A partir de 1990, importance de trouver un équilibre financier sur les retraites
![]()
Module : Modèles d’interprétations (suite) Le 2 décembre 2004
2ème Modèle : Le Fonctionnalisme E DURKHEIM – (Positivisme transformé )lien avec la généalogie – Transformation du modèle.
Emile DURKHEIM - Né à Epinal en 1858, mort à Paris en 1917.
Elève de l’Ecole Normale Supérieure, agrégé de philosophie en 1882, Docteur ès lettres en 1893, il devint professeur à la Sorbonne en 1902. Il fonda en 1897 l’Année sociologique, organe de l’école dürkheimienne. La « morale » est la science des mœurs. Les faits moraux, faits sociaux, sont spécifiques et doivent être étudiés comme des « choses », ayant une existence en dehors des consciences individuelles. Il existe une conscience collective, individualité psychique qui diffère du psychisme individuel. L’individu se développe dans une dépendance de plus en plus étroite vis-à-vis de la société. DURKHEIM étudia aussi les sociétés inférieures, et il exerça une grande influence sur l’anthropologie et l’histoire des religions.
Œuvres principales :
· De la division du travail social (1893)
· Règles de la méthode sociologique (1894)
· Le suicide, étude de sociologie (1897)
· La prohibition de l’inceste (1897)
· Représentations individuelles et représentations collectives (1898)
· Les formes élémentaires de la vie religieuse : le système totémique en Australie (1912)
· Sociologie et philosophie ( publié en 1924)
· L’éducation morale ( publié en 1924)
Qu’est ce qui fait le lien social ?
Contexte social qui succède à la Révolution. Essor du Machinisme.
Il reprend en science sociale les métaphores vitalistes – Rapport à la biologie.
Modèle fonctionnaliste : Comprendre l’état de la société pour en expliquer les comportements des individus. Critères de rationalité et d’objectivité et idées de statistiques quantitatives. Point commun avec le positivisme mais différent.
En partant de son ouvrage « De la division du travail social » E DURKHEIM pose la question de la transformation du lien social. En effet, il écrit que le développement industriel de son époque a influencé les modes de relations entre les individus. La solidarité serait passée d’une relation mécanique (lien affectif et lien de proximité) à une relation organique ou chacun a besoin de l'autre pour l'intérêt qu'il représente (lien commercial ).
Cette opposition fait référence à Ferdinand TONNIES . Né à Oldenswort Allemagne en 1855, mort à Kiel en 1936.
Il fut professeur de philosophie en 1891, des sciences morales en 1909 et de sociologie en 1920, à l’université de Kiel. Parti d’études sur Thomas HOBBES et sur le socialisme, il s’est attaché au problème sociologique. Il distingue la « société et la communauté ». Dans la société, seuls les contrats et les échanges permettent de maintenir des relations égoïstes au départ. La communauté est fondée sur une solidarité naturelle : sang, esprit, race… « l’accord social ne peut être compris que psychologiquement.» La volonté humaine a deux formes, « la Wensenswille » - « vouloir organique qui porte en lui les conditions de la communauté »- et la « Kürwille », ou volonté de choix, artificielle, et réfléchie, qui produit la société.
Ferdinand TONNIES prônait un retour à la communauté.
Œuvres principales :
· Communauté et société (1887)
· Kritik der öffentlichen Meinung (1922)
· Einführung in die Soziologie (1931)
Au-delà de ce premier constat, Durkheim pose la question de qu'est-ce qui fait tenir ensemble les individus ? Qu’est ce qui fait nation ? C’est la construction d’une conscience collective traduite par le partage des valeurs, d’une religion d’une culture « façons de faire, de dire et de partager. »
Dans son ouvrage, "Les formes élémentaires de la vie religieuse" il étudie toutes les formes les plus élémentaires de la religion et repère le fondement même du religieux.
Théorie du fait religieux : Il essaiera à partir de faits religieux de comprendre ce qui fonde les valeurs communes entre toutes les religions, y compris dans ses formes les plus primitives, comme le totémisme.
Hypothèse, les religions ne sont pas fondées sur des faits religieux ; les sociétés ont besoins de ces croyances et des ces valeurs partagées. E Durkheim dira que les sociétés sont des machines à fabriquer des dieux, capables de fabriquer des causes, comme la défense du drapeau, pour lesquels l'ensemble des individus sont prêts à se battre pour défendre leur nation (guerres).
Pour Durkheim le droit, la morale, l’éducation, l’ensemble des institutions sont les outils de cette conscience collective. Ce qui unifie la société, c’est la morale qui rassemble et qui contraint les individus à les faire tenir ensemble. C'est cela qui fait nation. Il est l’homme des contraintes et de la morale soutenue par le droit qui rassemble par opposition à l’éthique « jugement personnel ».
L’idée d’éducation se traduit par un ensemble de façons de faire, de dires et de penser, idée d’un ensemble de valeurs partagées et de normes.
Dans son ouvrage sur le "suicide", meilleur ouvrage de Durkheim il en donne la définition suivante :
Mort qui résulte médiatement ou immédiatement d'un acte négatif ou positif accompli par la victime en connaissance de cause. Selon Durkheim le suicide est l'acte le plus privé sur soi. Si on démontre que cet acte est le plus privé tout dépend bien de l’état de la société. Cet ouvrage cherche à travers des statistiques, à trouver les causes et à mesurer le taux social de suicides.
C’est par juxtaposition de statistiques que E Durkheim a calculé :
Nombre de suicide = Le taux social de suicides dans une société
Population
Il essaiera d’étudier les causes, les corrélations, qui font fluctuer les taux de suicides.
1ère série de causes : Pas de corrélation entre l’état de folie et l’état de suicide. ( Plus on serait fou moins on se suiciderait)
2ème série de causes : Pas de corrélation entre l'alcoolisme, les races, l'hérédité et le taux de suicides.
3ème série de causes : Facteur cosmique, climatique et variations de températures. Il observe que le taux de suicides est plus important au printemps et qu’il y a plus de suicides diurnes que nocturnes.
4ème série de causes : Suicide par imitation y aurait-il diffusion et contagion ? Non
Il est à noter suivant les dires de E Durkheim que les taux de suicides augmenteraient dans les sociétés en crises ou en expansions. L’état de suicide serait en corrélation avec les sociétés anomiques car pas de règles de normes et plus ou moins de contraintes sociales.
Le courant théorique va porter un regard entre le lien suicide et intégration à la société ; hypothèse fonctionnaliste. Ce modèle fonctionnaliste sera un outil utilisé par des anthropologues, ethnologues et ce afin de mieux comprendre le fonctionnement d’une société - Théories des rôles / Théorie de fonctionnaliste.
Précurseur du modèle structuraliste.
3ème Modèle : Idéologique Issu du Marxisme
4ème Modèle : Sociologie Compréhensive - Max WEBER - Compréhension et idéal type sont les deux notions qui guident le sociologue dans sa recherche.
Max WEBER . Né 1864 , mort en 1920.
Il fut philosophe, politique, sociologue, métaphysicien, et même durant un court laps de temps, homme politique. Rationalité et liberté sont irréductiblement opposées, mais doivent cependant nécessairement se concilier. Compréhension et type idéal sont les deux notions qui guident le sociologue dans sa recherche. WEBER fut un philosophe de l’action politique et s’est posé la question de l’immoralité fréquente de cette action.
L’existence est « une chaîne de décisions dernières par lesquelles l’âme choisit son destin».
Œuvres Principales :
· L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme (1905)
· Essai sur la théorie de la science (1906-1913)
· Sociologie des religions (1917)
· Le savant et le politique (1919)
· Economie et société (1922)
les héritages de Weber :
· La phénoménologie : Philosophie qui s’intéresse à la conscience de soi, au sujet, à l’intériorité, et donc à la subjectivité aux visions du monde.
(Hegel, Hussel, Heiddeger, Sartre, Merlo-Ponti, Ricoeur : philosophie du droit)
On ne s’intéresse plus au sujet qui perçoit, mais à la façon dont il perçoit. (nous transformons ce que nous voyons).
On s’intéresse à un certain relativisme - on est d’accort sur le fait que chacun porte un regard qui a une part de vérité.
· La sociologie formelle : Georges Simmel, Allemand, précède Weber.
S’intéresse aux formes (de pouvoir, d’autorité…) que prennent les relations entre les individus.
· La sociologie historique : Oppenheimer
Situe toujours les faits sociaux dans leur contexte historique - (et si ça ne s’était pas passé comme ça ?)
Les notions-clefs
Acteur - Action sociale - Bureaucratie - esprit du capitalisme - Idéal-type - Individualisme méthodologique - méthode sociologique - Rationalité – subjectivité - sociologie compréhensive et explicative - Phénoménologie.
Weber et le fait social
Max Weber est partisan d'une sociologie de l'action sociale ( Actionnisme et individualisme méthodologique)
Qu'est-ce que l'action sociale?
Est action, toute conduite à laquelle l'individu donne un sens. Est sociale, toute action dont le sens est rapporté aux actions d'un ou de plusieurs acteurs. Ainsi, Max Weber définit les faits sociaux non comme des choses, mais comme des interactions entre des comportements individuels obéissant à des motivations et des intérêts qu'il faut reconstituer. Weber prend en compte la subjectivité des acteurs qui détermine leur action, d'où Actionnisme.
Action sociale et rationalité
Le sociologue postule que dans toute action sociale, il y a un certain degré de rationalité. Cependant, le résultat des actions individuelles n'est pas toujours conforme aux buts initiaux.
Individualisme méthodologique
Les acteurs individuels, disposant d'une marge de liberté et agissant de manière relativement rationnelle, font la réalité sociale, les faits sociaux.
Pour une sociologie compréhensive.
Weber est le maître de la sociologie compréhensive. Selon lui, on ne saurait rendre compte valablement de la réalité sociale par la seule explication causale. il faut compléter celle-ci par la compréhension, qui consiste à saisir les motifs des actions des hommes et interpréter la signification qu'ils leurs donnent.
Explication (causalité) et compréhension
A aucun moment il n'oppose radicalement l'explication et la compréhension au contraire, il les associe dans une même démarche qu'il appelle " explication compréhensive " ou " compréhension explicative " Il s'agit donc d'ajouter à la connaissance par les causes l'interprétation qui s'efforce de saisir le sens que les hommes donnent à leurs activités, en harmonie ou en concurrence avec celle des autres.
L'idéal type
La compréhension significative est donc un moyen d'analyser par approximation un phénomène de la manière la plus complète possible. Max Weber propose un outil particulier d'analyse : le type idéal, outil d'investigation qui permet de définir un phénomène social par ses caractères les plus généraux observables dans tous les types de société. L'idéal type est un modèle, une construction intellectuelle, qui permet d'extraire de la réalité empirique, certains traits caractéristiques. C'est un outil qui permet d'utiliser des concepts simples pour pouvoir appréhender une réalité sociale complexe et multiforme. Chez Weber, il peut être une reconstruction intelligible d'une réalité historique complexe : le capitalisme, la ville occidentale, ou des éléments abstraits qui se retrouvent dans diverses configurations historiques : Les formes de pouvoir par exemple, ou les types d'activité.
Typologie d'activités
Il distingue quatre types idéaux d'activités, dont deux types d'activités rationnelles.
· 1er Type - Activité rationnelle en finalité : Elle se caractérise par le fait que l'homme choisit les moyens les plus appropriés pour atteindre son but, compte tenu des conséquences prévisibles qui peuvent ou non troubler le déroulement de son action. « Passer par la guerre pour arriver à la Paix –La fin justifie les moyens ».
· 2ème Type - Activité rationnelle en valeur : qui est au service d'une conviction, indépendamment de la considération des chances de succès et des conséquences. Elles sont rationnelles par rapport aux valeurs. Elles pourront être expliquées, argumentées adéquates et en lien avec sa valeur.
· 3ème Type- Activité par les affects : qui se développe sous l'emprise d'une émotion ou d'une passion, éventuellement sous forme sublimée (par exemple celui qui se venge d'un affront ou qui se livre à la facilité contemplative)
· 4ème Type- Activité par la tradition : qui obéit parfois machinalement à la routine aux habitudes.
![]()
Le 9 décembre 2004
Module : Fondements et Disciplines des Sciences Sociales
Histoire des disciplines
Fondements des disciplines en sciences sociales et leur évolution
Définition d’une discipline : ensemble de lois et de règlements qui régissent certains corps certaines assemblées comme l’église, l’armée les écoles…
Dans le domaine des sciences humaines, les disciplines sont la philosophie, la psychologie, la sociologie, l'économie, l’Ethnologie, Anthropologie, la linguistique, la politique, l'histoire ou tout ce qui se rapporte à l'Homme et à son environnement.
Finalité : Point commun destiné à répondre à des questions relatives à l'existence de l' homme.
De ce fait nous pouvons distinguer quatre types de questionnement.
1. Qui suis je ? Qui sommes-nous ? Démarche d’ordre psychologique ou philosophique. L'homme s'étudie lui-même.
2. Qui êtes vous ? - comprendre l'autre différent de l'étranger- Démarche d’ordre anthropologique…
3. Comment pouvons nous vivre ensemble ? Démarche d’ordre sociologique.
4. Comment en est on arrivé là ? Démarche d’ordre historique.
Toutes les disciplines en sciences humaines ne sont pas exactes. Par principe, on pense que les disciplines ne se rencontrent pas. Cependant, de nombreuses possibilités d’articulations des méthodes sont nécessaires. Méthodes de recoupements dans les modèles de compréhension. Ex : Utiliser les méthodes des historiens pour faire de la sociologie.
Les Disciplines peuvent s’apporter mutuellement des contributions dans un processus de construction par un partage des méthodes.
Le travail en interdisciplinarité est encore différent : Chacun intervient en fonction de son champ, croisement des spécialités, apports sociologique psychologique, Historique...
Pour traiter un objet de recherche on peut croiser des méthodes d’où interpénétration des disciplines. Celles ci peuvent se chevaucher et trouver leur complémentarité. Cependant, il faut rester très prudent dans l’utilisation, car certains courants de pensée ne peuvent se conjuguer. De plus tous les modèles ne peuvent pas se chevaucher, ce serait un contre sens.
L e contexte historique influencera toujours les courants sociologiques.
La sociologie des associations a disparu jusqu’à la fin des années 70, depuis elle revient.
Lorsque nous traitons un objet de recherche nous devons absolument identifier toutes les disciplines qui peuvent s’y rattacher.
· Convergences disciplinaires autour d’un même objet
· Travail d’identification
· Croisées des données.
L'identité d'une discipline repose sur ses fondements, c'est à dire, les motifs et le contexte qui ont présidé à sa naissance. L'évolution d'une discipline sera marquée par les paradigmes successifs qui traversent le champ intellectuel et parfois sociétal.
Paradigme : Pour PLATON, c’est le monde des idées, modèle premier de la matière. Représentation commune à un moment donné. Le Paradigme de l’action sociale est la prise en charge.
La sociologie
La sociologie est née à la moitié du 19ème siècle comme le cas de plusieurs disciplines étudiées sauf l'histoire.
Elle est issue de la philosophie « Place de l’homme dans l’univers » - Pensée grecque, Aristote, Platon.
Le christianisme a empêché son évolution. La formule du « tout est de droit divin » explique tout.
Terme créé par A COMTE pour désigner d’abord la physique sociale, c’est à dire l’étude des phénomènes sociaux, considérés comme formant un règne d’effets naturels soumis à des lois, de même que les phénomènes physiques et biologiques. Il a construit une pensée scientifique à la place d’une pensée métaphysique. Référence au réel en apportant la preuve des théories et en occultant tout ce qui est de l’ordre du divin et de l’élaboration spéculative de la pensée.
La sociologie se construit en déclarant que l’on ne peut déduire la compréhension du social des principes qui se trouveraient hors du social.
C'est donc l’étude sociale qui doit faire matière ce qui implique qu'on ait recours à des méthodes.
1848 : Apparaît la question sociale dans tous les pays d’Europe. Synergie entre politiciens et institutions. Affrontements des tendances révolutionnaires, libérales, conservatrices…
Naissance d’une objectivation du social avec des personnalités marquantes.
Le Docteur Villermé- Né en 1782 mort en 1863.
En 1840, il répond à une commande du gouvernement en menant une enquête sociale sur le terrain. Etude ayant pour objet les milieux ouvriers.
De part sa méthodologie de recueil d’informations, il fût considéré comme l’un des précurseurs des grandes enquêtes sociales. « Lien avec le Politique »
Frédéric LEPLAY- Né en 1806 mort en 1882 : Conception d’une pensée fondée sur des études de milieux sociaux.
I Différentes postures et leurs identifications
Il est à noter que la sociologie ne se façonne pas en dehors des questions politiques. Sous bassement politique.
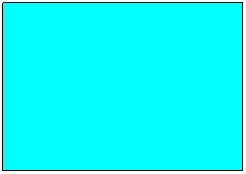
1ère posture : Réformer la société. Enrayer les désastres engendrés par le libéralisme et ce afin d'en éviter les extrêmes.
Frédéric LEPLAY (catholique conservateur)
Auguste COMTE
A Touraine
MARX : But Changer la société- Connaissance
pour l’Action
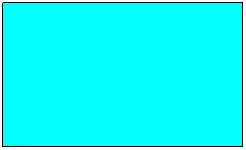
2ème posture : Eclairer le Politique
E. DURKHEIM
R. CASTEL
BOURDIEU
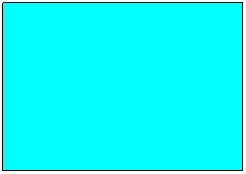
3ème posture : La neutralité axiologique
MACHIAVEL
Max WEBER
SIMMEL
II La question des paradigmes
Paradigme : Qui préside à la base de la sociologie.
Pensée positive est la base de la posture scientifique – Idée de recherche de la preuve fondée sur l’observation et le raisonnement.
Auguste COMTE se réfère à la science dure, la physique d’ou son expression de physique sociale où il se plaint de l’abus fait de cette expression par divers écrivains et notamment par un savant belge qui l’a adopté comme titre d’un ouvrage de simple statistique. Il s’agit de Quételet.
Elle doit servir à fonder une Politique Positive qui s’appuie sur du raisonnement ayant comme finalité le progrès humain. Pour A.Comte la société est en constante évolution.
C’est en partant de ce postulat qu’il a fondé la théorie des 3 Etats.
1. l’Etat théologique ou fictif – Niveau d’évolution archaïque qui se transforme ensuite-Rapport lié au surnaturel.
2. l’Etat métaphysique ou abstrait - Explication abstraite au moyen de théories, sophismes, raisonnements de l’esprit non fondé par l’observation. Etat correspondant à celui des régimes féodaux et militaires.
3. l’Etat scientifique ou positif – Société dite positive qui découle du progrès industriel, scientifique et technique. Les sciences sociales progressent du fait de la progression de toutes les sciences.
Herbert Spencer est le principal théoricien de l’évolutionnisme. Il tente d’expliquer l’histoire complète du monde, pour l’évolution de l’indéterminé homogène de la nébuleuse à la formation de masses vivantes hétérogènes et diversifiées.
Bergson rejette l’aspect mécaniste de l’évolutionnisme.
| Herbert Spencer libéral évolutionniste DARWINIEN prône l’élimination naturelle des pauvres. |
|
E
Durkheim
fonctionnaliste construit
ses théories en se référant à cette théorie de l'évolution mais de façon
antagoniste. Pour lui , la société est un tout interdépendant, si la société
organique fonctionne bien l’évolution ne peut qu’être meilleure.
|
Module : Modèles d’interprétations (suite) Le 9 décembre 2004
Max WEBER & L'éthique protestante et l'esprit du Capitalisme (1905).
Systèmes de Valeurs
ê
Structures Economiques
Weber pense que ce sont les systèmes de valeurs qui sont premiers dans les sociétés et que ces valeurs structurent la société économique.
L’Ethique protestante et l’esprit du capitalisme illustre cette démarche dans l’examen de la motivation du comportement des individus au sein des groupes religieux dans lesquels ils s’insèrent. La sociologie wébérienne a vu naître de nombreux thèmes les plus connus sont les types de domination, les types d’activité sociale ainsi que les multiples travaux sur les différentes sortes de relations sociales ou les diverses structures sociales etc.
Dans le premier chapitre du tome 1 de son ouvrage Economie et société Weber donne les concepts fondamentaux de la sociologie parmi ceux-ci l’outil méthodologique indispensable de l’idéal type. Il entend par-là un concept construit abstraitement qui ordonne en un tableau homogène les caractéristiques essentielles d’un phénomène. Cela permet de mettre en évidence des relations réelles.
Dans l’Ethique protestante il mettra en évidence les relations existantes entre l’idéal type de l’ascétisme protestant et celui de l’esprit du capitalisme.
Weber se pose la question « Pourquoi les protestants en Allemagne sont de si bons capitalistes ? ».
Il définira le Capitalisme, en construisant l'idéal type du Capitalisme à partir des valeurs du Capitalisme Allemand du 19ème siècle.
Il en dégagera un Idéal Type à tout le capitalisme et ce de la façon suivante :
· Recherche de profit et de rentabilité du Capital
· Organisation rationnelle du travail
· Rationalité bureaucratique
· Utilisation de la technicité et technologie pour améliorer la productivité
· Rigueur et Rationalité
C’est en partant de cet idéal type, qu’il cherchera les rapports entre les valeurs du capitalisme et celle du protestantisme
Les 3 systèmes de valeurs inhérents au protestantisme :
· Travail
· Ascèse }WEBER démontrera qu’il y a concordance entre les valeurs
· Individualisme du protestantisme et du capitalisme
Rapports à Dieu différents:
Pour les catholiques, le salut se trouve au moment de la mort, il s'obtient dans la pénitence.
Pour les protestants, ils n’ont comme preuve que la réussite sur terre. Façon de gagner son salut.
Modèles issus du marxisme
Marxisme une philosophie dont des modèles sociologiques en sont issus.
Karl MARX – Né à Trêves, en 1818 , mort à Londres en 1883.
Il fit ses études aux Universités de Bonn, de Berlin et de Iéna, et fonda en 1842, la Gazette de Rhénane. Il se rendit à Paris en novembre 1843, et y lança les Annales franco-allemandes. Expulsé en 1845, il se réfugia à Bruxelles, effectua un voyage en Angleterre , au cours duquel il rédigea le Manifeste du Parti Communiste. Il est expulsé de Belgique en 1848, fait un bref séjour à Paris et s’installe à Cologne, où il fonde la Nouvelle Gazette rhénane. Chassé des Etats rhénans en 1849 , il se rend à Paris, d’où il est expulsé et il part vivre à Londres. Il y connaît la misère, malgré le soutien amical d’ENGELS. L’internationale ouvrière est créée en 1864.
Des conflits de Doctrine éclatèrent, des rivalités opposèrent MARX à MAZINNI, à BAKOUNINE, à Jules GUESDE. A l’abri du besoin grâce à une pension d’ENGELS et veuf en 1881, il voyagea pour sa santé : Monte-Carlo, Vevey, Enghien, Alger. Il mourut d’un abcès au poumon.
C’est en Angleterre que MARX étudia scientifiquement , en économiste, les problèmes de la classe ouvrières et qu’il fut amené à élaborer et à exprimer sa doctrine : le Marxisme dont lui-même prétendit d’ailleurs se tenir à l’écart. Les transformations sociales dont l’histoire nous donne le spectacle ont pour base la structure économique. C’est le principe du Matérialisme historique.
« L’existence des classes est liée à des phases du développement historique déterminé de la production ».
La lutte des classes est le rouage primordial de la transformation du monde.
La classe la plus nombreuse, qui est la plus défavorisée, doit assurer son triomphe sur la classe la plus riche, qui est la moins nombreuse. Le prolétariat doit vaincre la bourgeoisie.
*L’analyse économique de MARX le conduit à démontrer que le mode de production des richesses est collectif, alors que leur mode d’appropriation demeure individuel. Là est la base de l’antagonisme des classes. Le capital bourgeois, qui possède et ne produit pas, s’est soumis le travail prolétarien qui produit, mais ne possède pas. « Le capital est du travail mort, qui tel un vampire, ne vit qu’en suçant le travail vivant, et vit d’autant plus qu’il en suce d’avantage ». – MARX énonce la loi de concentration, selon laquelle le nombre des prolétaires s’accroît sans cesse, alors que le nombre des propriétaires du capital à tendance à décroître. Le déséquilibre entre production et consommation entraîne les crises économiques et doit hâter l’avènement du prolétariat et la collectivisation de la propriété.
Mais l’erreur de MARX est célèbre, qui prédit que la révolution éclaterait dans le pays le plus industrialisé et où la loi de concentration jouait le plus fortement , c’est à dire les Etats-Unis. – MARX énonce la loi d’airain des salaires, qui réduit au minimum le gain du travailleur, et il distingue la valeur d’échange, fonction de la quantité de travail incorporé dans l’objet, de la valeur d’usage. – L’un des facteurs essentiels de l’avènement du prolétariat est le développement interne du prolétariat lui-même. C’est par son aliénation totale, en s’enfonçant au plus bas de sa condition, que le prolétaire prend conscience de celle-ci. – « Le processus suivant lequel le travail est transformé en capital contient en lui le secret de la destruction future du capitalisme. » Le dépérissement de l’Etat bourgeois est une étape de cette destruction, qui doit aboutir après le grande crise, à la dictature du prolétariat. Mais celle-ci ne doit être qu’un passage vers l’instauration d’une société sans classe, c’est à dire une société communiste, où la propriété privée sera supprimée. Les principales influences que l’on décèle dans la pensée de MARX sont celles de HEGEL, FEUERBACH, et de RICARDO.
La philosophie allemande, le socialisme français et l’économie politique anglaise s’y retrouvent. Le marxisme a des limites, mais tel qu’il est, il a joué un rôle considérable dans l’histoire du monde.
« De même que le Christ aux martyrs de l’esclavagisme antique, Karl MARX à apporter aux martyrs de l’esclavagisme moderne un bouleversement d’espoir ( G. WALTER) ».
Œuvres Principales :
ü La critique de la philosophie du droit de Hegel (1844)
ü La Sainte Famille ou critique de la critique (en collaboration avec Engels, (1845)
ü L 'Idéologie allemande (avec Engels et Hess, 1845-1846)
ü Misère de la philosophie (1847)
ü Manifeste du parti communiste avec Engels (en 1848)
ü La lutte des classes en France (1848-1850)
ü Le Capital en 1867
ü La Contribution à la critique de l'économie politique (1859)*
Le matérialisme « dialectique»
Superstructure
é
INFRASTRUCTURE
Pour Marx, ce sont d'abord les conditions de productions et les conditions matérielles qui expliquent l'ensemble de la société. Ces conditions donnent l’infrastructure de la société. Cette infrastructure explique les superstructures, c’est-à-dire les idées et idéologies.
C’est l’inverse de la pensée de Weber.
"Ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur être social, c'est inversement leur être social qui détermine leur conscience." (Marx).
Les pratiques ou praxis déterminent les théories, les idées.
Cette philosophie donne un certain nombre d’éléments pour élaborer des modèles théoriques en sciences sociales.
Elle nous permet de comprendre à nouveau l’ensemble de la société et ce afin de mieux cerner les comportements individuels ðTentative d’objectivation et d’explication.
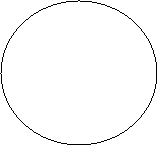
![]()
![]()
*base de l’antagonisme des classes
La Société est une totalité « Sphère », animée par un conflit de classe entre dominants et dominésð capitalisme et prolétariat.
Pierre. Bourdieu sociologue contemporain (1930-2002) a construit un modèle théorique à partir de cette hypothèse marxiste.
Œuvres Principales :
· La Maison Kabyle
· Les Héritiers (1964)
· La reproduction (1970)
· Question de sociologie
· Métier de sociologue
· L’esquisse d’une théorie de la pratique (1972)
· La Distinction. Critique sociale du jugement (1979)
· Le Sens pratique (1980)
· Homo Academicus
· La Noblesse de l’Etat
· Les Règles de l’art. Genèse et structure du champ littéraire (1992)
· La Misère du monde(1993)
Et bien d’autres
Pierre BOURDIEU s’associe à Jean Claude PASSERON et ils écrivent « Les Héritiers et la reproduction ».
Analyse typologique du milieu étudiant de 1964.
Modèle statistique :
· 1% des étudiants sont des fils de salariés agricoles
· 80 % issus de pères aux professions libérales
· 70 % d'industriels
Bourdieu met en exergue le cloisonnement des choix d’orientation par un élitisme universitaire. Inégalités quant aux chances de se rendre à l'Université. Les filières prestigieuses sont privilégiées dans les choix que font les étudiants de la classe dominante.
BOURDIEU montre que les enseignants ont deux représentations des étudiants.
1. Les Etudiants brillants qui bien souvent brillent aussi par leur absentéisme. Profil bercé dans le savoir depuis l’ enfance.
2. Les Etudiants laborieux – les bûcheurs ceux qui n'ont pas eu cette chance d'avoir accès aux savoirs et qui doivent faire un effort très important d'acculturation pour se hisser au niveau des étudiants ordinaires de la classe dominante.
Idée de Bourdieu et Passeron :
La Société est toujours dans cette notion de dominants/dominés.
On parle aujourd'hui plus volontiers de couches sociales, de catégories socioprofessionnelles mais qui ne sont finalement que la retransposition des classes sociales.
Idée de champs :
Bourdieu utilisera la thématique de champs pour désigner les différentes sphères de la vie sociale. Idée de champs culturel, Social, Educatif…
Dans chaque champ on retrouvera le rapport de dominants/dominés
Idée de Capital :
Les dominants possèdent le capital. Pour Bourdieu il y a plusieurs sortes de capitaux qui donneront 3 formes de domination.
1. Le capital économique
2. Le capital culturel (enseignants…)
3. Le capital social (réseau de connaissances )
Bourdieu signifie que le système scolaire est fait pour reproduire la domination des dominants dans le champ culturel. En effet, l’école est fondée sur la culture dominante. Les dominés ont d'abord a faire un processus d'acculturation - Violence symbolique des dominants sur les dominés pour les acculturer à la culture dominante.
Grignon et Passeron expliquent qu’il y avait deux façons de faire de la sociologie des dominés.
Bourdieu formalise le concept d’habitus comme un système de dispositions durables et transposables. Principe de génération et de structuration des pratiques et des représentations. C’est donc le système de représentation qui prédisposerait l’individu à son milieu social d'origine.
Habitus ðReprésentation – Disposition qui se sont construites dans notre environnement. Idée du possible et du probable.
Névrose de classe de Goulegac : Socle Macro social – Trajectoire atypique- Analyse des pratiques. L'ensemble des pratiques est dominé par l'habitus, donc par le système de classe
Dans son ouvrage "la distinction" les dominants cherchent toujours à se singulariser pendant que les dominés cherchent à les imités. Exemple de la pratique d’une activité par les dominants qui sera rendue légitime, donc les dominés essayeront de la pratiquer à leur tour. Exemple de la démocratisation du tennis, du ski...
Dans "la misère du monde", Bourdieu utilisera la méthode qualitative d’entretiens comme outils. Résultat : La raison de la misère du monde serait les conflits de classes
![]()
Module : Territorialité et Intervention Sociale (suite) 16 décembre 2004
Approche du point de vue collectif
La mise en scène , mise en image qui se trouve au centre de l’interprétation est en corrélation avec l’histoire. Importance d’admettre de grandes ruptures.
Etudes de trois types de paradigmes en ruptures les un avec les autres
1. Le nomadisme
2. La sédentarisation
3. La Nébuleuse
Mutation ðParadigme du modèle des modèles.
Paradigme comme idée de modèle des modèles, fin 19ème siècle en sciences sociales. Chaque paradigme peut être mis en cause par des problèmes auxquels ils ne peuvent répondre ou qui n’ont pas pu être anticipé, car non découvert.
ì Paradigme
Ex :Physique avec la loi de la Gravitation universelle :
î Relativité( Macro Univers – Micro Atome )
Nous sommes dans un problème du modèle des modèles.
 I
- Le nomadisme
I
- Le nomadisme
Représentation symbolique de la flèche.
Incarne : L’orientation
Le Passage
Le Milieu
L’Ephémère
La flèche est le symbole du déplacement dans l’espace et dans le temps , du nomadisme.
Propriété topologique : Sens du déplacement – vide du milieu – Le nomade est l’homme du milieu cherchant toujours à aller derrière l’horizon.
Matrice essentielle pour la naissance de la civilisation occidentale. L’Europe fille de Tyre a Invente l’Europe et lui donne figure. Pardigme de la civilisation par le biais des échanges des cultures.
II La sédentarisation
|
|
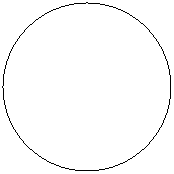 Représentation
symbolique du cercle et du lieu.
Représentation
symbolique du cercle et du lieu.
Incarne : le cercle avec son milieu et
ses séparations de l’intérieur et extérieur.
Permanence – Centre – Marges et ses
Frontières fermées sur elles mêmes.
Les sédentaires vont mettre en valeurs des représentations de l’ordre du proto-urbain, prémisses des premières villes forme urbaine , notamment en Mésopotamie et en Egypte.
Dominante de la sédentarisation est agraire. Elevage et agriculture ont été longtemps en France la base de notre économie.
La ville est l’ordre des réseaux mais la sédentarisation.
III La Nébuleuse
Représentation symbolique Temps T0 – Temps T1 plus rien – univers .
Paradigme de la nébuleuse
l l l
l
l
l
l l
l
l
Cette typologie de société ou se superpose le nomadisme et le sédentarise ne peut que générer des problèmes conflictuels faisant émerger un troisième paradigme la nébuleuse ce monde de réseaux.
Les réseaux sont mobiles en interne comme en externe. Les points représentent des lieux des pôles des repères de centralité permanent.
Lieux : Naissance Pôles:/ Hub : Centres transactionnels
Patrimoine ou la question d’orientation se pose.
Lieu dit
Ces paradigmes se nourrissent avec des valeurs contraires, elles sont interactives et possèdent des interférences. Malgré le sprawling « Modèle Américain » extension des villes, il y a résilience : Forme de recherche de permanence avec plusieurs centres.
L’Espace transactionnel ðEspace virtuel différent de l’espace patrimonial.
Effet de globalisation ðCapacité d’ouvrir les lieux au monde lié aux nouvelles technologies et à la communication.
Cet univers de réseaux pour partie physique et virtuel est plus apparent la nuit. Dans cette représentation de grande nébuleuse c’est le sédentaire qui est le marginal, en ce sens qu’il ne peut avoir accès au réseau d’ou la notion d’intégration de la mobilité est importante.
Paradigme de la nébuleuse engendre Crise et conflit. Crise comme milieu de l’adversité et conflit comme polarisation de l’adversaire. Les conflits se règlent par déplacements et mobilités.
Dans la nébuleuse, il y a dissolution des conflits par la crise, dans le paradigme de la flèche il y a dissolution de la crise par les conflits. Difficultés de trouver de véritables solutions au conflit, il y a déplacement.
Notion d’espace ð Territoire ouvert / Le débat de l’Europe pose la question de savoir ou sont ses frontières. Frontière définie comme lieu d’un espace intermédiaire.
Dans cet univers de la grande nébuleuse , l’attribution du sens pose problème car elle n’est pas identifiée d’où la crise de l’idéologie qui possède ce sens. Effet de résonance dont interférence entre un grand nombre de conduites individuelles ð Effet pervers . Interactivité inhérente à la nébuleuse.
![]()