


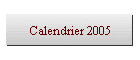


Notes de cours Jeudi 9 novembre 2006
«Espace, ville et territoire » U.E. 5/AXE III du D.S.T.S
I Initiation à l’anthropologie de l’espace :
Un postulat au préalable : tout est langage. C’est le propre de l’humain.
Tout système social exprime, traduit, dans son propre espace ses schèmes religieux, politiques etc. dans des réalisations monumentales.
Toute ville est la projection d’une société sur un terrain ; c’est une projection idéelle propre à une société donnée.
Références bibliographiques :
· Henri Lefebvre « La production de l’espace ».
· Marion Segaud et Françoise Paul-Lévy « Anthropologie de l’espace », éd. Centre de Création Industrielle (CCI), Centre Georges Pompidou, Paris 1983. (Epuisé)
· Robert E. Park et « L’Ecole de Chicago ».
Tout est corrélé, les sphères mentales et architecturales.
Au XIXème siècle, la sphère de l’économique est visible à travers les grands magasins, les Bourses…
Selon l’approche structuraliste, les formes spatiales se correspondent dans l’unité d’une culture. Ces formes sont en un temps donné une façon d’être humain.
Henri Lefebvre parle d’un « espace du syncrétisme enfantin » propre aux « sociétés dites primitives », et, à l’inverse, de « l’espace abstrait contemporain ».
Ce dernier se définit par son isotopie (deux dimensions) : le géométrique (espace euclidien), et le visuel (né avec les lois de l’optique) et non plus tri dimensionnel. Il s’agit d’une « mise en écriture de nos sociétés ».
II Territoire, territorialité, territorialisation :
Selon l’acception étymologique, le territoire c’est la « terra » (latin), vaste étendue de surface solide. C’est une étendue bornée, limitée, cultivable.
En effet, la notion de territoire ne vaut que par rapport à ses limites. Par le jeu d’une extrapolation, le problème des jeunes de cité est indissociable de l’idée de limites.
Une limite ne vaut que parce qu’elle peut être franchie.
Le franchissement de la limite doit être fait sous le contrôle des maîtres du territoire.
Toute porte exprime le contrôle du franchissement de la limite.
C’est la question du seuil, c’est-à-dire la zone de franchissement, l’ « atabe » en arabe : la matérialisation de la limite. Le terme « seuil » est très chargé symboliquement.
Les seuils peuvent se répéter comme autant de matérialisations de limites de plus en plus sélectives.
Le seuil le plus abouti est le labyrinthe du Minotaure en mythologie grecque ; c’est l’espace-seuil hyper sélectif.
Référence bibliographique :
· Mircea Eliade « L’histoire des religions ».
Le seuil a valeur de médiateur, fonction de médiation, donc.
C’est la base de l’unité politique.
Cette notion de limite est propre à la terre.
Autre caractéristique : le territoire est toujours qualifié, y compris par la négative : le « no man’s land ».
C’est une notion transversale à différents champs disciplinaires, tels que l’histoire, la science politique, la géographie (maillage de l’espace approprié) etc.
Au XVIème siècle, c’est la conquête du territoire avec les découvreurs.
Le territoire, c’est aussi l’étendue sur laquelle s’exerce une autorité, une juridiction.
Cette notion renvoie à l’autorité politique et à sa capacité à garantir l’intégrité…du « territoire national ».
Nous avons donc abordé trois acceptions de la notion de territoire :
· La « terra » : vaste étendue bornée.
· La population qui y vit.
· L’espace sur lequel s’exerce une autorité.
Le territoire ne peut toutefois se réduire à tout cela. Le sentiment d’appartenance est important. Il procède d’une projection sur un espace donné et de ce qui opère en retour, qui aide à la cristallisation de l’identité collective.
Référence bibliographique :
« Informations sociales », revue de la C.N.A.F., numéro paru en 1995 (date incertaine) : « C’est mon quartier » (Yves Chanaz).
Henri Lefebvre parle d’une phénoménologie de l’espace, il distingue l’espace perçu (celui que l’on ressent lorsqu’on le regarde) et l’espace vécu.
Nous distinguons maintenant quatre grandes formes de limite :
- La limite-coupure : l’enceinte, la clôture etc. qui matérialisent la délimitation entre l’espace public et l’espace privé, entre le profane et le sacré (la hiérophanie…cf. Mircea Eliade ; la cratophanie :lieu où règne la « force supérieure »).
Cette limite protège le dedans du dehors et vice-versa.
- Les limites faibles : au Japon, par exemple, avec les maisons de papier ; des maisons traditionnelles où toutes les limites intérieur/extérieur matérialisées, formant ce que Marcel Granet appelle « le réseau serré des dépendances mutuelles », symbolisant la circulation incessant de la dette…..
Les cloisons amovibles des maisons traditionnelles japonaises sont ainsi autant de limites faibles néanmoins très chargées symboliquement, matérialisant la projection et l’interprétation de l’intériorisation des dépendances mutuelles entre les générations notamment.
On perçoit ici plus précisément la subtilité de la question des limites.
- La limite par le mouvement : c’est le nomadisme bien sûr ; le mouvement du parcours qui constitue et marque en lui-même les codes du territoire.
- La limite par la répétition : dans l’Antiquité par exemple, avec la maison romaine qui reproduisait en son sein le forum urbain. Ou bien encore dans la civilisation chinoise avec la Cité interdite et la répétition d’enceintes intérieures.
Voir aussi la « Jérusalem céleste » ou les « murs de Jéricho », dans la Bible.
Références bibliographiques :
|
Perla Serfaty-Garzon, « chez soi, les territoires de l’intimité », éd.Armand Colin, SEJER, Paris, 2003. |
Sous la direction de Marion Segaud, Jacques Brun, Jean-claude Driant, « Dictionnaire de l’habitat et du logement », éd.Armand colin, VUEF, Paris, 2002
Notes de Martine en photos
|
|
|
|
|