


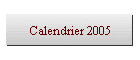


Notes de cours Jeudi 25 janvier 2007
«Espace, ville et territoire 5 » U.E. 5/AXE III du D.S.T.S
Étude du texte sur la proximité et la proxémie
|
Objet Contexte |
Paysage de la question |
Structure texte |
Thème/idées |
Association de champs/ contexte |
Références bibliographiques |
|
Dénoncer la représentation unanimement positive |
Toutes les politiques publiques sont basées sur la proximité Idéologie d'un paradigme impensé basé sur les politiques publiques
Sciences sociales |
1ere partie polysémie du concept, les différentes acceptions 1) expérience sociale toujours proximisée 2) enjeu de citoyenneté, démocratie participative 3) légitimation de la politique publique (au plus près du peuple)
illustration de la pensée unique contredite par le retournement de l'euphémisation (les jeunes qui ont du mal à intégrer la possibilité de se déplacer sans être en référence avec leur proximité) |
Rapport identité/territoire
Intégration/exclusion Espace/temps Proximité/distance
Sédentaire/nomade |
|
|
L'entrée en société des jeunes et fracture entre lien social et lien civil
Blocage de l'entrée de la société ou pourquoi ces jeunes ne réussissent pas ce passage
Préalable
La métapolisation
Résumé de F. ASCHER (2001) Changer la ville, Aube
Pour François Ascher, professeur à l’Institut Français d’Urbanisme, nous sommes à l’aube d’une troisième révolution urbaine, après celle de la ville classique et celle de la ville industrielle. La société post-moderne (ou encore hypertexte), marquée par un usage accru des sciences et des techniques mais aussi le développement du risque, ainsi que par une individualisation plus poussée, voit apparaître une diversification des liens sociaux, plus fragiles mais aussi plus nombreux. Une tendance à la métapolisation est partout observable, qui résulte de l’approfondissement de la division du travail à l’échelle mondiale. L’usage des TIC (technologies de l’information et de la communication) ne réduit pas la mobilité mais la transforme. Les conséquences en sont une individualisation des espace-temps et l’apparition de nouvelles formes de ségrégations sociales. Ces changements sociaux représentent un défi pour l’urbanisme, qui doit prendre acte du brouillage des distinctions entre vil les et campagnes, entre public et privé ; et accompagner la réflexion visant à reconcevoir les services publics et équipements collectifs en s’adaptant aux nouveaux besoins. Pour cela, une stratégie par projets sera préférable à la planification traditionnelle.
L'espace urbain se diversifie des ses formes et ses valeurs. L'habitat défavorisé est un exemple de l'hétérogénéité montante.
Les jeunes entre 15 et 25 ans qui loupent cette entrée de la sphère privée à la sphère publique, n'auront plus alors beaucoup de possibilités d'être intégré dans la société nomade sédentaire. Mais cette entrée n'est pas évidente. L'intégration est pensée de manière globale, alors que pour certains publics cela n'est sans doute pas possible.
La thèse
1) deux univers distincts, les personnes intégrées dans la société nomade sédentaire et celles qui n'y sont pas.
2) dans ces deux mondes le lien social existe mais il n'est pas de même nature, et ne s'exerce pas selon les mêmes modalités et qu'il est même constitué de rapports opposés
3) lorsqu'on parle du lien social inexistant dans les quartiers, il ne s'agit pas de cela mais plutôt absence de lien civil (rupture avec le civil, l'état)
Les trois grands passages autour de l'entrée en société
Pour l'ensemble de la jeunesse la transition sociétale s'effectue en trois grands passages. Dans les sociétés traditionnelles, ces passages s'effectuent par :
1) la scarification
2) la mise en marge
3) la réintégration
Dans les sociétés modernes ces passages s'effectuent par :
1) le passage de l'enfance à la vie adulte
2) le passage de la famille à la ville ou la société
3) le passage de sphère privée à la sphère publique, c'est à dire de la loi privée exclusive à la loi publique ou politique.
Pour Galland l'entrée dans la vie adulte, dans les sociétés traditionnelles la jeunesse n'a pas d'existence sociale. Dans l'ancien régime, n'a pas beaucoup plus de consistance sociale. La jeunesse est une invention dans les sociétés modernes apparue avec le siècle des lumières.
Actuellement, on assiste par la scolarisation à une prolongation de la jeunesse, qui a pour effet le report de la vie en couple, de l'entrée dans la vie professionnelle.
Nous sommes passés du modèle de l'identification au modèle de l'expérimentation. Le modèle de la socialisation (s'identifier par rapport à nos parents, transmission des statuts de génération en génération) est donc différent. Il s'est épuisé en mettant, entre autre, une distance entre le modèle de référence et le modèle d'appartenance.
L'expérimentation, c'est la définition de soi qui se construit à travers un certain nombre d'agent socialisateur plus qu'elle est héritée.
1) Pour toute une frange de jeunes "dit des cités", ce triple passage seuil se bloque du fait de la nature même de la société locale sédentaire qui s'oppose quasiment à la société urbaine globale qui se caractérise par un ordre nomade (mobilité, réseau, flux, etc) espace transactionnel (les modes de vie et les valeurs relèvent d'une culture nomade dont les caractères anthropologiques sont nomades)
2) En quoi cette société nomade sédentaire s'oppose par nature à l'espace public de la société générale. Cette société nomade sédentaire fixe les jeunes dans une hyper appartenance du territoire et ils sont donc bloqués par rapport aux jeunes intégrés qui bénéficient de la mobilité.
La société par opposition notre société contemporaine est fondée sur la mobilité, mais elle même temps hyper individualiste, alors que notre société est aussi multi culinaire
Pour les intégrés, elle se caractérise par une appartenance simultanée et multiple a beaucoup de sphères et de réseaux. Par opposition, ce territoire de la cité et du quartier fait cercle, tout fait corps, rien ne bouge, groupe de jeunes agrégés qui restent au même endroit.
La cité se réduit à une seule sphère d'identification, celle des jeunes, notamment ceux qui sont portés par les médias. Cette territorialité d'incrustation et surtout une incorporation est illustré des mauvaises représentations, des mauvaises images. Ils se déplacent avec leur quartier. La mobilité dans les quartiers est circulaire sur un mode de groupe ou bande, sur le temps de la "virée" (partir/revenir), mais jamais beaucoup plus loin que l'autre quartier, voire la ville mais en grand groupe. L'inversion des temporalités est également très présente, on dort le jour, on se rassemble la nuit. Tous les autres sont identifiés de manière négative et donc exclus de leur univers. Les peurs de l'autre, de l'inconnu, les peurs de l'abstrait privilégient le contact direct, avec celui qui est proche. On fraternise, on code les salutations mais sans véritables traditions. L'univers matriciel (de la mère) fusionnel hors tiers introduit le code de l'honneur qui est construit autour de la fratrie, la famille, la parentèle, qui constitue une loi d'essence privée qui permettra l'exclusion des tiers, et donc la survie. Le lien social développé selon cette modalité est extrêmement défensif est opposé au notre parce que d'essence privée.
Le passage ne s'effectue pas pour ces jeunes de la sphère de du privé à la sphère du public, d'un territoire communautaire, familial, ou primaire régi selon ses propres règles au régime du droit. Ce régime du droit public est extrêmement difficile à appréhender car il est compliqué a concevoir, et c'est aussi une confrontation avec la loi politique. Il s'oppose au cycle de la vengeance réciproque.
L'espace des fils du quartier où s'entremêle l'honneur et l'injure, les fils sont fixés sur ce territoire empêchant même l'éloignement symbolique.
Pendant ce temps là les autres jeunes actuels, ceux qui sont correctement intégrés dans le systèmes des flux, repoussent les frontières, se déplacent sans peine dans l'inconnu.
Les jeunes dit de cité vont au contraire affirmer les frontières du territoire, attaché à ce qui est connu. La territorialisation forte du groupe et la loi privée sont les principaux facteurs du non passage vers la société nomade sédentaire. Le passage, celui qui est chargé de faire quitter la sphère du privé vers la sphère publique suppose l'acquisition de la loi publique. Ce savoir faire lié à l'acquisition de la loi publique permet de réguler les relations entres les personnes par le biais de tiers, en juridicisiant les comportements, en conduisant de manière cohérente les dialogues et les échanges.
Ces jeunes n'ont pas réussi à construire le lien civil parce qu'ils sont dans une inversion de l'origine du droit. La déliaison [1] c'est la projection de la sphère privée en lieu et place vers l'espace public qui n'est pas représenté par une certaine frange des jeunes des quartiers.
![]()
« La
cité impose son ordre économe, rectiligne et uniforme : l’espace public et
les espaces collectifs se confondent en un seul bloc ; l’architecture ignore
les courées, les passages, les transitions ; l’espace est ouvert à tous les
vents, il ignore tout des lieux intermédiaires où chacun peut apprivoiser un
peu d’espace public ». Le décor est posé ? La cité est un lieu fonctionnel,
géométrique, rationnellement pensé. Sa vocation, à l’origine, était de
proposer une solution d’hébergement répondant à un certain nombre
d’exigences en matière de salubrité et de confort pour résoudre le problème
de la concentration de populations déshéritées en périphérie des grandes
villes. De ce point de vue on peut considérer, avec une bonne dose de
cynisme, que l’opération est assez réussie si l’on considère que la plupart
des cités regroupent des populations relativement homogènes en termes de
difficultés sociales ? Aussi, les politiques publiques s’efforcent-elle
aujourd’hui de délimiter des territoires de « géographie prioritaire » où la
mobilisation importante de moyens dans les domaines de l’éducation, de la
sécurité, des services, etc. est censée rattraper, en quelque sorte, le
retard accumulé.
L’idée, généreuse au demeurant, est d’appliquer à marche forcée la recette
de l’intégration républicaine pour parvenir à résorber les poches
d’exclusion et réussir une « normalisation » basée sur des principes
égalitaires quant à l’accès aux droits fondamentaux.
Cependant, cette stratégie méconnaît un élément essentiel ? Elle oublie, en
effet, que les cités ont engendré leur propre culture, une socialité
spécifique fondée sur le défi, l’offense, la provocation, l’exacerbation des
sentiments et la proximité sociale. Ainsi, la démesure, la « palabre », la
rumeur, l’agitation, la transe, voire l’émeute, participent des
manifestations festives et ludiques qui ont désormais cours en ces lieux.
Aussi, les propositions des pouvoirs publics qui reposent sur l’instauration
de rapports de nature civile, régentés dans le cadre des dispositions
réglementaires communes, ont-elles toutes les chances de recevoir un écho
mitigé puisqu’elles véhiculent la menace d’anéantir, en grande partie, ce
qui constitue à la base le lien social propre à l’univers de la cité.
Françoise Moncomble suggère donc une autre voie, une nouvelle approche. Il
s’agirait plutôt d’inverser les processus mis en oeuvre dans le champ du
développement local en s’appuyant sur l’existant, sur ce qui constitue la
réalité des relations sociales dans les quartiers pour promouvoir, à terme,
l’essor du lien civil. L’idée est intéressante et originale tout à la fois.
Elle peut s’avérer en sus plus efficace que tout ce qui a pu être engagé
jusqu’à présent. Alors tentons l’expérience ? Un peu d’audace SVP !