


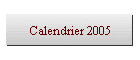


Herméneutique 2
Paul Ricœur - l'interactionnisme symbolique et l'étnométhodologie
Notes de Stéphane HENRY - Le 1er juin 2006
Paul Ricœur
Paul Ricœur (1913-2005) est le grand philosophe qui aujourd'hui fait référence à la perspective à l'interprétation, et très utilisé en science sociale. Intéressé par l'histoire et par les récits en relation à l'histoire
Professeur à la Sorbonne, comme à Chicago, emprisonné dans les camps de concentration. Il a été très proche de la revue Esprit. Ricœur est protestant, et cela revêt une importance car dans l'éducation protestante la bible y est interprétée. Il va appartenir à l'école de phénoménologie, proche aussi des existentialistes. Il s'intéresse au langage et va faire de la sémiologie[1]. Il s'intéresse aussi à l'histoire des religions et la psychanalyse. Il travaille avec l'historien, Decerteau. Il débat avec Lacan à propos de ce que la psychanalyse apporte à l'interprétation.
Il écrit "Histoire et Vérité" 1955 - ouvrage dans lequel il expose ou est la vérité dans l'histoire et qu'est qu'une discipline scientifique qui prétend donc à la vérité lorsqu'elle fondée sur des récits.
En 1965 il écrit "de l'interprétation essai sur Freud" qui traite de la façon dont l'interprétation par l'inconscient peut se suffire. En 1969, il écrit le "conflit des interprétations" ouvrage dans lequel il montre que l'interprétation n'est pas donnée, et qu'il existe plusieurs interprétations selon l'angle sous lequel on interprète. En 1975, il écrit "la métaphore de l'interprétation" : parler sous forme de métaphores donne lieu a beaucoup d'interprétations. Il écrit ensuite "temps et récits" : déclinée en trois tome "l'intrigue et le récit historique" "la configuration dans l'écrit de fiction", "le temps raconté"
En 1986 du texte à l'action, travail dans lequel qui montre que dire c'est faire ou agir et que l'on peut interpréter l'action comme le discours comme par exemple "je te baptise".
En 1990, il écrit "soi même comme un autre". Il interroge a travers cet ouvrage, la phénoménologie, la distance à s'analyser. Il étudie la "mêmeté" (se regarder soi) et "l'ipseité" (s'observer pou débusquer sa propre subjectivité).
En 2000, il écrit "la mémoire, l'histoire et l'oubli", ouvrage qui traite de la différence entre ses termes qui supposent des formes d'interprétations ayant des sources différentes. L'oubli pour Ricœur permet à la mémoire de s'exercer.
"La critique de la conviction" écrit en 2002, qui montre entre herméneutique et conviction soyez dans le doute. Il lutte contre la conviction et préconise le doute.
L'idée du conflit des interprétations, l'herméneutique peut permettre de renouveler la perception et la phénoménologie et l'ensemble de la production des textes et productions artistiques. Le conflit des interprétations le texte pour Ricœur c'est la façon dont il reçu. Chaque communauté va avoir une lecture différente d'un texte. C'est toute la culture face un texte qui se met en jeu dans un groupe social ou une communauté. Ricœur fait appel à une ontologie de l'interprétation ou de la compréhension, c'est à dire l'interrogation sur le sujet qui interprète ou qui comprend.
Dans le conflit des interprétations fait une distinction avec la psychanalyse pour laquelle il y a une sorte d'inconscient commun sur lequel tout s'analyse. Pour Ricœur, chacun à une culture qui donne un regard, une interprétation.
Chaque individu, chaque culture interprète. La réception d'un discours politique va analyser le discours d'une manière différente. Et chacun peut prétendre à une interprétation.
Ricœur propose une réflexion sur la position de sujet entre soi et JE, entre le même (continuité) et le soi (ipséité). Ce soi entraîne à s'interroger sur le langage (qui parle et comment) et sur l'action (qui agit et comment). Le même discours selon qui l'émane d'un professionnel ou d'un politique, d'un ouvrier sera différent.
Ricœur dit qu'il y a une identité personnelle et une identité narrative.
L'ouvrage "temps et Récit" Ricœur s'interroge sur notre par rapport au temps des humains le rapport au récit et donc aux fondements de l'histoire. "L'intrigue et l'histoire" à partir des "confessions de Saint Augustin", les temps se télescopent et se contredisent alors que la poétique d'une tragédie grecque il y a une concordance des temps.
Il en tire l'idée que le récit est toujours une construction, comme tout discours narratif. Le récit prend donc de la distance par rapport à la vérité, et le narrateur s'introduit dans cette "vérité". Le récit s'entoure de métaphores, où le narrateur se donne bonne figure. Ricœur pense donc qu'il y a peu de différence entre un récit historique et un récit historique. La seule différence, c'est que dans le récit de fiction on prend le parti de raconter une histoire et dans l'autre il s'agit de raconter une histoire à partir d'un fondement sur la prétention à la vérité. Il faut donc que les historiens soient modestes et qu'ils interrogent sur les façons dont les récits sont mis en intriques les manières dont les récits sont racontés.
Michel de Certeau dans "les art de faire" défend l'hypothèse que les consommateurs quels qu'ils soient produisent une poïétique[2], quelque chose. Nous voyons toujours ce que font les producteurs mais jamais ce que façonnent les consommateurs, comme pour la ménagère va créer des occasions à partir de c'est qu'elle a dans son frigo et en fonction des promotions qu'elle va rencontrer. Ces bricolages ont un intérêt, notamment pour les travailleurs sociaux pour mieux comprendre ce qui se passe, mais aussi pour les politiques, les producteurs.
Les courants de l'interactionnisme symbolique et l'éthnométhodologie
L'interactionnisme symbolique
L'interactionnisme symbolique fait référence à G. Mead qui a travaillé sur le rapport entre les individus, promu par des travailleurs sociaux qui se questionnait sur la ville et sur l'immigration, les bandes de jeunes et les délinquants. En se questionnant sur ces sujets ils avaient théoriser sur les récits de vie et sur les interactions, c'est à dire l'idée que la société est faire des échanges et des interactions entre les individus. L'explication de la société c'est les interactions et les échanges entre les individus. Ces interactions sont des échanges dans des situations où chacun va réagir par rapport à l'autre. Chacun agit en fonction de l'autre où le comportement de l'autre est interprété et cela interagi ensuite dans les échanges. E Goffman écrit dans "la présentation de soi dans la vie quotidienne" "stigmates" "les rites de l'interaction". Il dit que l'individu essaye de donner une bonne image de soi et que l'on n'est pas naturel. Il ajoute qu'il y a des rites d'interactions dans la vie quotidienne. La vie est rythmée par ces rites.
Ce mode d'analyse des interactions, Goffman va l'appliquer dans "asiles" et "stigmates". Dans "asiles" il analyse les interactions des personnes dans un hôpital et dans "stigmates" les interactions entre personnes handicapées et personnes ordinaires. Leur méthode c'est l'observation. Les interactionnismes ont regardé comment cela se passe dans un commissariat ou une file d'attente.
L'éthnométhodologie
L'éthnométhodologie va ériger l'interactionnisme en modèle en élargissant à toutes sortes d'échanges dont les conversations. C'est l'analyse du social au quotidien, qui reprend l'ensemble des échanges entre les individus. Pour les éthnométhodologues les acteurs savent décrirent une situation et donc de la raconter, l'analyser et ils sont capables de réfléchir aux situations et d'en donner un sens et d'avoir le type de langage adéquat (on ne parle de la même façon selon qu'on s'adresse à des enfants, à un patron, ou un ami).
Ils s'intéressent à la contextualisation (différence de comportement selon le contexte, le lieu). Garfinkel a beaucoup travaillé sur les délibérations de Jury de tribunaux, et partir des échanges enregistrés qui peuvent pour certains très longs avec les essais de convaincre, de dénier, d'infirmer etc… pour finalement montrer que les acteurs arrivent à une décision aboutie avec toutes les interactions qui ont été produites.
Ces deux courants disent en fait que l'on peut tabler sur le discours des acteurs.
![]()
En linguistique, la théorie générale des signes a fait l'objet d'études par, entre autres, évidemment Ferdinand de Saussure, ou, plus près de nous, par Buyssens, Mounin, Barthes et Umberto Eco.
La sémiologie (du grec « séméion », le signe, et « logía », discours rationnel) apparaît être une discipline récente, fille de la linguistique. Beaucoup d'auteurs voient en Ferdinand de Saussure, linguiste genevois, le fondateur de la sémiologie ; il fut en effet le premier à en donner une définition, ou plutôt à en circonscrire le champ d’action : « On peut donc concevoir une science qui étudie la vie des signes au sein de la vie sociale ; elle formerait une partie de la psychologie sociale, et par conséquent de la psychologie générale ; nous la nommerons sémiologie. Elle nous apprendrait en quoi consistent les signes, quelles lois les régissent. Puisqu’elle n’existe pas encore, on ne peut dire ce qu’elle sera ; mais elle a droit à l’existence, sa place est déterminée d’avance. La linguistique n’est qu’une partie de cette science générale… » (De Saussure, 1972 [1916], p. 33).
De ce point de vue initial, qui lie intimement sémiologie et linguistique, nombreux seront les auteurs qui chercheront à affiner cette définition en l’orientant vers des champs et objets plus spécifiques. Par exemple, Buyssens s’est proposé de définir la sémiologie comme « la science qui étudie les procédés auxquels nous recourons en vue de communiquer nos états de conscience et ceux par lesquels nous interprétons la communication qui nous est faite » (Buyssens, 1943, p. 5). Il apparaît clairement que l’étude de la communication y est spécifiquement mise en valeur.
Aujourd'hui, le second sémiotique prédomine. Il fallait donc que le premier se cantonne dans un sens plus spécialisé ; ce fut celui de la description spécifique de systèmes de signes particuliers. Pour Hjelmslev, la sémiologie est une sémiotique dont le plan du contenu est lui-même une sémiotique. Cette distinction est d'une certaine manière reflétée ici. D'une démarche plus consciente, nous avons voulu, dans l'expression « système sémiologique » par exemple, introduire entre sémiotique et sémiologique la même nuance que celle qui existe entre phonétique et phonologique : une nuance entre la science de la substance et celle de la forme.
La poïétique a pour objet l'étude des potentialités inscrites dans une situation donnée et qui débouche sur une création nouvelle.
Arts
En art, étude des processus de création. L'auteur René Passeron y consacra un texte, "La poïétique".
Récupérée de wikipédia