


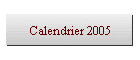


Herméneutique 3
Le courant pragmatique
Si les acteurs peuvent interpréter, a quoi servent les sociologues ?
Comment les acteurs construisent les discours
1) La posture, les débats et les positions tenues dans le courant pragmatique
le débat entre comprendre et expliquer. Le courant pragmatique est dans la compréhension. Dilthey dit qu'il y a un dualisme dans les sciences, et dit qu'il y a une différence entre les sciences de l'esprit (compréhension) et les sciences de la nature (explication).
Gadamer rebondit sur la position de Dilthey en disant que la compréhension et l'interprétation sont un mode de reconnaissance de la réalité qui peut prétendre à la même validité que les sciences de la nature.
La compréhension et l'interprétation existent dans la vie ordinaire dans tous ce qui est communication et que même dans certaines approches des science de la nature on peut commencer par de l'interprétation.
Gadamer explique que comprendre et interpréter c'est expliquer le langage (linguistic turn), mais aussi la connaissance de la vie sociale (difficile de comprendre les acteurs s'il l'on ne connaît pas la culture des acteurs), enfin faire le lien entre le discours et le contexte historique.
Gadamer dit que cette compréhension nécessite qu'il y a est une communication entre
Comprendre une langue ne nécessite aucune interprétation, il suffit de vivre en elle. Pour Gadamer, il ne suffit de comprendre la langue, il faut aussi s'entendre sur les termes employés sinon les interprétations deviendraient caduques.
Le problème de cette compréhension c'est qu'il y a interprétation. Dans toute communication, la compréhension ne peut être immédiate, il y a nécessairement de l'interprétation. La traduction oblige à reconstruire le sens authentique du texte dans un horizon linguistique nouveau. Une traduction implique une compréhension véritable que l'on peut expliquer. Les outils pour cette compréhension du sens c'est : comprendre le passé et interpréter les textes.
Gadamer s'oppose à Dilthey[1] sur la posture de l'interprète :
Pour Dilthey l'interprète doit être au plus près du discours de l'acteur afin d'en neutraliser sa subjectivité.
Pour Gadamer : comprendre un auteur du passé c'et prendre en compte la dimension historique entre le discours et les faits.
Entre ces deux positions, le biais possible est que tout interprète soit conscient de sa subjectivité.
Gadamer propose une "fusion d'horizon" c'est à dire le rapprochement de la vision de l'historien et de l'acteur qui a raconté l'histoire ou fait le discours. Elle se fait par essais et erreurs, elle s'ajuste au fur à mesure.
"Tout objet social n'est constitué que des interprétations que l'on en fait" Gadamer.
Par ailleurs Gadamer dit que l'on ne peut chercher que des préjugés, présupposé, hypothèses.
Ceci signifie, que le processus de connaissance est illimité, on peut toujours ajouter aux interprétations précédentes. Gadamer dit qu'il n'y a pas de distinction entre l'objet et le sujet qu'il interprète. L'ensemble fait une totalité.
La précaution a prendre c'est de contrôler ses préjugés et de les vérifier en les passant à la question
Tout interprétation se fait à travers le langage. Tout ce qui peut être compris est langage. Toute l'expérience du monde est langagière. Toutes les institutions sociales découlent du langage. Le langage est la fois constitutif est interprétatif.
Ricoeur par rapport à cette position dit que expliquer plus c'est comprendre mieux. Par exemple resituer un discours dans la sémiologie (science des signes).
Un autre outil est d'utiliser la théorie de l'action (rationalité de l'action)
Ricoeur propose aussi d'utiliser l'histoire, discipline qui est aussi une façon de comprendre mieux.
Habermas va vouloir réintroduire de l'objectivité dans ces courants par une inscription de l'interprétation dans une méta-herméneutique. Il dit qu'il n'est pas raisonnable et insuffisants que d'utiliser seulement les échanges de la subjectivé pour comprendre la réalité. Il faut rechercher les structures génératives de ces discours, de ces situations. Quels sont les processus qui ont produites les situations que l'on peut objectiver. Par exemple concernant la crise des banlieues, on peut objectiver cette situation en terme de classes sociales, de précarité, l'urbanisme, l'immigration etc…
L'idée de la compréhension renvoie à la mémoire et l'histoire, la mémoire étant subjective. C'est l'histoire qui permet de transmettre la mémoire.
L'herméneutique et l'ethnologie
Les ethnologues sont très soumis à l'histoire, la subjectivé et l'interprétation. G. Leclerc a écrit "lobservation de l'homme". Il dit que l'observation de l'homme était souvent assimilée à du contrôle sociale, on observe souvent les classes pauvres. Leclerc écrit que celui qui observe n'est jamais un sujet transcendantal, c'est à dire sans subjectivité mais il est membre d'un groupe culturel et politique et celui qui est observé n'est jamais Homme mais des groupes sociaux et culturel. Autrement dit, toutes ethnologies est le fait de sujets situés avec ses subjectivités
L'ethnologue et l'altérité
F Alfergant qui oppose différence ou altérité. Au 16 ou 17ème siècle, les explorateurs découvraient des cultures dont ils n'avaient aucune idée. Ils étaient donc extrêmement disponibles et à priori sans préjugés. Il fait une opposition avec les ethnologues du 19éme car, ces derniers regardaient ces populations par rapport à la culture occidentale et dont la comparaison primait.
Les travaux de Conrad ethnologues du 19ème ont fait des études très savantes. On a retrouvé aussi leurs journaux dans lesquels on a constaté qu'il y avait de l'affectivité, ce qui indiquait que l'ethnologue pouvait avoir une subjectivité et qu'il fallait la prendre en compte dans l'étude ethnologique.
J. FAVRET SADA dans "Les mots les morts les sorts" écrit les 40 premières sur la subjectivité. Pour comprendre la sorcellerie, il fallait qu'elle puisse s'impliquer pour comprendre le phénomène de sorcellerie en tant que des-ensorceleuse.
Grignon et Passeron se pose la question : lorsque l'on veut des classes populaires est-ce que on les prend en tant que telle ou bien on les prend sous l'angle du rapport à la dénomination.
R. HOGGART qui écrit la culture du pauvre est un sociologue né dans un quartier défavorisé. Il fait une ethnologie de la culture du pauvre puisqu'elle c'est la sienne.
Les ethnologues vont préconiser l'implication, la subjectivité, l'interprétation plutôt que l'objectivité.
Dans "l'autre et le semblable" des sociologues explicitent …
Les ethnographes disent qu'il faut tenter de penser le même avec les yeux de l'autre. Pour d'autres ethnologues, il ne faut pas se perdre dans le regard de l'autre, car il serait alors impossible de donner quelque chose, de donner une interprétation.
Les compétences des acteurs et le courant pragmatique
Pour les sociologues ce tournant pragmatiques va transformer les façons de travail puisqu'ils vont partir du discours des acteurs, et pas forcément produit pour eux. Ces discours sont pris pour matériaux sociologiques avec le présupposé que les acteurs sont intelligents, c'est à dire qu'ils savent donner du sens, savent s'adapter à la situation. Pour prouver ces compétences des acteurs, Boltanski et Thévenot, sociologues tenants du courant pragmatique, ont écrit "de la justification" ils montrent la compétence du discours des acteurs en les confrontant, en les mettant en parallèle avec des discours produits par des savants dans six domaines, appelés "cité". (dieu, domestique et le discours de Bossuet, la cité de l'opinion et le discours de Léviathan, la cité civique et le livre du contrat social de Rousseau, la cité marchande et al référence c'est "la richesse des nations d'Adam Smith….
![]()
[1] Dilthey (Wilhelm), philosophe allemand (Biebrich 1833 - Seis, Tyrol, 1911). Il est le premier auteur qui ait assigné un statut autonome aux sciences humaines.
(Petit Larousse)