


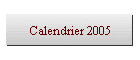


Notes Stéphane HENRY
Le 29/03/07 L'activité politique – F.Moncomble.
Plan :
Ø Qu'est-ce que le politique ?
Ø Distinguer entre le politique comme essence (activité définie et permanente)
Ø Distinguer entre le politique comme pratique et contingence
Ø Le politique comme production de l'objet de l'ordre
Ø La donnée étant la société
Ø Les moyens du politique : force, droit, la ruse
Ø Distinguer entre la société au regard des sociétés qui empiriques, circonstancielles
3 niveaux d'analyse qui valent méthode
l'inné de société
les rapports entre société et politique
la société politique
Introduction
Référence : J. Steinbeck[1] "les raisins de la colère" qui décrit l'état de Société
A) A partir de l'angle aristotélicien, la société est un fait de nature, qui est uniquement à organiser. Il est de nature humaine de vivre en société et de l'organiser politiquement. L'homme est un être politique naturellement fait pour vivre en société (Aristote). C'est à dire que la politique est essence et pas une simple convention.
Une être sans Cité, n'est pas un homme, il soit un être inférieur (animal) soit un être supérieur (Dieu).
L'état politique est donc spécifique, il est originaire, l'état politique n'est pas antérieur à l'état social. Seuls les régimes sont contingents. Il n'existe pas d'état social qui soit apolitique ou qui est été précédé avant que l'Homme soit né. Le politique est une donnée comme les autres essences (art, économie). L'homme est simultanément politique artistique, économique L'histoire n'est que la manifestation des différentes essences qui s'exprime différent selon le temps.
A partir de ce postulat, plusieurs conséquences :
politique et société ont un rapport différent. La politique quel que soit le régime produira de l'ordre
la société va produire des limites, des contraintes et vivre en société incombe à l'homme d'organiser et de réorganiser sans cesse cet état de discordances (le mélange des différentes essences) la société. Le politique est consubstantiel à l'homme. La politique est la résultante.
la société est la matière première de l'activité humaine, du politique, la société comme fait de nature ne peut se comprendre historiquement que par le biais des activités qui la façonne et du sens qui lui sont données. Le politique va donner une forme à la société.
La sociabilité naturelle et l'état de nature (Rousseau) qui pense que la nature est naturellement bonne. Pour Aristote, au contraire, la société ne peut pas se poser ainsi, il n'y a pas d'ordre social naturel. Organiser la société, c'est fabriquer de l'ordre et des contingences (Weber). La société est une entité parfaitement abstraite.
Pour reprendre l'idée de Rousseau, sur la sociabilité naturelle et l'état de nature, la question n'est pas vraiment tranchée. Si cet état de nature servait à déterminer ce qu'il y avait de parfaitement conventionnel, si il y a société il y a commandement, mais cela signifie aussi que la nature ne peut désigner le titulaire du commandement. Seul l'homme désigne le commandement. Il es donc tout a fait possible de changer des régimes de société, et renverser par exemple les sociétés monarchiques qui disent avoir été désigner par Dieu.
L'humanité peut il vivre sans société et les observations ont montré dans l'histoire, que les hommes se sont toujours regroupés.
Le rapport entre l'individu et la société
Quand on traite historiquement on dit que l'homme est soit antérieur à la société ou la société antérieure à l'individu, politiquement c'est l'opposition entre le libéralisme et le socialisme.
Si l'individu s'oppose à la société, ils ne peuvent s'exclure. Suivant les circonstances tantôt l'homme est hostile ou collaboratif à la société. C'est un rapport plutôt conflictuel, un paradoxe impossible. Il n'est donc pas possible d'avoir une réponse définitive et universelle.
L'objet de la rivalité entre les partis, c'est l'enjeu entre le privé/public, c'est la répartition respective entre individu et société.
Le rapport entre société et politique
Dans la lignée aristotélicienne, c'est une essence constitutive de la société. L'enjeu du politique, c'est de déterminer le commandement. Il n'y a pas de politique innocente, et dans ce sens là, la base du libéralisme et du socialisme. Les moralistes du 18ème provoque la séparation de l'état et la religion. Le résultat de cette grande rupture, c'est une série de faux débats sur l'homme est soit antérieur à la société ou la société antérieure à l'individu.
Pour Marx, originairement politique et société s'implique mutuellement, et c'est la raison pour laquelle il faut dépolitiser la société, pour provoquer un dépérissement de la société au profit de la doctrine économique.
La séparation entre politique et société n'a qu'une seule source la croyance de la spontanéité de la société. Il existe 2 versions : libérale (il faut organiser l'activité humaine pour qu'elle produise pour l'ensemble) et socialiste (l'homme serait immédiatement producteur de lui même, par libre développement).
Il vaut mieux repartir du banal de l'expérience :
Ø La société n'est pas entreprenante
Ø Elle est donnée par l'activité des hommes
Ø C'est une pure abstraction, ni associée ni dissociée
Ø La société, c'est une visée des hommes qui lui donnent à la fois forme et un sens (elle ne s'aménage pas elle même, elle n'a donc pas de statut, elle n'est pas en elle même ordre, égalitaire. Elle tiraillée par les la multiplicité des activités humaines, des intérêts divergents. La société c'est d'abord de l'hétérogène.
Mais on ne connaît de la société, que des formes organisées, et admettre qu'elles sont plus ou moins valables.
L'enjeu essentiel de l'activité politique, c'est le produit de l'ordre (univers de règles de lois, de limites). On ne connaît de la société qu'une réalité hétérogène qui ne tient ensemble que par l'unité politique. C'est l'activité politique qui introduit à l'ordre, à la justice…
Confusions courantes
Société et politique, on ne peut pas dire que tout le social est politique. C'est à dire que politique et société ne sont pas de concepts co-extensifs. Il existe une ambiguïté sur tout ce qui qualifie la société. La question sociale par exemple, c'est le rapport social entre le politique et le social ; le politique ne recouvre tout le social parce qu'il existe un antagonisme des essences (religion, art, esthétique). Ces essences sont d'abord des relations sociales et deviennent parfois politiques provoquent des antagonismes. Toutes les relations sociales se laissent politiser, mais toutes relations sociales ne sont pas politiques. (Par exemple, la construction sur le domaine public d'une mosquée, la relation sociale de la religion devient politique car elle ne se fait plus dans le domaine privé.)
Une essence même politisée, ne perdra pour autant de son sens. La politique est une relation sociale spécifique parmi d'autre mais transversale à toutes les autres puisqu'elle a en charge leur organisation.
Société politique
La fonction première c'est de produire de l'unité. C'est à dire, que cette société va proposer des moyens politiques (force, droit, la ruse) pour obtenir des commandements mais aussi de l'unité. La question qui se pose c'est la nature l'unité.
![]()
[1] Steinbeck (John), écrivain américain (Salinas, Californie, 1902 - New York 1968). Ses romans peignent les milieux populaires californiens ( Tortilla Flat, 1935 ; Des souris et des hommes, 1937 ; les Raisins de la colère, 1939 ; À l'est d'Éden, 1952). [Prix Nobel 1962