


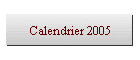


ÉVOLUTION DU RAPPORT SOCIAL A L’EXCLUSION Le 09/02/06
Notes de cours prises par Marie
Selon moi le point : 2- les grandes étapes charnières et les modèles d’interprétation – a été vu le cours précédant.
Il s’agit ici (je pense) du point : 3- cours informatif et épistémologique- mettre en scène la révolution du regard, de l’identité, des repères. Paradigme de l’altérité prérévolutionnaire (l’autre est entièrement autre) vers la problématique identité et identification (l’autre est potentiellement soi), tension intégration –exclusion liée au monde démocratique.
Ou comment on passe de la société de l’Altérité aux sociétés de l’Identité.
Réf. Bibliographiques : M Gaucher, Gladys Swain, La politique de l’Esprit Primaire, Gallimard, les idées.
Ce qui a été touché par cette révolution du regard, c’est le statut des « infirmes de la communication ». Avant la révolution française, les fous, les aveugles, les sourds, les muets, les idiots n’étaient pas considérés séparément. En 1812, une grande enquête nationale de recensement rapproche les aveugles, les insensés, les sourds de naissance. Catégories pour nous complètement disparates.
La question sous-jacente est : comment ces sociétés traditionnelles occidentales pré révolutionnaires, concevaient- elles la notion d’échange ?
A- les Sociétés de l’altérité
L’humanité est définie par la possibilité de communication. Ainsi les infirmes du signe (tels que définis par Gaucher et Swain), sont symboliquement réputés exclus de l’humain, parce qu’ils sont réputés être impuissants à la réciprocité. On peut parler au fou, mais hors de la raison, hors du sens (forcené).
Sous Louis XV, Louis XVI, comment ces sociétés s’accommodent-elles de cela ? car le cadre symbolique n’était pas celui de l’intégration. Il y a une place , une case à part pour ces hommes exclus de la société.
L’homme est un autre pour l’homme : un aristocrate ne se sent rien de commun avec le pauvre (une marquise peut se baigner nue devant son valet, car pour elle il n’est pas un homme). Les « pauvres », les infirmes…. sont collectivement tolérés. Ils ne gênent pas , on ne les voit pas. On ne cherche pas à les intégrer, ils sont radicalement autres par nature ou par essence.
A ces époques là l’altérité, le rapport à l’autre est de l’échange social. Le groupes (de fous, insensés…) échappent à la réciprocité sensée, ils restent enfermés en eux-mêmes.
Au 18ème, les monstres, les infirmes n’effraient personne (quasimodo…) ne gênent pas, ils amusent. C’est le contraire exact de notre malaise moderne (métro et indigents : on détourne le regard).
Les monstres distrayaient les hommes du 18ème, car ceux-ci ne se sentaient rien de commun : spectacles avec des infirmes, aller voir les monstres.
Les infirmes sont voués à l’isolement ; c’est un statut de séparation ( aujourd’hui de ségrégation) ; ils ont une place mais entant qu’autres.
B- Le passage entre les sociétés de l’altérité et les sociétés de l’identité
C’est l’invention du rapport moral qui fait passage. Vont être désormais possibles et recherchées des situations de communication. L’homme va cesser d’être un autre pour l’homme.
Il s’agit de la révolution de l’appartenance. il y a toujours une possibilité d’inclure ceux qu’on tenait jusqu’alors hors humanité en instaurant des pratiques de communication.
Exemple 1 : les aveugles – 1782 : Valentin Haüy a l’idée d’inscrire des paroles et musiques en relief sur du papier, après avoir vu 10 malheureux aveugles s’offrir au ridicule pour vivre.
Il s’agit là d’une rupture absolue : secourir par le tact
V.H. refuse le statut de séparation de fait de ces êtres. Le médium auquel il est fait appel (le tact, le toucher) remplace la matérialité de l’œil qui ne voit pas.L’aveugle c’est moi potentiellement, donc je lui propose une stratégie de substitution. J e l’ammène ainsi dans le cercle de la communication.
Les schèmes mentaux bougent.
Exemple 2 : la vue et la voix.
Depuis le 17ème un vaste mouvement est en route. Certains commencent à postuler la question de l’identité (philosophes). L’humain est complet, toujours conservé, même à l’état latent chez ces êtres qui sont soumis au commerce de leurs semblables.
Le manuel de l’Abbé de l’Épée, en 1785 : la Véritable Manière d’Instruire les Sourds constitue une véritable rupture épistémologique (cassure de sens), entraînant des réactions extrêmement violentes.
Exemple 3 : Seguin, (Hygiène et éducation des Idiots, annales de l’hygiène publique) fut le premier instructeur des idiots.
L’enjeu est de taille : prémices des éducations spéciales qui ont pour fondement des stratégies de contournement pour relier des êtres « handicapés » au cercle de la communication.
Pour en revenir à l’Abbé de l’Épée et à son instruction des sourds et muets, il s’agit d’une entreprise méthodique, avec l’invention de signes, de codes,. C’est une entreprise publique (# théologique) et collective avec donc une dimension sociale, qui correspond à l’objet de nos professions, réaménager des sociabilités par équivalences.
C- L’identité dans la différence – problématique actuelle, moderne.
1800 : pratique nouvelle du traitement de la folie - rapport moral – traitement moral (Daquin aliéniste, philosophie de la folie)
Auparavant, la représentation de la folie était binaire : on est fou ou pas.
On était pas du tout aliéné ou totalement aliéné (enfermé, camisole de force, masse de chair, rien d’humain).
Le traitement de la folie était lui-même partagé :
- selon une vision morale théologique : cure de l’âme, sermons, exhortations religieuses), la folie étant considérée comme une volonté, un choix de l’illusion contre la vérité du monde.
- Vision médicale, organiciste, défaut des organes, thérapeutiques du corps épouvantables (jeûnes, bains froids…)
Dans les années 1800 : traitement moral ; stratégie de contournement symbolique, par une pratique de communication.
C’est un déplacement du sujet dans l’espace de l’inter-locution qui advient ( ?). L’intérieur du lien interhumain qui permet à la fois de parler aux fous et à la part qui lui reste de raison ; une modification du rapport inter subjectif, reconnaissance de l’autre comme sujet.
Le fait psychiatrique est lié à la naissance révolutionnaire de l’esprit démocratique.
Les nouveaux repères anthropologiques fondent les éducations spécialisées ; la notion d’éducabilité advient. Constat d’un retard pour les « idiots » réputés incurables, pas comme les fous (Cf. Esquirol vers 1838-40, traité des maladies mentales, les idiots ne pouvant diriger leur sens, ne sont pas éducables).
Rupture en 1840 avec Seguin, mais pendant 50 ans pas d’appareil, pas de prise en charge. Les fous, les idiots…= bastion où se réfugient les dernières représentations de l’altérité.
1835 : Félix Voisin ; 1er établissement ortho phrénique (=redresser le cerveau)
Art de bien rééduquer les fonctions intellectuelles ; idiot rééducable
Principes :
- de continuité : il n’y a pas de rupture dans l’échelle humaine, qui comporte une foule d’états, avec des degrés intermédiaires (théorie de l’évolution de l’espèce).
- De conservation : l’idiotisme est rarement complet : les les caractères de l’humanité ne sont pas tous effacés. Proximité ressentie, un reste d’âme, d’intelligence, même latent, derrière le désastre apparent des facultés.
- De réactions interactives ; ce qui reste d’âme contient tout – dynamique réparatrice. On peut avoir prise sur lui par le moyen du signe. Il est éducable, pas seulement gouvernable de l’extérieur, mais aussi accessible de l’intérieur, mobilisable.
Un nouveau système de repères anthropologiques.
|
l’homme peut être un autre, | |
|
il n’y a pas un dedans un dehors- l’humain accroche l’humain – remaniement des limites entre le dedans et le dehors, | |
|
refus du principe de l’exclusion, de l’extériorité totale, | |
|
ce qui entraîne un devoir de curabilité (= toute la chaîne des éducations spéciales), volonté d’inclusion, d’annuler les différences, fondre, assimiler, | |
|
évolution à l’intérieur d’un immense dedans. |
Revenons à 1840 avec Seguin et le traitement de l’idiotie (manuel d’instruction des idiots) et les stratégies de contournement : « Eschiroles disait que les idiots sont incurables, soit, mais dans un cadre médical, alors il faut sortir du cadre médical », l’enseignement doit suppléer (quand un problème est insoluble d’une façon,il faut renverser l’angle de vue) .
Ce qui ouvre la voie au traitement moral : l’idiot peut rentrer dans sa famille, s’il ne peut rentrer dans la société. Un gain de sociabilité doit résulter du travail éducatif. Faire passer l’idiot à l’état d’être sociable. L’éducateur ouvre au dehors. L’idiot cesse alors d’être enfermé dans sa masse de chair. Cesser d’être idiot c’est cesser d’être isolé au sens social (# sens médical). L’idiot établi volontairement le plus de relation possible avec le monde.
Une conception de l’insertion
Redéfinition généralisée des puissances du cercle, monde entièrement social, espace généralisé de la communication.
L’exclusion est structurellement liée au processus démocratique. L’exclusion ne peut pas disparaître, elle est au centre par l’effet des logiques égalitaires du processus démocratique………