


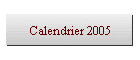


ÉVOLUTION DU RAPPORT SOCIAL A L’EXCLUSION
Notes du cours de Marie 26 janvier 2006
Éléments de bibliographie :
-BARREL Yves, La Marginalité Sociale, PUF, la politique éclatée, 1982.
-XIBERRAS Martine, Les Théories de L’Exclusion,……, 1993.
-THOMAS Hélène, La Production des Exclus, Société d’Aujourd’hui, PUF, 1997.
Plan du cours
1. Rapport Historique
Les fous, les malades, les marginaux, les infirmes sont nécessaires à l’établissement d’un ordre social central dominant (qui fonde la norme, cf. M..)
Cf. M. Mauss, T. Nathan, G. Devreux…..les ethnopsychiatres.
L’exclusion est la variation de ces formes de ces cibles, elle dit quelque chose sur les sociétés qui la façonne – qui ont pour symptôme la fabrication de tel ou tel groupe d’exclus.
2. Les grandes étapes charnières et les modèles d’interprétation
3. Cours informatif et épistémologique –mettre en scène la révolution du regard, de l’identité, des repères.
Paradigme de l’altérité prérévolutionnaire (l’autre est entièrement autre) vers la problématique identité et identification (l’autre est potentiellement soi)- Tension intégration- exclusion liée au monde démocratique.
4. Notion des besoins
5. Le rapport du système législatif et handicap, ou les carrières d'un concept (disqualification, désaffiliation)
Préalable : les théories de la sociologie classique ignore le concept d'exclusion mais travaille sur le fait de pourquoi les hommes vivent ensemble, et s'interroge sur les résidus de la cohésion globale, l'exclusion ce sont les ratés du lien (Durkheim, Simmel)
Cf. XIBERRAS
3 grands mondes des théories de l’exclusion
Ø Sociologie classique –DURKEIM….- qui ignore la notion d’exclusion en tant que concept à part entière, constitutif de la société. Cohérence globale
Lien social positif – pourquoi, comment les hommes vivent ensemble ? Ordre social. L’exclusion est un disfonctionnement, un accident, un raté.
Ø Théories de la déviance fin 19ème
« Exclus », « marginaux » sont des facteurs de désagrégation, de décomposition du lien social.
CF. école de Chicago : intégrer ou pas des vagues d’immigration.
Ø Sociologie moderne- contemporaine CF. XIBERRAS
1- regard historique du rapport social à la pauvreté, à l’exclusion.
En période de croissance, on se délivre de la rareté : Les 30 Glorieuses → crise du pétrole en 73→ en 74 sortie du livre de LENOIR, Les Exclus.
Le rapport social à la pauvreté a engendré l'exclusion. Ceci pour illustrer que la pauvreté est un phénomène vivant, multidimensionnel, qui ne cesse de se métamorphoser. C'est aussi une perception et un codage de la société. Les attitudes, les représentations, le regard social changent en fonction des sociétés.
Au Moyen-âge (époque théologique)
Après la chute de l’empire romain suit l’expansion du christianisme.
J. LEGOFF souligne que le contexte fait évoluer l’objet au travers de justifications philosophiques qui induisent des formes sociales, de représentations collectives … matrices de sens du phénomène de l’exclusion.
Ainsi posent on les bases idéologiques de la marginalité:
Communauté sacrée –ECCLESIA[1] : brebis rassemblées autour du Christ, qui représente le centre du monde pour l’homme. Monde partagé entre Clercs et laïcs. Tout ce qui est différent du dogme est assimilé à de l'hérésie.
PURETE croyance absolue à l’union de l’âme et du corps. Le corps et ses stigmates qualifient l’âme. Ainsi les lépreux et les difformes, les infirmes sont ils exclus.
Normalité la nature s’assimile strictement à Dieu. La nature est l’œuvre divine. Refus du mixte, de tout ce qui va contre la simplicité de la nature (ex. refus de l’homme sauvage mi-homme mi-bête).
Dans ce monde se repèrent 4 grands groupes d’exclus :
Ø Les criminels : voleurs, bandits, errants, nomades, gitans, bohémiens, tous ce qui n’appartient pas à l’ordre fermé, prostitution, suicidés, hérétiques.
Ø Les dévalués : tous les métiers déshonnêtes associés au tabou du sang : Bouchers, bourreaux, soldats, teinturiers, mercenaires.
Et aussi les malades, les infirmes, les pauvres, les femmes (sauf dans l’aristocratie), les bâtards.
Ø Les marginalités imaginaires : les merveilles géographiques (source qui disparaît, marais gigantesques…, monstres, homme sauvage…
A partir des ces trois grandes matrices de sens, les bases de la marginalité c'est de désigner ceux qui représente un danger pour l'ecclésia, (chrétienté fermée, close, l’enjeu étant la simple reproduction du même). L'insécurité produit une pensée binaire, manichéenne ce qui fait qu'il y a de manière permanente une autorité, le plus grand des péchés est de vouloir échapper à l’ordre voulu par Dieu à la naissance. Autour de ces grands repères, la société va s'organiser autour de six obsessions :
1. la religion, le dogme, éviter ce qui sépare le bon chrétien des hérétiques (croisades, pourchasser les sorcières)
2. le corps : union sacrée de l’âme et du corps. La maladie, le corps mutilé, difforme sont redoutés. Il est le lieu de symptôme d'incarnation du pêché.
3. l’identité : société du cercle fermée, rapport à l’étranger, l’autre, le juif….
4. tout ce qui est contre nature : sodomites, monstres
5. tout ce qui va menacer la stabilité publique ou l’ordre social : errants, bohémiens. Ce qui entraîne les conflits sédentaires nomades (ce qui perdure jusqu’au 19ème siècle : veuves chassées des corons, célibataires pas admis).
6. rapport au travail : le travail est le résultat du péché originel. Puis à partir du 13ème siècle, les oisifs, les mendiants, vont être l’objet d’un rejet général, l’ordre marchand prend naissance. Il faut mettre au travail de plus en plus de franges de la population. Les villes sont en expansion. Les métiers auparavant illicites sont réhabilités (métiers du sang, de l’argent).
Il existe une proximité paradoxale de la marginalité, une fascination évidente. La marginalité est éloignée par le marquage symbolique, mais proche et visible au quotidien (R GIRARD : théorie du bouc émissaire dans La Violence et le Sacré)
Il s’agit de distinguer entre les pauvres. C’est en repères théologiques, que cette distinction va se faire :
Ø La charité, glorification de la pauvreté : valorisation du pauvre, vicaire du christ, pauvre entre les pauvres, à l’image de la divinité, intercesseur entre les hommes et le monde divin. Le pauvre est indispensable à l’équilibre social, aussi par sa résignation qui permet l’offrande et ainsi le rachat des péchés. Cependant, il s’agit de secourir le pauvre et non pas de combattre la pauvreté.
Ø Organisation de la charité, du 11ème au 14ème siècles, essaimage des institutions d’assistance (aumônes) sans distinction, sans sélection.
Au milieu du 14ème s. les mentalités s’inversent, à cette image positive du pauvre, succède une image dévalorisée. La guerre de cent ans jette les pauvres dans l’errance, les épidémies, les contagions contribuent à leur rejet (les gueux, les jacques).Ils sont inutiles au monde, présente un caractère de dangerosité. La pauvreté est le résultat d’un péché, la punition d’une faute.
La société distingue les bons pauvres et les mauvais pauvres (distinction qui perdure). Les bons pauvres sont pauvres comme le Christ, les mauvais pauvres qui n’ont pas la volonté de travail (vrais et faux chômeurs). Des ordonnances royales règlementent les critères de l’assistance. Les mendiants valides sont contraints au travail. L’inscription aux distributions publiques est réglementée.
L’urbanisation entraîne la nécessité de nourrir la population, à créer du travail.
Cf. CASTEL, Métamorphoses de la Question Sociale.
BARREL : le non-sens de l’inactivité pollue le sens de l’activité. La politique sociale est une politique d’activités de simulation.
Au 17ème s. (âge classique, métaphysique, pensée rationaliste, décroissance de la pensée théologique) : l’urbanisation se développe encore, l’ordre marchand se développe. Mise au travail de la population, crainte de comportements asociaux d’une population oisive. Le non sens de l’inactivité équivaudrait au non sens du travail.
CF. FOUCAULT, la valeur travail (pas au sens marxiste) conscientisation éthique de cette valeur travail.
Émergence d’un triple mouvement interventionniste :
|
Police |
Organisation et essor, équivalent civil de la religion, avec en arrière plan la cité parfaite, idéale.
|
Politique de la religion |
Mouvement hygiéniste, mise en ordre de la ville. Cf. FOUCAULT : grands rassemblement des pauvres, maisons d’internement.
Passage d’une société d’ordre organique, théologique à une société d’ordre mécanique, marchande
|
Exigence morale |
La misère n’est plus le reflet d’une faute. La société s’arroge un pouvoir éthique de partage (manufactures de Colbert : les 1ers ouvriers étaient les errants que l’on raflait sur les routes).
Contrôler l’ordre social devient une dominante. Le déterminisme religieux de la pauvreté est contesté. Le pauvre est considéré comme une menace de l’ordre public. (Cf. Arlette FARGE : le goût de l’archive, vivre dans la rue au 18ème s. au travers des minutes des postes de police de l’époque).
Les politiques municipales se mettent en place :
Fin 16ème, début 17ème émergence des institutions laïques (1531 : aumône générale de Lyon, 1544 : grand bureau des pauvres de paris) ; L’objectif est de faire disparaître la mendicité, et d’organiser les secours. A dates et lieux fixes les secours sont distribués. Ratio minima mis en place afin d’inciter les pauvres au travail. Sélection : il faut faire la preuve qu’on ne peut pas travailler et qu’on est dans la cité. Marquage des pauvres : croix rouge et jaune en tissu (pour Paris).Les enfants des pauvres doivent faire la preuve qu’ils sont en apprentissage. Commissaires de paroisse qui tiennent le registre des inscrits. Les contrôles municipaux sont renforcés par des ordonnances nationales.
Une difficulté ; ségrégation entre deux types de distinction : les ayants droits et les autres – catégorisation.
Les pauvres sont rassemblés en un lieu pour les assister à moindre frais, les contrôler, les éduquer. Les mendiants sont emprisonnés. Il faut cacher la pauvreté cause et symptôme du vice (Saint Vincent de Paul).
18ème siècle (siècle de la morale, des lumières, de la justice sociale, du progrès, laïc)
La pauvreté apparaît comme les conséquences de l’État fiscal, économique et social. Les vagabonds, les prostitués, les pauvres ….représentent un disfonctionnement de la société. Ils sont victimes de lois mal combinées (l’Esprit des Lois). La société est responsable et comptable si elle tolère l’oisiveté, le parasitisme (Voltaire, Montesquieu). Chacun doit trouver sa fonction dans le corps social organique (à l’inverse de l’unité d’ordre divin) ;
La bienfaisance nationale doit rendre les hommes utiles et heureux. Le bonheur est dans le travail.
Multiplication des dépôts de charité, ateliers de charité, de mise au travail, d’apprentissage.
La jeune république révolutionnaire au nom des logiques égalitaires se reconnaît responsable d’un revenu minimum garanti.
Principe de droits et devoirs (ROBESPIERRE, Déclaration des devoirs des citoyens).
L’État a le devoir de protection et d’ordre et de santé publique (création d’hôpitaux, de dispensaires, extension de l’assistance médicale) ; un deuxième grand devoir de l’État est l’éducation, comme grand remède à la pauvreté – instruction – prise en charge également des enfants à problème – multiplication des établissements – école obligatoire.
Débats droits - devoirs- réciprocité ; Siècle de la morale ; le pauvre est vu comme responsable. Il faut aider le pauvre, lui apprendre à gérer son budget, modérer ses appétits, repousser ses vices, respecter le savoir, sa femme → dames patronnesses du 19ème siècle.
Première guerre mondiale
Les invalides et les mutilés de guerre nécessitent une prise en charge sociale ; Émergent les 1ères lois sur le handicap.
La pauvreté apparaît comme un accident de l’histoire, une anomalie explicable, qui arrive par des causes qu’il est possible de palier. La pauvreté est objectivée, dissociée, elle revêt un statut d’extériorité par rapport à la figure du pauvre ; elle s’individualise, se médiatise. Un dispositif de traitement est mis en place par l’État ; Elle est monétarisée par un système d’aide, de compensation, d’indemnisation.
Le traitement de la pauvreté est du ressort de l’État. Les institutions spécialisées appliquent. Les individus deviennent bénéficiaires de droits.
Le système actuel est le reflet de ces différents héritages
Au 18ème : prendre an compte les problèmes de la misère au niveau d’une réglementation nationale.
Au 19ème : promouvoir une éducation à la vie familiale, sociale, sexuelle.
Au 17ème : distinguer les pauvres conjoncturels et les pauvres de complaisance ; réinsérer dans le social par le travail (courant des années 90 de l’insertion par l’économique) ; assistance, bienfaisance, quadrillage, maillage (cf. E. THOMAS), forme de contrôle social et comme au 19ème , rationaliser les aides, coordonner les actions, prévenir les troubles, assurer l’ordre (politiques sociales,- rôle et fonction – cf. BARREL : simulation d’activité).
L’Action Sociale n’est pas le seul mode de réponse à la pauvreté, à l’exclusion. Il y en a 7 :
le Fatum : le destin, il n’y a rien à faire, c’est comme ça. La reproduction, approche ethnologique, la loi du plus fort, ordre naturel.
e clientélisme : (sociétés les plus libérales) dépendance à un plus fort que soi (paternalisme, corons…)
l’électoralisme :(système américain) les minorités peuvent faire alliance avec un parti pour obtenir des avantages (promesse de voix électorales contre avantages).
l’assistance : institutions spécialisées - du patronage aux politiques sociales.
l’assurance : grandes sociétés mutualistes, éviter la perpétuation de l’assistance- plus de responsabilisation individuelle – prévoyance, anticipation du risque (révolution française : épargne populaire – 19ème : fonds de secours des syndicats contre les revers du sort, 1838 : usines Schneider au Creusot).
l’action sociale : la pauvreté est vue comme un accidentelle, les risques étant inégalement répartis – logique de compensation, de redistribution.
la solidarité : qui procède d’une logique que les pauvres doivent cesser d’être objets, qu’ils s’auto éduquent pour devenir acteurs.
Dans le système actuel, le pauvre incarne des valeurs de représentation, d’images contraire à la modernité ; de repli sur soi – d’enclos social (chômage de longue durée)- absence de représentation du temps, de projet d’anticipation ; tout cela s’oppose à la maîtrise, la mobilité.
Le pauvre subit, il incarne l’antithèse du mouvement, de la mobilité, de la circulation. Il ne peut circuler d’un espace à un autre, ce qui entraîne la réduction de toutes les mobilités - La Modernité étant la possibilité d’être multiple, à la fois nomade et sédentaire ( ?)
![]()
[1]
ecclésia
[eklezja]
nom féminin
(mot grec)
Antiq. Assemblée des
citoyens jouissant de leurs droits politiques dans les cités grecques et
notamment à Athènes.
[1]