Note de HENRY Stéphane et Martine Gatineau Cours Ph. Semenowicz le 20/01/05
Économie 2
Plan de cet enseignement
Rappel du plan
I. Les transformations du marché du travail depuis ces 40 dernières années
L'augmentation du chômage
Les transformations de la population active
Les transformations de l'emploi
II. Les deux principaux cadres théoriques de l'économie du marché du travail
La théorie néoclassique
La théorie keynésienne
III. Les politiques mises en œuvre depuis une trentaine d'années
Les mesures générales en faveur de l'emploi
Des politiques macroéconomiques aux actions directes sur le marché du travail
Les mesures d'inspiration néoclassiques
Les mesures d'inspiration keynésiennes
![]()
Les transformations de l'emploi
Tertiairisation de l'emploi
Les ¾ des emplois sont maintenant dans le secteur tertiaire. Cela change la vision du travail, ce n'est plus l'industrie mais les emplois lié au service qui dominent.
Le statut des emplois
L'emploi salarié s'est développé depuis le 19 ème siècle avec l'industrialisation 9 emplois sur 10 sont des emplois salariés. L'emploi indépendant régresse.
Pendant les trente glorieuses, le salariait est caractérisé par une sécurité matérielle (CDI à temps plein, mise en place du SMIC, création de la sécurité sociale)
Dans les années 70, avec les premier choc puis le second en 1974, on assiste à une rupture dans le travail tel que l'on avait connu. Cela se manifeste par une fragilisation du salariat provoqué par le développement des formes particulière d'emploi (F.P.E).
Les FPE regroupe :
ü des emplois atypiques (Intérim, CDD, emplois aidés, apprentissage et stages rémunérés )
ü des emplois CDI à temps partiels (CDI à temps partiels et CDD représente 16,5 % des actifs occupés majoritairement par des femmes)
Actuellement, le CDI reste encore majoritaire puisqu'il représente 4 emplois sur 5. Le CDD dans le secteur privé, mais aussi dans le public s'est considérablement développé.
Si l'on fait le total des emplois atypique, il représente 13,2% en 2003 de l'emploi salarié, et en progression constante depuis les années 1980.
27,5 % des personnes à temps partiel souhaiteraient travailler plus. Pour un certain nombre de ces salariés, le temps partiel n'est pas choisi mais subi.
Evolution de la structure sociologie professionnelle des emplois
Sur des statistiques, on constate qu'il y a déclin des emplois non qualifiés qui se fait au profit d'une autre catégorie, le personnel de service direct aux entreprises et particuliers. Malgré la transformation de l'emploi non qualifié, nous constatons que l'offre de ce type d'emploi reste constante.
II. Les deux principaux cadres théoriques de l'économie du marché du travail
La théorie néoclassique
La théorie keynésienne
L'économie st née à la fin du 18 ème siècle/ début 19 ème avec notamment Adam Smith [1] qui a écrit en 1776 "La richesse des Nations". En substance, le message est celui-ci "Chacun en poursuivant son propre intérêt contribue à l'intérêt collectif.
Avant l'économie classique, il existait les mercantilistes[2], et les physiocrates[3], premières formes d'économie.
La théorie néoclassique
A la fin du 19 ème siècle, apparaît le néoclassique [4] . Pour les classiques, le marché est le mode d'organisation naturel de l'économie. Les néoclassiques ont la volonté de faire promouvoir l'économie à une véritable science, en s'inspirant du modèle des sciences de la nature (mathématique) . L. Walras et A. Marshall. Ont été les premiers a apporté le raisonnement mathématique en économie.
Parmi les contemporains ont peut citer : G. Becker[5], Nash[6], Friedman[7], G. Lucas.
Pour les néoclassiques, le marché du Travail est un marché comme les autres où le travail doit être considéré comme une marchandise.
Un marché est un lieu où se rencontre l'offre de travail et la demande de travail.
L'offre de travail, c'est l'homme qui offre sa force de travail et la demande provient de l'entreprise qui sont en demande de main-d'œuvre.
Le chômage, c'est une offre de travail supérieure à la demande des employeurs.
Sur le marché du travail, c'est du salaire que va dépendre l'offre et la demande.
Si l'offre de travail est supérieure à la demande, le salaire doit être bas.
Si la demande est supérieure à la demande du travail le salaire doit être élevé.
Quand le salaire est élevé, les employeurs ne veulent pas embaucher.
Quand le salaire est bas, la demande des entreprises est élevée, mais le salarié ne veut pas travailler.
Le salaire d'équilibre est une situation ou il ' n'y a pas de chômage.
La situation normale du marché est que par un phénomène d'autorégulation, il ne peut y avoir de chômage, ni pénurie de main d'œuvre.
|
Salaire |
|
Salaire d'équilibre |
|
Offre de travail |
|
Demande de Travail
|
|
Pénurie de main d'oeuvre |
|
Pénurie de travail |
|
Schéma néoclassique en économie
|
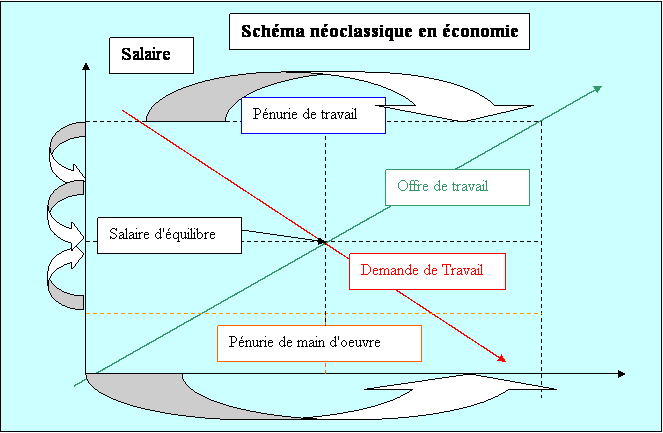
Critiques au schéma néoclassique
1. Le marché du travail n'est pas aussi flexible dans la réalité. Le droit du travail, les conventions, etc qui protège le salariat ne permet au marché du travail de s'autoréguler. Les économistes libéraux tentent alors de rapprocher la réalité du modèle théorique (MEDEF).
2. Il existe un salaire minimum. Les libéraux préconisent la suppression du SMIC. Cependant en raison du caractère impopulaire de cette mesure, ils tentent de faire baisser le coût du travail en proposant des allègements de charges sociales aux entreprises.
![]()
[1] Smith (Adam), économiste britannique (Kirkcaldy, Écosse, 1723 - Édimbourg 1790). Auteur des Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations (1776), il pense que la recherche par les hommes de leur intérêt personnel mène à la réalisation de l'intérêt général : il prône donc la liberté. Il approfondit la notion de valeur en distinguant valeur d'usage et valeur d'échange.
[2]
mercantilisme
nom masculin
1.
Litt. État d'esprit
mercantile.
2.
Hist. Doctrine économique
élaborée au XVIe et au XVIIe
s. à la suite de la
découverte, en Amérique, des mines d'or et d'argent, selon laquelle les
métaux précieux constituent la richesse essentielle des États, et qui
préconise une politique protectionniste.
[3]
physiocratie
nom féminin
(grec phusis, nature,
et kratos, pouvoir)
Au XVIIIe
s., doctrine de certains
économistes qui, avec Quesnay, considéraient la terre et l'agriculture comme
les sources essentielles de la richesse.
[4]
néoclassique
adjectif
Qui appartient au
néoclassicisme.
–
École néoclassique
:
courant de pensée qui, à la fin du XIXe
s., renouvela l'analyse
économique, notamment celle de la valeur. (Elle fut représentée notamment
par L. Walras et A.
Marshall.)
[5] Becker (Gary Stanley), économiste américain (Pottsville, Pennsylvanie, 1930). Il a contribué à un profond renouvellement de la science économique en étendant l'analyse économique à l'étude des relations et des comportements humains. (Prix Nobel 1992.)
[6] Nash (John), architecte et urbaniste britannique (Londres ? 1752 - île de Wight 1835), représentant du néoclassicisme et d'un éclectisme « pittoresque ».
[7] Friedman (Milton), économiste américain (New York 1912), promoteur d'un libéralisme tempéré par le contrôle de l'État sur la monnaie. (Prix Nobel 1976.) [7]