Synthèse de Notes de HENRY Stéphane et Martine Gatineau le 03/02/05
Modèles d'interprétation 5
Rappel du Plan de cet enseignement
Introduction
I. Le positivisme (A comte) vient des disciplines machinistes et physiques
II. Le fonctionnalisme (E.Durkheim) positivisme transformé
III. Modèles issus de la théorie marxiste (P.Bourdieu)
IV. La sociologie compréhensive (Max Weber) : comprendre subjectivement l'individu
V. Le structuralisme (Lévi Strauss) c'est la linguistique qui construit le structuralisme
VI. L'individualisme méthodologique (R.Boudon) ≠ opposé à Bourdieu sur la question de l'échec scolaire (Pour Bourdieu l'échec scolaire est déterminé par la catégorie sociale, alors que Boudon il s'explique par les choix familiaux.
VII. Les théories de l'acteur (Crozier)
VIII. Le courant pragmatique
IX. L'éthno-méthodologique et l'interactionnisme symbolique (Irwin Gofman – Ecole de Chicago)
Retour sur les structures élémentaires de la parenté
Dans "Les structures élémentaires de la parenté", il observe les formes de familles dans toutes les sociétés et il montre qu'il y a une structure de famille sous-jacente, commune a toutes les familles quelques soient la société dont elles sont issues et quelque soit le moment dans l'histoire.
La structure commune à la famille :
|
« L’union plus ou moins durable et socialement approuvée d’un homme et d’une femme et de leurs [vivant avec ses pas forcément] enfants, est un phénomène universel présent dans toutes les sociétés. » Il existe toujours un rite qui marque une reconnaissance, une approbation pour et par la société de cette union. | |
|
Une mère célibataire échappe à cette définition structurale mais, elle est considérée comme une famille sociologiquement à la différence du couple sans enfants. Certains se sont opposés au P.A.C.S. comme Irène Thery au nom de l’anthropologie notamment pour les couples homosexuels. L'anthropologie n'est pas fixée, elle est soumise à évolution en raison des changements qui interviennent dans la société. | |
|
L’hypothèse structurale explique que les formes (signifiants) changent mais, que le fondement (signifié) reste. | |
|
Les trois éléments sont culturels, c’est une construction sociale dans le but de la survie de la société. |
|
La division sexuelle des rôles dans toutes les sociétés il y a des taches attribuées aux hommes et d'autres aux femmes, qui ne sont pas forcément, selon les sociétés semblables entre elles, mais elles sont toujours structurellement divisé sexuellement, avec une complémentarité des rôles culturels. Donc cela n'est pas naturel, la société a besoin pour sa survie que hommes et femmes soient complémentaires, et c'est donc pour cela qu'ils se mettent en couple et font des enfants. Dans les représentations, et donc dans l'anthropologie, il y a dans la vision de tout hommes et femmes, une division sexuelle des rôles bien déterminée. |
|
dans toutes les sociétés interdit de l'inceste. Dans certaines sociétés, l'union entre cousins d'une même famille est autorisée sous certaines conditions. On distingue les cousins parallèles et les cousins croisés. |
|
Madame X |
|
Monsieur Y |
|
Madame Z
|
|
Monsieur Y |
|
Ils sont frères |
|
Fille |
|
Garçon |
|
Union impossible car cousins parallèles
|
|
Madame Y |
|
Monsieur X |
|
Madame X |
|
Monsieur Z |
|
Garçon |
|
Fille |
|
Union possible car cousins croisés |
|
Ils sont frère et soeur |
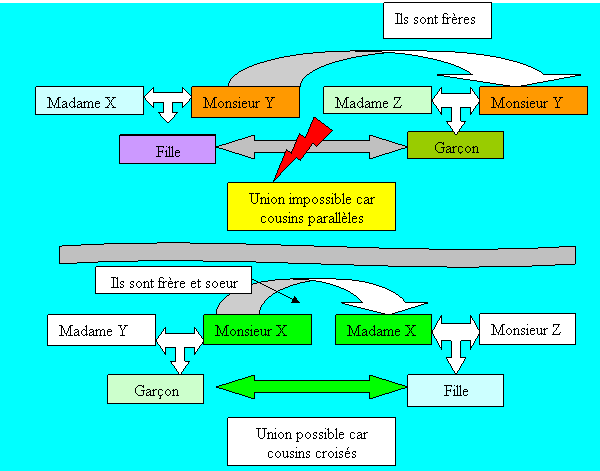
Les cousins parallèles ne peuvent pas être ensembles. Ils sont issus de deux couples lorsqu'il y a deux sœurs ou deux frères d'une même famille dans les deux couples
Les cousins croisés peuvent être ensemble. Ils sont issus de deux couples lorsqu'il y a frère et sœur dans les deux couples.
Dans le 1er cas, on estime que les cousins sont trop proches pour permettre une union (le cousin ou la cousine est interdite d'union avec son cousin germain parallèle) Il y a là des éléments de l'interdit de l'inceste
Dans le second cas l'union est possible.
Les cousins croisés sont considérés comme plus éloignés que les cousins parallèles alors qu’ils sont semblables biologiquement. La famille est une construction sociale à partir du biologique avec une manipulation symbolique.
VI. L'individualisme méthodologique (R.Boudon) ≠ opposé à Bourdieu sur la question de l'échec scolaire (Pour Bourdieu l'échec scolaire est déterminé par la catégorie sociale, alors que Boudon l’explique par les choix familiaux.
Dans les modèles des années 80 /90 plusieurs courants théoriques sont en débat entre eux
|
|
Système |
Action |
|
Intégration |
Sociologie des organisations Crozier |
Individualisme méthodologique R. Boudon |
|
Conflit |
A. Bourdieu |
Sociologie de l'action Touraine
|
Au XXème siècle, le concept dominant est celui de l’Acteur possédant une certaine maîtrise de son destin.
Pierre Bourdieu préfère parler d’Agent car les agents sont agis.
R Boudon[1] a écrit : Liste des ouvrages principaux
ü L’inégalité des chances : la mobilité sociale dans les sociétés industrielles, Paris, Armand Colin, 1973, 236 p.; nouvelle édition Hachette, collection Pluriel, 2002.,
ü Effets pervers et ordre social, Paris, Presses Universitaires de France, 1977, 2e édition 1979, 286 p,
ü La Logique du social, Paris, Hachette, 1979, nouvelle édition Hachette, collection Pluriel, 2002, 333 p.
ü Dictionnaire critique de la sociologie, (avec F. Bourricaud), Paris, Presses Universitaires de France, 1982, 651 p
ü La place du désordre. Critique des théories du changement social, Paris, Presses Universitaires de France, 1984, 245 p
ü L’idéologie, ou l’origine des idées reçues. Paris, Fayard, 1986. 3e éd. Paris, Seuil/Points, 1992.
ü L’art de se persuader des idées fausses et douteuses , Paris, Fayard, 1990 ; 2e éd.Paris, Seuil/points, 1992.
ü Le Juste et le vrai : études sur l’objectivité des valeurs et de la connaissance, Paris, Fayard, 1995.
ü Le Sens des valeurs, PUF, Quadrige, 1999.
ü Déclin de la morale ? Déclin des valeurs ?, Paris, PUF et Québec, Nota Bene, distr. Gallimard, 2002.
R Boudon dit que chaque individu choisit rationnellement son comportement, et la conduite de sa vie en fonction des différents contextes qu'il rencontre dans la société. "L'individu est un agent intentionnel doté d’une autonomie variable en fonction du contexte dans lequel il se trouve" " Cette proposition ne signifie pas que l’agent social soit libre au sens ou il pourrait suivre son bon plaisir. Lorsqu’il est confronté à un choix, les options qui lui sont ouvertes peuvent être entièrement ou partiellement soustraites à son contrôle "
.
L'addition de ces choix n'est pas tout fait neutre et la société est un peu plus que la seule somme des choix individuels. Il théorise sur les effets pervers : ce sont des effets de société non voulu non désirés par personne et qui sont le résultat de la somme des comportements individuels : Exemple en Région Parisienne pour le plus vite de son domicile à son travail il faut prendre sa voiture, si tout le monde fait le même choix = embouteillages etc, donc effet pervers. Pour limiter ce trafic débordant il y a les feux rouges qui est un autre effet pervers.
L'inégalité des chances : L'idée de Boudon c'est que chaque famille calcule les avantages et les inconvénients du coût de la scolarité pour leurs enfants. Boudon dit que les familles en fonction d'un certain nombre de paramètres choisissent une stratégie de scolarité, sauf que tout le monde dit aujourd'hui qu'il faut que les enfants fassent des études longues pour avoir un métier, et donc il y a un effet pervers : à profession égale le niveau de formation ne cesse d’augmenter donc une meilleure formation ne débouche pas forcément sur une élévation sociale (ex. : le métier de professeur des écoles ou anciennement instituteur). Cela accroît le niveau de l'éducation mais n'accroît pas le niveau professionnel. " Dans "L'inégalité des chances", en 1973, R. Boudon critique l'approche holiste, notamment celle de Bourdieu ; pour lui, l'inégalité des chances n'est pas le produit d'un déterminisme des rapports sociaux de domination, mais le résultat complexe de l'interaction de ces rapports, de l'habitus, des stratégies individuelles au terme d'une démarche rationnelle. Les faits d'ensemble résultent de l'agrégation de multiples décisions individuelles, les acteurs cherchent à rentabiliser au mieux leur investissement scolaire."
L'effet pervers d'une loi : prenons l'exemple de l'API, les femmes ne sont pas incitées à rechercher du travail, vivent parfois avec un compagnon et rompt ainsi l'isolement qu'elle devrait observer, refont parfois un enfant pour continuer à percevoir l'API.
Boudon est profondément libéral, à la différence de Bourdieu qui est d’inspiration marxiste et qui croit au déterminisme social.
Ni Bourdieu ni Boudon n'ont la vérité, mais chacun a une part de vérité
Dans le juste et le vrai (lire aussi article du monde sur les croyances collectives), il travaille sur comment les idées fausses se répandent, on a des idées mais fausses, tout le monde a une représentation fausse et pour passer de la question de la représentation et à leur diffusion collective (des idées fausses), il se sert des sciences cognitives.
![]()
[1] Boudon (Raymond), sociologue français (Paris 1934). Après une tentative méthodologique (l'Analyse mathématique des faits sociaux, 1967), il préconise une analyse des notions sociologiques, située entre la description et l'explication ( la Logique du social, 1979 ; l'Idéologie, 1986).