


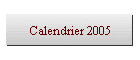


Les politiques sociales - Cours du 1er décembre 2005
(D’après les notes d’Annick et de Sylviane, synthèse et ajout internet de Martine et Stéphane)
Acte II de la décentralisation : Le Département
A- Compétences du département :
On peut voir le département sous l'angle de thématique enfance/famille, insertion, handicap/personnes âgées mais aussi sous l'angle des missions l'autonomie, insertion, famille/enfance.
2 schémas possibles :
1- : famille, enfant ; handicap ; personnes âgées ; insertion ;
2- : ou vu sous l’angle de 3 missions : autonomie ; insertion ; l’enfance et la famille.
Le département a récupéré les éléments du 11 fév. 03 par rapport à l’égalité des chances : rapprochement personnes âgées et handicap sous l’appellation autonomie.
I- Autonomie
Le département est chargé d’observer le territoire afin de planifier l’offre de service. On peut citer : l’accueil familial d’adulte ; le tarif horaire du service d’aide à domicile ; le prix de journée des établissements, agrément pour les établissements adultes ; le financement de la part hébergement et aide à l’autonomie.
Sur le terrain, il évalue les situations individuelles et organise l’information et la distribution de celles-ci pour l’accompagnement des personnes âgées et de celles en situation d’handicap. C’est un plan d’aide personnalisé.
Il est devenu :
L’instance de gérontologie départementale : schéma départemental gérontologique. [1]C’est un tableau de bord pour 5 ans avec financement. En 1986, loi particulière pour le schéma → changement politique → le décret d’application n’est jamais sorti.
LOI n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées [2]
La distribution de l’APA se fait en fonction de l’évaluation des besoins de la personne
PCH : Prestation Compensation du Handicap ; aide sociale à l’hébergement ; ACPP : Allocation Compensatrice Pour tierce Personne.
Les CLICG sont eux aussi départemental (Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique) ; maison départementale du handicap (guichet unique).
Il est nécessaire d’avoir une équipe médico-sociale pour suivre les questions d’autonomie.
Il y a de nombreux partenaires → voir ce qui est du ressort de la commune.
II- Enfance et Famille : observatoire social et départemental sur l’enfance et la famille.
Source de renseignement pour alimenter l’observatoire national.
Animer la mission prévention et protection de l’enfance (pb. de la PJJ) ; délivrer les agréments pour les Assistantes Maternelles ; ceux pour l’adoption et pour l’accueil ; fixe les prix de journée ; finance les prestations, les aides sociales et la prévention spécialisée.
Prévient et accompagne : l’accueil en urgence des enfants ; les mesures d’accompagnements des familles en lien avec l'ASE.
Outils :-schéma enfance/famille ;
-observatoire des enfants en danger ;
-allocations mensuelles de soutien à l’enfance ;
-prestations pour technicien de l’intervention sociale et familiale ou d’une aide-ménagère ;
-service ASE/PMI ;
-mesure de placements et AED/AEMO
III- Insertion
On parle de développement local et territorial. Définit des stratégies d’insertion pour tous et en particulier pour les jeunes de 16 à 25 ans.
Pour les 16-18-25 ans, prise en compte par les missions locales au niveau de la région. Pour les + de 25 ans, l’offre d’insertion est donnée par le département. Allocations financées par les CAF.
Le département a la charge d’organiser l’accueil, l’information, l’accompagnement des parcours d’insertion pour les + de 25 ans → contrat d’insertion.
Outils : - schéma : Programme Départemental d’Insertion→ Plan Local d’insertion→ Commission locale. Au-dessus du PDI, un conseil départemental. d’insertion fixe les orientations du dép. ;
- FSL : Fond Social de Logement ;
- FAJ : Fond d’Aide aux Jeunes ;
- CIRMA : Contrat d’Insertion du revenu Minimum d’Activité ;
- CA : Contrat d’Avenir ;
- CI : Contrat d’Insertion (bénéficiaire RMI)
- Prime de retour à l’emploi (risque d’être bientôt récupérée par le département).
Il semble qu'il n'y ait pas de politique décidée à long terme mais un ajout continuel de mesures pour faire face aux problèmes sociaux qui se posent (principe du mille-feuilles).
B- La commune
Il existe un parallélisme des formes entre le département et la commune, sans pour autant qu'elle en ait les moyens. La commune est la grande oubliée de la décentralisation.
I- Autonomie
Son rôle est d’analyser les besoins.
La commune élabore et planifie les transports et l’habitât : PDU (Plan de déplacement urbain).
Vie associative et bénévolat (charte de la vie associative qui n’a jamais vu le jour) :
-fragilisée par l’annualisation budgétaire. Les versements sont payés tardivement ;
-l’Etat peut changer les programmes. Les associations ne peuvent trop projeter dans l’avenir.
-Il y a peu d’évaluation de l’efficacité des associations. Dans le cadre de politique de la Ville, des associations sont créées par les opérateurs pour faire participer la pop. Mais, aux mains de prof. de la pol. de la ville car les associations sont créées par ces personnes. C’est aussi un lieu de pouvoir. Il faut se questionner sur le pilotage et l’utilité de chacune. Comme la commune est chargée de la vie associative et du bénévolat, on peut alors se poser la question de l'indépendance des associations.
Il existe de nouvelles formes associatives avec Internet, plus labile, sur une cause précise….
La commune présente des services : réseau de soins ; hébergement ; développement de services à la personne ; à domicile…Elle gère les transports collectifs, les plans de circulation et de déplacement (zone 30 km/heure) ; la mixité automobile/piétons (adaptation de l’environnement) ; plan local d’urbanisme (peut influencer la peuplement de la ville) ; PLH (plan local de l’habitat) ; s’implique dans le réseau de soins ville-hôpital…
Partenariat avec le CLICG : soutien à domicile.
II- Enfance et Famille
Diversification des modes de garde, animation et centres de loisirs. On équipe le territoire de structures d’accueil : crèches ; ludothèques ; halte-garderies….
Outils : relais assistantes maternelles ; CLSH ; Groupe scolaire maternel et primaire
III- Insertion
En insertion, la commune doit effectuer l'analyse des besoins, soutenir et développement de l’offre. Participation à la construction et à l’entretien des logements étudiants (qui permettent d’atteindre le seuil de 20 % de logement social).
Peuvent participer à l’instruction des dossiers RMI.
Outils : Missions locales ; CCAS ; PLIE (plan Locaux pour l’Insertion et l’Emploi).
La Politique Familiale
L’essentiel de la politique familiale est précisé en 1938. Le ministre Landry A. Landry et et l'économiste A Sauvy sont les véritables pères de la politique familiale. Ils ont mis en place la CAF et leur prélèvement par les salaires.
22.07.1939 : Code de la famille. Le modèle en est la famille stable : un couple avec plus de 3 enfants, père travaille, mère au foyer. L’idée est qu’il faut compenser les charges familiales : plus le nombre d’enfants augmentent, plus les prestations s’élèvent (compensations) en fonction du rang, de l’âge des enfants et du logement.
Deux autres éléments vont également influer ensuite : le revenu de la famille (Allocations sous conditions de ressources) et la composition familiale (personne isolée ; couple).
Le modèle familial s’impose comme la cellule de base de la société.
Les politiques familiales sont dans une logique keynésienne en permettant la consommation.
Historique :
Par le biais d’une loi de finance, déc. 1945, on institue le quotient familial (pour l’impôt sur le revenu). Les couples avec enfants sont favorisés. Les allocations sont indexées sur un salaire de référence (salaire horaire des métallurgistes parisiens).
Loi du 12-08-1946 : la branche famille va mobiliser jusqu’à 40 % des ressources de la SS.
En 1950, les dépenses de SS = 10% PIB (dont famille 40%).
En 2005, 30 % du PIB (dont famille plus que 9,9 %)
-Les allocations familiales sont versées pour le 2ème enfant sous conditions de ressources (familialiste et nataliste) ;
-l’allocation de salaire unique est versée dès le 1er enfant. Loi 72-8 du 03-01-1972 Elle est perçue par beaucoup de familles ;
- allocation prénatale ;
- allocation de maternité.
Tout est financé par une cotisation nationale uniforme sur tous les salaires (URSSAF).
En parallèle, les CAF deviennent autonomes.
-1er sept. 1948 : création de l’allocation logement. Elle est créée pour favoriser la libération des logements. La même année, les loyers sont libérés ce qui entraîne leur augmentation. Création d’une prime de déménagement. La mobilité et le baby-boom entraînent une augmentation de cette allocation.
-1955 : allocation de mère au foyer complète celle de l’allocation de salaire unique pour les non-salariées
-1963 : AES (Allocation d’Education Spéciale) pour compenser le coût d’un enfant mineur handicapé.
La branche famille va perdre sa prépondérance financière face à la montée en charge de l'assurance vieillesse et de l'assurance maladie. (Augmentation des besoins).
La politique familiale se recentre dans les années 70 pour des raisons différentes. La rupture provient de travaux d’une commission du plan présidé par P. Laroque. Cela donne naissance au plan Chaban Delmas/Delors. « Plus le pays s’enrichit, plus la pauvreté apparaît », rapport Laroque. Les politiques familiales ne peuvent pas éviter la distinction famille « socialement handicapée ». Le caractère social s'affirme et il est institué les prestations sous conditions de ressources : allocation de rentrée scolaire ; allocation pour frais de garde ; allocation de salaire unique pour mère au foyer (SURF)…
« Branche famille, le seul lien où il y a universalité »
-1977 : création de l’APL (Aide Personnalisée au Logement) inspirée du rapport Barre qui remplace l’aide à la pierre. Attribution sans « obligation » d’avoir des enfants.
D’autres systèmes se mettent en place pour tenir compte de l’évolution des mœurs.
1976 : API : reprise de l’allocation destinée aux orphelins.
Réforme de l’allocation maternité : - allocation post-natale et pré-natale ;
La priorité est donnée au troisième enfant. La chute de la natalité devient une préoccupation. Le complément familial se substitue au Supplément de revenu familial (SURF)
1981 : Forte valorisation des prestations familiales durant le septennat de Mitterrand. Auparavant, la politique familiale était surtout le terrain de la droite avec l’UNAF. Au PS, des gens réfléchissent pour relancer la politique familiale et la consommation (Ségolène Royale).
L’APJE (pré et postnatale) ; l’APE (Allocation parentale d’Education) ; en 1986, AGED (Allocation de Garde d’Enfant à Domicile)
1997, l’enfant au centre de la famille…d’après le rapport de Gisserot, il préconise l'idée de placer l'enfant au centre de la famille et propose de réécrire le code de la famille ainsi que la création de la Direction interministérielle à la famille.
Ce rapport est remis à Jospin, qui annonce que les allocations seront sous conditions de ressources.. N’ayant pas concerté les CAF et Assurances familiales (l’UNAF est un acteur majeur de la politique familiale constitutionnel), toutes les CAF votent contre. Dans le cadre des conférences aux familles, des propositions sont faites. Ces propositions font apparaître la remise en place du principe de l'universalité du versement des PF. La préférence est donnée au principe du quotient familial plafonné.
Une délégation interministérielle puis un ministère de la famille sont créés.
Rénovation des conditions d’accueil de la petite enfance : décret du 1er août 2000.
2001 : allocation de présence parentale. Permet de réduire son activité pour s’occuper d’un enfant malade.
2002 : Dans les dernières lois plus récentes, on introduit le congé paternité. L'évaluation de ce dispositif fait apparaître que ceux qui prennent ce congé sont les pères qui ont un salaire inférieur à 2000 €, peu pris par les cadres, plutôt pris dans le secteur public. Son but est d’aider la mère et mieux situer le rôle du conjoint. 2/3 des personnes concernées l’utilisent.
Réforme de la famille
Dans le cadre de la réforme du droit de la famille « L’enfant a le droit à la connaissance de ses origines » (ratification de la convention européenne) sous certaines conditions, certains éléments sont donnés. Création du Conseil national de l’accès aux origines personnelles.
La loi du 4 mars 2002 vise à renforcer :
|
le droit pour l'enfant à être élevé par ses deux parents, | |
|
la protection des mineurs, notamment des mineurs étrangers isolés. | |
|
La coparentalité | |
|
L'idée qui est développée, c'est garde partagée (l'évaluation fait apparaître que ce dispositif ne peut fonctionner qu'à certaines conditions (ressources suffisantes, domicile parentaux proches, bonne entente entre les parents) | |
|
|
Les dispositifs se complètent avec la PAJE en 2004 (Prestation d’Accueil du Jeune Enfant) qui se substitue à l’APJE, l’APE, l’AGED, l’AFEAMA, l’AA.
Elle se décline en :
1. prestations d'entretiens :
|
prime à la naissance et prestations de base versées sous conditions de ressources et jusqu'au 3 ans de l'enfant Les caf estiment que 70 % des ménages peuvent en bénéficier |
2. Prestations libre choix :
Ø d'activité (il faut pour cela avoir exercé une activité antérieure, intéresse le plus souvent les bas salaires, Dispositif qui a été modifié par la conférence de la famille en 2005. Le complément parental s’est élevé (750 euros) pour un an.
Ø ou de mode de garde (n'est pas soumis à des conditions de ressources, il dépend en réalité de l'âge de l'enfant, des ressources,
Loi du 27 juin 2005 : réforme du statut des assistantes maternelles.
Les pouvoirs publics interviennent de deux manières sur la politique familiale
Les conventions d'objectifs et de gestions signées par les CNAF pour 3 ans permettent aux caf de développer leur action sociale selon 4 axes (préventive familiale complémentaire, décentralisée. C’est une action familiale avec 10 millions d’allocataires (moins de la ½ sans enfants)
La famille
|
axée sur l'accueil des jeunes enfants (aide apportée aux établissements d'accueil des jeunes enfants essentiellement) L’accueil des jeunes enfants et la subvention de structures participent de l’image de la municipalité. |
|
loisirs et vacances (aide sous condition de ressources, aide pour partir en vacances à partir de projet | |
|
L’accompagnement des familles pour le logement et l’habitat : le département est maintenant l’interlocuteur. |
les conférences annuelles de la famille UNAF - Conférence de la famille (lien hypertexte internet) Plusieurs rapports ont découlé de ce type de conférences, dont celui relatif à la responsabilité des parents face à l'accès à Internet de leurs enfants. Ce rapport est suivi néanmoins d'effet car des FAI vont proposer à leurs clients un contrôle parental gratuit. Un autre travail fait par cette conférence est : comment concilier la vie professionnelle et vie privée pour améliorer la natalité ? Des mesures ont été imaginées à partir de thème : recréer une carte de famille nombreuse plus généraliste à partir du deuxième enfant. Cette proposition a été refusée.
Ce groupe s'est par contre égaré dans la politique familiale en relation logement. Cette instance ne peut pas maîtriser la politique des logements.
Néanmoins cette instance s'est penchée sur le départ des grands adolescents, les questions de séparation entre les parents qui ont la garde alternée de leurs enfants quand il y a des enfants.
Les politiques familiales sont orientées selon 3 axes :
le droit de la famille, la place de l'enfant dans la famille, l'indissolubilité du couple
permettre la conciliation de la vie professionnelle et vie familiale
soutien aux familles avec l'introduction complexe du soutien à la parentalité (voir un rapport "un avenir pour la paternité", d'Alain Bruel). Réaction de REAP (réseau d'appui à la parentalité).
La question qui se pose à la politique familiale c'est le financement. La politique familiale si elle est fiscalisée, risque de se dissoudre dans politiques sociales menées au niveau départemental.