


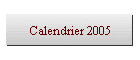


Les politiques de la ville
Notes de cours de Stéphane du 2 février 2006
Le logement
L'histoire du logement ne peut se comprendre que si l'on fait abstraction du contexte politique et social de la France au 19 éme. La France au 19 éme siècle a du retard par rapport à ces voisins anglais et allemands. Par conséquent le mouvement vers la ville, vers l'urbanisation va aller avec l'industrialisation, mais il est en retard. Au 19 éme siècle seul 10 % de la population vit dans les villes contre 80 % aujourd'hui. Il va y avoir un exode rural et un début d'industrialisation plus lent en France.
Le logement, à partir du moment où il est calé sur l'industrialisation apparaît comme un placement parmi d'autres. C'est à dire, qu'il y a un certain nombre de personnes qui place leur argent dans les manufactures et que d'autres placent dans le logement qu'ils vont construire pour les gens qui sont obligés de venir travailler à la ville.
La révolution française n'a jamais considéré le logement comme un droit fondamental. La question du logement n'est pas posée au 19 éme siècle. Par définition le logement social est dans une ambiguïté sociologique qui va marquer la politique du logement pendant une centaine d'année.
Les grands thèmes autour desquels vont se construire la politique sociale du logement, c'est l'hygiénisme, le paternalisme, l'ordre public et moral, c'est un devoir de solidarité et c'est une régulation des marchés immobiliers. Les affrontements sur le logement ne sont pas politiques. Jules Guesde et derrière lui tout l'internationalisme ouvrier repoussent dans un radicalisme l'idée de logement social. Le logement social c'est démobilisateur face à la révolution qu'il faut faire. Si les gens sont en train de travailler dans la perspective de payer un logement social, ils vont oublier que le véritable but, c'est de faire la révolution pour changer le système. Autrement dit, ceux qui sont en faveur du logement social sont des réformistes. Or le mot "réformiste" a été pendant de nombreuses années l'injure suprême dans le mouvement ouvrier français.
La politique du logement social [1]
1. Le temps du facultatif
Durant la deuxième moitié du 19 ème siècle, c'est le temps du facultatif.
la loi Melun : C'est un loi généreuse qui dit que les conseil municipaux vont désigné des commissions d'experts qui interdiront les logements insalubres. Cette loi étant facultative, seule la ville de Paris l'applique par l'intermédiaire d'Haussmann.
Sous initiative privée, ce sont ces industriels qui ont une vision paternaliste et mais également philanthropique.
C'est l'initiative privée qui va commencer à promouvoir des modèles : la dynastie Menier va fonder du logement social pour ses ouvriers, Schneider [2] au Creusot, Godin avec le Familistère sont les premiers à faire de l'habitat social collectif. A Paris c'est la cité Napoléon.
2. La loi Siegfried de 1894
Le 2 ème axe du facultatif, c'est la loi Siegfried. J de 1894. Siegfried est républicain. Il n'est pas forcément à Gauche, mais verse plutôt du coté des Solidaristes (Léon Bourgeois) , autrement dit il n'est pas avec les socialistes ni avec les anarchistes (anti-proprio). Ces derniers d'ailleurs à cette époque mène une campagne contre les propriétaires, contre M. Vautour [3], contre ceux qui viennent "sucer le sang des ouvriers". Ils refusent les loyers et il faut déménager les gens à la cloche de bois. Ils sont donc par définition contre une loi sur le logement. De l'autre coté, il y a les ultra-libéraux qui sont pour, car c'est une modalité de rendement prolifique. Siegfried, qui est entre ces deux courants, apparaît comme un réformiste, et, il imagine que la caisse de dépôt (organisme collecteur des livrets de d'épargne et a pour mission de prêter aux collectivités territoriales à des taux extrêmement bas) soit utilisée pour pouvoir financer de la construction d'habitation ouvrière. Il propose à cet effet un cahier des charges. Ce texte étant facultatif, il est bloqué à l'Assemblée.
Durant la seconde période de 1902 à 1933, le facultatif va laisser la place au réglementaire. D'abord, on fait aboutir des lois d'hygiène. En 1902, on va obliger au permis de construire villes à partir de 20.000 habitants. Ce permis de construire est obligatoirement assorti d'un règlement sur les WC.
En 1912 La loi Bonnevay donne la possibilité aux communes de créer des Offices Publics d'HBM. (Habitation à Bon Marché). La première guerre mondiale viendra perturber ce processus. Tout le dispositif qui était prévu pour lancer des HBM reposait sur la Caisse des Dépots. L'Allemagne devait payer, mais pas en totalité. La Caisse des dépôts a donc été mobilisée uniquement pour le financement de la reconstruction, et prioritairement pour les territoires du Nord et de l'Est de la France. Elle se poursuivra jusqu'en 1938…date à laquelle s'annonce la seconde guerre mondiale.
L'aspect positif de cette reconstruction, c'est que l'Etat a été obligé d'investir, d'organiser et de planifier.
En 1928 la loi Loucheur : Il prévoit la relance du logement par la construction de 260.000 logement en 5 ans, la plupart en accession à la propriété, les autres destinés à la location. Son idée est de construire 52.000 logements par an. Depuis 1920, les britanniques et les allemands construisent 250.000 logements chacun chaque année. L'effort français est dérisoire au regard de ce que font nos voisins et dérisoire également au regard des besoins. La France avait un retard au 19 ème siècle qui se poursuit encore au 20 ème siècle. Cette loi est votée en 1928, et un an plus tard, la bourse américaine explose avec le crack de 1929 qui atteint de plein fouet la France en 1932. L'argent qu'on espérait va servir à autre chose. Avec l'avènement d'Hitler à la chancellerie en 1933, les crédits de l'Etat sont tous reconvertis à la défense nationale.
Ces évènements n'ont donc pas permis de mettre en œuvre la totalité du projet. Des traces sont visibles, notamment à Paris, avec sa "ceinture rouge", construite sur les anciennes fortifications qui servaient à délimiter la ville de la banlieue (Loin du lieu). Les cités-Jardins se multiplient, à Prés St Gervais, à Drancy (la Muette).
Sous le régime de Vichy, des technocrates qui essaient de na pas tenir trop compte du politique, réfléchissent à l'aménagement du territoire après la guerre. Ils font des plans pour cette reconstruction de la France de l'après guerre, mais au lieu de confier ces plans au gouvernement de Vichy, ils les transmettent à de Gaulle exilé à Londres qui les approuvent. En 1944, De Gaulle créé un Ministre de la Reconstruction et de l'Urbanisme (MRU). Toute la politique qui va être lancée à partir de 1944, va être dans la continuité de ce qu'il s'est fait avant.
3. L'âge d'or des HLM
Les HLM est la nouvelle appellation qui remplace les HBM. Plusieurs éléments vont avoir une influence sur ce dispositif
a) La loi de 1948 : Cette loi prévoit libération des loyers mais qui maintient l'encadrement de ceux qui étaient antérieurs à la loi et qui n'étaient pas dotés du confort élémentaire. Les loyers concernés par cette loi étant bloqués, les propriétaires ne faisaient pas de travaux, les locataires étaient mécontents. D’où l'idée de libérer les loyers pour de nouvelles constructions. En même temps est crée une nouvelle allocation versée par les CAF, l'allocation au logement. Cette allocation sera une allocation à la pierre, favorisant ainsi la construction. Quelques années plus tard, cette allocation sera une aide versée à la personne.
b) Le plan Courant. Ce plan a permis la reconstruction du Havre, dont il fut Maire. Il a l'idée d'une politique d'ensemble. On va associer pour la première fois les architectes, les urbanistes et les ingénieurs des travaux publics. La pierre comme matériaux laisse la place au béton. Le Corbusier est la référence. De grands ensembles vont sortir de terre et les habitants sont satisfaits, car les logements leur offre un confort jusque là inconnu des français (eau chaude, salle de bains, chauffage collectif, etc..). Les habitants sont majoritairement des couples avec 3 ou 4 enfants (baby-boom) dont le mari travaille. Les femmes sont jeunes, ne travaillent pas. Ces logements sont dépourvus d'environnement et c'est progressivement qu'on va découvrir la nécessité d'un environnement. On s'aperçoit également que ces logements présentent deux autres défauts : l'isolation thermique et l'acoustique.
Ø l'isolation thermique : durant les premiers temps on chauffe largement au charbon. Et on s'aperçoit lors de la crise pétrolière que les charges augmentant que l'isolation fait défaut.
Ø L'isolation phonique : il y a du bruit, certes et tout le monde semble s'en accommoder jusqu'au jour où la télévision arrive dans les foyers avec sa multiplication de chaînes.
Ø Il faut aussi rendre ces ensembles à la circulation. L'accès à la voiture permet aussi l'accès à la consommation courante dans les nouvelles grandes surfaces commerciales qui sont crées. Pour pouvoir consommer, il faut aussi un réfrigérateur…
Durant cette époque on construira 550.000 logements par an. Un blocage va cependant apparaître :
Ø 1er changement : on avait construit sur l'idée de la reconstruction, du baby-boom, de l'urbanisation et des zones rurales et des changements des modes de vie. En 1962 c'est l'arrivée de 1 millions 200.000 pieds noirs à accueillir immédiatement.. Les modes de vie de cette population sont chaleureux, plus communicants ensemble, vivent dans le dehors, dans la cour. Ils sont accueillis dans les grands ensembles. Ils commencent donc à vivre comme ils vivaient eux même. Des problèmes de communication vont apparaître avec la population qui y réside depuis longtemps et qui avaient ces habitudes. Il y a un premier choc culturel qui va se poser. Les personnes qui vivaient dans ces immeubles n'avaient pas vocation à rester et avaient l'ambition d'accéder au pavillon de banlieue. Ils n'avaient qu'un objectif de passage et ces immeubles eux-mêmes avaient construits pour 30 ans. Après ils avaient pour vocation d'être démolis. La population pour laquelle ces immeubles avaient été construits est une population qui va partir, et qui va être remplacée par d'autres courants de population qui n'ont pas l'habitude de vivre dans ce type d'habitat, et vont s'y trouver bloquer.
Ø 2ème changement : ces immeubles qui étaient construits pour 30 ans se dégradent et que rien n'est fait pour les rénover. On ne veut pas augmenter les loyers parce que progressivement les catégories qui viennent loger dans ces ensembles ont moins de moyens.
Ø 3 ème changement : l'immigration. En 1974, l'immigration était une immigration profondément masculine ou les personnes étaient considérées comme des célibataires. Ils étaient dans des logements foyers. Ils repartent tous les deux ou trois ans au pays, parce que les employeurs leur permettent d'additionner leurs congés. En 1974, le gouvernement interdit par une circulaire le cumul des congés qui doivent être pris sur une période donnée. Le contrat peut-être rompu si les immigrés partent plus longtemps. Et ces derniers ne peuvent revenir que par le biais de l'OMI. C'est aussi à cette époque pour des raisons de "crise" économiques, qu'on bloque l'immigration. La France n'a plus besoin de main-d'œuvre étrangère d'autant que les premières générations du baby-boom sont sur le marché du travail. Les immigrés n'étant plus libres de partir et revenir vont faire massivement venir leur famille. L'immigration familiale va donc arriver dans les HLM, ou va se confronter brutalement avec la population "pieds noirs", alors que la guerre d'Algérie est encore dans tous les esprits. Des répartitions au sein des HLM vont commencer à s'effectuer par regroupement ethnique.
Ø 4 ème changement : la crise. La crise va jouer un rôle considérable. Tant les gens travaillent il y a de la circulation, de l'encadrement, du syndicalisme, du lien social qui fonctionne. Bon nombre de ces personnes vont se retrouver au chômage sans aucune perspective, bloqués sur place. Progressivement également on a l'affaiblissement des grandes institutions sociales. L'encadrement syndical et associatif se dissout et le lien social disparaît.
Ø 5 ème changement : les indicateurs sociaux. C'est en fait la rationalisation des choix budgétaires, ancêtre de l'actuelle LOLF (Loi Organique portant sur le Financement). C'est savoir si l'argent qui est utilisé pour répondre un certain nombre de besoins est bien employé. L'intention est louable. Le problème c'est lorsque l'on prend des indicateurs mathématiques et économiques pour les transformer en indicateurs sociaux. L'expérience va se généraliser à l'époque. A partir d'une conclusion d'expérience réalisée sur un groupe de rats dans lequel on introduisait progressivement des sujets étrangers, on a découvert que le seuil de tolérance d'acceptation de sujets étrangers était de 20 %. A partir de cette conclusion ramener à l'échelle humaine, les chercheurs ont dit que tout se passe bien dans les relations humaines sauf lorsque l'on introduit 20 % ou plus de personnes étrangères. Ces types d'expériences pouvaient servir d'indicateurs sociaux, y compris pour la mixité sociale.
Officiellement en France, il est hors de question de travailler sur l'origine ethnique ou religieuse. Même si nous savons pourquoi, c'est relativement ennuyeux car cela masque u certain nombre de situations. On sait bien que plus que l'origine, c'est la situation et les conditions sociales dans lesquelles se trouvent les personnes qui vont entraîner des difficultés. Il est vrai également qu'avoir ignoré la culture de l'autre a posé des problèmes entre les différentes populations. La mixité sociale est une véritable injonction, surtout pour ceux qui sont bloqués dans les grands ensembles. Elle est posée par les sociologues et les politiques comme une injonction sociale. La réalité est beaucoup plus complexe. La mixité sociale ne passe par l'habitat mais par le rétablissement d'un certain nombre de situations de socialisation, la première d'entre elle étant l'emploi.
Le premier levier de la politique de la ville est de récréer de l'emploi. A partir du moment où les personnes ont de l'emploi, ils redeviennent mobiles, et de nouveau des choix s'ouvrent aux populations, notamment celles qui sont coincées dans les dans les cités.
En 1974, R. Lenoir réfléchit sur tous ceux qui sont marginalisés appelés aussi à l'époque les inadaptés sociaux. Il dit que l'inadaptation sociale est multifactorielle. Il ne s'agit pas seulement de gens pauvres mais aussi des gens qui sont privés de l'accès à un certain nombre de droits. Avec Robert Lion, ils ont l'idée de travailler complètement sur le tissu urbain français. Leur réflexion les mènent à une idée qui mêle l'habitat et la vie sociale. Ils la proposent au secrétaire d'Etat, J. Barrault. Il est créé en 1977, le premier dispositif qui donne le coup d'envoi de ce qu'on appellera par la suite la politique de la ville, le HVS (Habitat et Vie Sociale). Dans le même temps 50 zones situées en périphéries sont définies, et ce sont celles qui deviendront des HVS où l'on va consacrée une politique d'habitat et de vie sociale.
On a enfin pris conscience qu'il fallait traiter l'ensemble des problèmes mais en même temps on a décider de créer le principe du zonage, dont on ne remet toujours pas.
R. Barre, ministre à cette époque, va nous faire passer de l'aide à la pierre à l'aide à la personne. Cela présente l'inconvénient pour les grands bailleurs d'être beaucoup moins solides dans le financement de leurs opérations. Au lieu de construire, ils réhabilitent. Il y a donc moins de logements créés et cela produit un retard gigantesque.
R. Barre confie la tache de faire un rapport sur les difficultés que rencontrent certains quartiers. Le rapport de Gabriel Oheix est rendu en 1981, sous le gouvernement Mitterrand, qui est en pleine expertise de la politique précédente…
Cependant, des éléments de ce rapport réapparaissent à travers le rapport Joseph WRESINSKI, (fondateur d'ATD Quart Monde) dans lequel il dit que la pauvreté présente un caractère multidimensionnel. On est pas pauvre parce qu'on pas d'argent, on est pauvre parce qu'on a pas de logement, de travail, pas de famille, pas d'éducation, parce qu'on a pas accès à la culture et les loisirs. Le bâti est insuffisant et ne réglera pas la question. Gabriel Oheix dit qu'il faut créer un revenu minimum pour tout le monde, qu'il faut des programmes locaux de développement social, introduisant par le concept de développement social. Cela veut dire, un territoire, une population, un débat avec la population, des objectifs qui sont fixés, des moyens qui sont mis à disposition, et la population qui est elle même actrice de son développement.
Tout va bien jusqu'à l'explosion aux Minguettes. La gauche ne comprend pas. Elle charge trois personnages de faire trois rapports :
1. Hubert Dubedout, ingénieur hydraulique, invente les GAM (groupe d'action municipale). Il invente un processus qui met véritablement sur pied la politique de la ville, le Développement Social des Quartiers (DSQ), et aussi la commission nationale pour les DSQ.
2. B. Schwartz avec son rapport est à l'origine de la création des missions locales, PAIO, a tout le dispositif jeune. Avec ces dispositifs se greffe immédiatement une initiative de l'Education Nationale la Zone d'Education Prioritaire.
3. Gilbert Bonnemaison, en 1982, inspiré par l'école de Chicago et l'action du Maire de New York, invente le Conseil National de Prévention De la Délinquance, ainsi que les Conseil Locaux de Prévention De la Délinquance qui deviendront plus tard les Conseils Communal de Prévention, ainsi que les contrat d'agglomération pour l'insertion des immigrés. Tout est en place pour la politique de la ville en 1983.
En 1983, l'association banlieue 89, est créée par deux architectes Castro et Cantal Dupart. Ils veulent rénover complètement le bâti et transformer le cadre de vie.
En 1984, un nouveau dispositif est rajouté et il est créé le Comité Interministériel des Villes (CIV). Il est proposé dans le cadre du Plan un dispositif appelé "les contrat de plans régionaux". L'état contracte avec les régions et dans ce cadre la politique des DSQ est renforcée. On passe de 16 à 148 DSQ.
En 1988, on va créer l'outil majeur de la politique de la ville, la Délégation Interministérielle à la Ville (DIV).
En 1989, on améliore le dispositif et on passe du DSQ au Développement Social Urbain (DSU). 400 en sont crées. Le Conseil National des Villes est crée (CNV). Les DSQ continuent à cohabiter.
En 1990, explosion de violence à Vaux en Velin. Mitterrand prononce le discours de Brou, et il crée un ministre de la ville, Michel Delbarre. Les dispositifs sont multipliés et sont crées des café-musique, les maisons de la Justice, toute une série d'associations intermédiaires. Le 31 mai 1990 loi Besson qui pose le principe du droit au logement.
En 1991, on demande au délégué interministériel à la ville M. Delarue de faire rapport dont le titre est " la relégation". La relégation est une peine de l'ancien temps. Lorsque les gens avaient été condamnés et avaient exécutés leur peine ils pensaient revenir là où ils vivaient avant. La mesure de relégation leur interdisait de revenir sur ce lieu. Il dit dans son rapport que ces gens n'ont choisi d'être là, on leur impose. Ils sont relégués, et on essaye de les reléguer le plus loin possible parce qu'on ne veut pas en entendre parler.
Ce rapport est repris par le ministère de la ville, qui demande à M. Aubry et Praderie de faire un rapport sur l'insertion par l'économie. Il faut donc relancer complètement l'économie dans les villes. Les villes n'ayant plus de tissu économique ne sont plus vraiment des villes. Cela donne naissance au Plan Locaux d'Insertion par l'Economique (PLIE). Tout cette émergence donnera naissance deux grands textes la LOV, la Loi d'Orientation de la Ville et la DSU la loi de Dotation de Solidarité Urbaine.
On se retrouve au moment où la majorité change avec un dispositif où la matrice de la politique de la ville, c'est le Le contrat de ville. Il y a 214 contrats de ville, 1300 DSQ et DSU et 12 grands projets urbains. La grande idée sera de faire un Pacte de Relance pour la Ville [4] (PRV) qui se décline selon trois axes : les ZUS Zone d'Urbanisation Sensible, les ZDRU les Zones de Redynamisation Urbaine, et les ZFU les Zones Franches Urbaines.
En 1995, on a le PRV mais en 1997, il y a des élections imprévues et la majorité change. Le premier Ministre L. Jospin n'a pas prévu dans la constitution de son gouvernement : la Ville.
On demande alors JP SUEUR de faire un rapport sur la politique de la ville.
Dans ce rapport, il fait 50 propositions :
Ø non au zonage,
Ø oui au rétablissement des qualités républicaines : c'est à dire, qu'il faut réinvestir tous ces quartiers avec des services et établissements publics
Ø il propose les contrats locaux de sécurité (CLS)
Ø propose de basculer sur l'échelle de l'agglomération en proposant le contrat d'agglomération.
La politique de la ville entre 2001 et 2006, a une matrice : le contrat de ville.
Le contrat de ville s'organise autour de 7 axes fondamentaux.
1. le développement économique, l'emploi et l'insertion. La structure sera le plan local pour l'insertion et l'emploi (PLIE)
2. c'est la prévention et la sécurité : la structure c'est le Contrat Local de Sécurité (CLS).
3. L'éducation et la formation. La structure c'est le Contrat Educatif Local (CEL). Depuis un nouveau dispositif a vu le jour : le Parcours de Réussite Educative.
4. la revalorisation de l'espace public, l'environnement et les transports : la structure c'est le Plan de déplacement Urbain (PDU). C'est obligatoire pour les villes de plus de 100.000 habitants. Son objectif est d'organiser le déplacement des biens des personnes et des marchandises. Réglementation sur la circulation, le stationnement, les zones 30 km/h, le transport pour les personnes à mobilité réduite.
5. l'habitat, le logement et l'équilibre des populations. La structure c'est le (PLH) Programme Local d'Habitat.
6. la santé et l'action en faveur des personnes précarisées : Cela renvoie à deux lois : loi du 29 juillet 1998 loi sur la lutte contre les exclusions et la oi sur la CMU, les dispositifs mis en place c'est les Programmes Régionaux pour l'Accès au Soins en faveur des publics démunis (PRAS) et Permanence d'Accès aux Soins de Santé (PASS).
7. le développent culturel et valorisation du patrimoine : la structure c'est la Convention de Développent Culturel (CDC). En réalité c'est l'intervention des Direction Rattachées aux Affaires Culturelles. (DRAC)
Deux éléments nouveaux :
En 2000, M. Gayssot et Besson, font une loi, la loi SRU Solidarité et Renouvellement Urbain. L'idée c'est d'introduire des nouvelles règles en matière d'urbanisme. Les Plans d'Occupation des Sols ont été transformés en Plan Locaux d'Urbanisme. Ce qui a été le plus retenu de la loi SRU, c'est l'habitat social qui impose aux villes ayant moins de 20 % de logements sociaux de rattraper leur retard en 20 ans. Si elles ne satisfont pas chaque année aux critères progressifs d'augmentation du parc public de logement social, elles sont priées de verser une contribution financière. Un certain nombre de commune préfère payer l'amende. Cette loi introduit la notion de logement décent, c'est à dire, qu'il ne sera plus possible de louer un logement indécent. Il y a deux critères pour qualifier un logement décent : pas de risque de porter atteinte à la sécurité physique et à la santé, et d'autre part, il faut qu'il soit doter des éléments qui le rende conforme à l'usage d'habitation.
Dans la loi SRU, une décision est prise en faveur des copropriétés en difficultés. C'est le cas de copropriétés qui se dégradent parce que les propriétaires ne peuvent plus faire face au paiement des charges. Il y a un certain nombre de mesures qui permettent les mises en demeure, les injonctions, des transformations et des interventions. Progressivement le propriétaire est privé de la jouissance de sa propriété.
Le 1er août 2003, la loi d'orientation et de programmation pour la ville, (loi Borloo). Le principe de la loi Borlo, c'est d'abord la rénovation urbaine, c'est à dire, une offre nouvelle de 200.000 nouveaux logement, la rénovation de 250.000 logements sociaux et la démolition de 250.000 logements. La difficulté est de loger les personnes pendant la reconstruction. Les communes environnantes ne sont pas favorables à l'accueil de ces populations. De plus les communes n'ont plus beaucoup de pouvoir sur le foncier. Actuellement nous sommes quand même plus dans la réhabilitation et la démolition que dans la construction.
La loi de rénovation urbaine s'est dotée de l'ANRU Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine : c'est un établissement public à caractère commercial, mais c'est surtout le point de passage obligé de tous les crédits et de tous les projets en matière de logement social.. Dès qu'une collectivité à un projet, il est soumis à l'ANRU. Si l'ANRU est favorable le projet sera financé, dans le cas contraire il ne le sera pas. L'ANRU s'est doté de moyens financiers très importants : 30 milliard d'euros.
En même temps il y a eu la procédure de rétablissement personnel qui ressemble à une vieille disposition en vigueur en Alsace Lorraine : la faillite personnelle. Les procédures de surendettement sont analysées depuis une quinzaine d'année en France. Ils se dégagent deux types de surendettement : actif (crédits pour rembourser les crédits) et passif (accident de la vie). On constate que surendettement passif est en train de devenir majoritaire parmi les dossiers qui sont étudiés. L'idée par rapport aux dispositions actuelles relatives à la loi Neiertz, on a ajouté cette mesure de rétablissement personnel. C'est un dispositif qui est dans l'esprit de la politique de la ville.
La politique de la ville est très compliquée, et elle est en permanence disqualifiée, parce que nous sommes jamais satisfait des ses résultats. La politique de la ville c'est probablement avec le RMI la politique qui a le plus contribuer à changer l'action publique et le travail social. C'est l'exemple même d'une politique qui est transversale (multifactorielle), globale (nécessité de se saisir de l'ensemble du phénomène), et participative. La politique de la ville est territoriale, c'est une politique des quartiers, des cités. Elle est en permanence à la recherche de son objet : est-ce que c'est l'Etat qui l'impulse ou bien les maires ? Est-ce que c'est une politique d'exceptions ou politique à visée pédagogique ?
Cette politique hésite toujours entre traitement des lieux et prise en compte des personnes alors que c'est bien des deux éléments dont il faut s'occuper. Le problème c'est tant que nous n'aurons pas réussi à rétablir de l'emploi, les difficultés résisteront.
![]()
[1] Cours trouvé sur internet sur le logement social de 1830 à 1960 en vidéo - par Annie FOURCAUT ENS Lettres et Sciences humaines - 16 et 23 novembre 2001
[2] Cliquez sur le lien "Patrons aménageurs d'espace"
[3] La genèse du logement social et Etats-providence européens
La première partie de l’histoire du logement social européen est marquée par la « peur des maladies » (« Fear of diseases »). Les premiers efforts sont animés par une logique de type « pastorienne » [2] : il s’agit de prévenir des maladies, ainsi que des maux sociaux, qui atteignent les milieux populaires. L’intervention en matière de logement constitue une réaction à la misère urbaine, engendrée par l’industrialisation et l’« urbanification » [3] des agglomérations. La crise du logement que connaissent les pays d’Europe au 19e siècle est le produit de deux phénomènes consécutifs à la première Révolution industrielle : l’accélération de la croissance démographique, l’exode rural. Le déclassement et la destruction des enceintes militaires des principales agglomérations à partir de la fin du 18e siècle permettent la mise en œuvre de vastes opérations d’urbanisme et offrent de grandes opportunités à la spéculation foncière. Les pouvoirs publics ne désirent pas contrôler l’extension des villes ni le marché de l’immobilier : c’est l’époque de l’Etat libéral où l’administration est rejetée hors de la sphère marchande ; il s’agit d’un Etat absent [4] dans le domaine du logement. Les nouvelles constructions sont le plus souvent de piètre qualité, le degré d’occupation des maisons est augmenté afin de rentabiliser les investissements. La figure populaire de « Monsieur Vautour », le propriétaire immobilier qui privilégie le gain financier aux conditions de vie de ses locataires, apparaît en France [5]. Le marché de l’immobilier ne progresse pas de manière linéaire : des crises de très grave ampleur sont constatées jusqu’en 1914 (la dramatique crise immobilière qui frappe Berlin en 1901 est un des plus célèbres exemples). Les conséquences des pratiques spéculatives sont avant tout sociales.
(Source :Extrait du Logement social et Etats-providence européens Romain Graëffly Centre d’Etudes et de Recherches de Science Administrative - CERSA / CNRS-UMR 7106)
[4] Voir le lien : Le Pacte de Relance pour la Ville - Revue Esprit mars 1996