


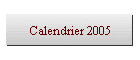


Le 16 mars 2006 Politiques sociales – la politique de l'emploi
Les lois Aubry - -La Réduction du Temps de Travail (voir aussi cours de Philippe . S - -ICI)
Notes de cours de Stéphane
En 1998, l'objectif des lois Aubry est de créer des emplois. Mais avant il faut définir quel va être le cadre de la loi. Il va y a voir des peurs entre le ministre et le patronat qui devient le MEDEF avec l’arrivée d’un nouveau président à sa tête. Les relations vont alors se durcir entre les adversaires. Le résultat c’est qu’il va y avoir deux lois, sans véritables négociations effectuées avec le patronat.
On ne pas poser une loi sur les 35 heures sans définir un cadre plus vaste, et notamment celui de l’annualisation du temps de travail. Il faut arriver à fixer un cadre ou l'on comprend combien de jours ont les salariés, sachant que certains salariés ont plus de jours que d'autres. On va essayer de déterminer à raison de 7 heures par jour ouvrable, combien y il a de jours ouvrables dans l'année. Après le calcul suivant où l'on retire les week-ends, un forfait de jours fériés, les congés annuels, on parvient au résultat de 1600 heures annuelles. C'est dorénavant la base légale du travail en France. Il faut que ce soit annualisé car certaines professions ont des périodes de l'année où ils travaillent plus et d'autres où ils travaillent moins. Il convient donc de pouvoir lisser cet ensemble sur l'année en n'ayant pas recours aux heures supplémentaires. C'est l'un des points sur lequel la loi va s'appuyer pour réguler le phénomène des heures supplémentaires. Si l'employeur peut librement avoir recours aux heures supplémentaires, cela aura pour conséquence une limitation de l'embauche. Or l'objectif de la loi c'est la partage du travail. On travaille moins pour embaucher plus !
Les contraintes
L'un des premières contraintes va être de définir réellement ceux qui doivent de passer aux 35 heures. Certains salariés ont des surprises au moment du passage des 35 heures, car avec le nouveau temps de calcul du temps du travail, ils étaient déjà proches ou faisaient moins des 1600 heures annuelles.
Le passage aux 35 heures équivaut à reconstruire totalement les modalités de travail. D'une part il va y avoir des gains de productivité et d'autres part dans un certain nombre d'emploi on fera en 35 heures ce l'on faisait avant en 39 heures, augmentant ainsi les charges de travail journalières. Sachant aussi que les gaines de productivité ne peuvent pas être atteints partout, le passage aux 35 heures se traduira par une modération sur les salaires. Certains salariés, ne demandant pas particulièrement une réduction du temps de travail mais souhaitant plutôt des augmentations de revenus ont parfois au perdu au change. Or le fait de passer aux 35 heures et de ne plus pouvoir faire des heures supplémentaires a produit un effet pervers au désavantage de certains salariés qui utilisaient les heures supplémentaires pour augmenter leurs revenus. Ce phénomène a touché plus particulièrement des catégories professionnelles déjà peu avantagées antérieurement à la loi. Curieusement cette loi qui doit fournir de l'emploi mais qui doit être aussi sociale s'est retournée contre une partie de la population. L'employeur qui souhaite avoir recours supplémentaires est lourdement taxé a tel point qu'il est préférable d'embaucher.
Un autre phénomène qui n'avait pas été prévu dans lors de l'élaboration de la loi qui s'est fait de manière relativement hâtive, c'est les incidences qu'elle a eu sur le SMIC.
Le SMIC est fait sur la base horaire. Par conséquent les salariés qui étaient payé sur la base du SMIC horaire de 39 heures ont pu constater pour certains avec la nouvelle base horaire du SMIC à 35 heures, une diminution de leur revenu. Pour tenter de contrer ce phénomène on imaginer des mécanismes de seuil. C'est à dire, que ceux qui étaient avant le passage des 35 heures sur un SMIC de base horaire 39 continueront à être payé 39 heures, alors même qu'ils font 35 heures. Concernant les nouvelles embauches, elles se font sur la base du SMIC horaire de 354 heures. Au sein d'une entreprise on voit alors se côtoyer deux catégories de salariés qui exécutent les mêmes taches mais à des salaires différents. Pour que les salariés SMIC 35 heures puisse récupérer la différence avec ceux du SMIC 39, on bloque les salaires de ceux qui possèdent le SMIC 39 au profit d'augmentations régulières pour les salariés au SMIC 35.
Les cadres
Le statut de cadre ne prévoit pas un volume horaire. Deux dispositifs sont crées : les cadres de direction et les cadres d'exécution. Les cadres de direction en raison des avantages substantiels et conséquents que leur procure l'activité de l'entreprise ne sont pas pris en compte.
Concernant les cadres d'exécution; il est difficile qu'ils puissent travailleur 35 heures par semaines. On crée alors pour cette catégorie des jours de congés supplémentaires. Après calcul, on obtient le résultat de 21 journées de RTT. Cependant pour un grand nombre d'entre eux, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas toujours la possibilité de prendre les 21 R.TT. C'est pourquoi il a été créé le Compte Epargne Temps (CET). Il prévoit plusieurs dispositions qui prévoient la prise effective des quelques jours de congés, la rémunération des jours, la capitalisation en vue d'un départ à la retraiter, un crédit formation, ect…
L'utilisation des RTT
Chez les cadres, les plus anciens n'éprouvent pas le besoin de prendre des jours RTT, contrairement aux jeunes cadres qui eux savent comment utiliser ces jours.
58 % du secteur privé est passé aux 35 heures. Le monde agricole et le secteur libéral ne sont pas passés aux 35 heures. Cela équivaudrait pour ces professions à une diminution nette de leurs revenus.
Parmi ceux qui bénéficient des 35 heures, les femmes utilisent le temps disponible procuré par la réduction du temps de travail pour du temps familial tandis que les hommes l'utilisent pour 80 % du temps plutôt personnel.
Le temps libéré profite surtout pour ceux qui ont des moyens financiers
Les effets de la loi sur les institutions à caractère social
Un certain nombre d'institutions sont financés pour majeure partie de leur budget par des fonds publics. Le passage aux 35 heures s'est effectué sur la base du budget. Ils n'ont pas été relevés du fait de la RTT. La mise en œuvre du principe de cette loi qui prévoit d'embaucher des personnes est possible que si l'entreprise à des gains de productivité. En matière d'aide à la personne, les gains de productivité ne sont pas possibles. Cela a eu pour conséquence pour les institutions de revoir leur fonctionnement managérial. Ainsi, certaines institutions ont diminué leur temps de réunion, ont recruté des veilleurs de nuit en lieu et place des éducateurs a qui on confiait la tache de surveillance nocturne, etc…
Ce dispositif a surtout profité aux grandes entreprises et aux collectivités territoriales et publiques qui n'ont pas de difficultés particulières à passer aux 35 heures, mais a produit en contre partie des effets surprenants comme parfois la mise en place de pointeuses.
La RTT a été difficile à mettre en œuvre dans la fonction hospitalière. Pour répondre à l'absence de personnel en RTT, il faut un apport de 65.000 emplois supplémentaires. En dépit d'avoir budgéter les postes, il n'y avait pas les professionnels pour les occuper. Cela a entraîné une fermeture de lits et de certains étages.
Certains aussi qui étaient en raison de leur fonction ou statut, notamment les infirmières, déjà aux trente cinq heures demandaient à effectuer moins d'heures qu'avant les lois sur la RTT
Pour les médecins, notamment en hôpital, dans le cadre de la réduction du temps de travail, le volume horaire a été fixé à 48 heures. Certains médecins, et notamment parmi les plus anciens n'ont jamais eu l'habitude de comptabiliser ces heures et de récupérer.
Les jeunes médecins eux récupèrent très bien par rapport aux anciens. Ils remettent alors en cause ceux, les médecins plus anciens, qui avaient été habitué ou contraints à travailler de manière importante qui s'interroge alors sur le temps qu'ils passent dans leur travail.
Notre système divisé en trois cycles, l'apprentissage, le temps de travail et le temps de la retraite est relativement interrogeant. Il conviendrait peut être de fluidifier ces périodes. En France, il intéressant de voir que les carrières se jouent avant 25 ans. La place professionnelle que l'on va avoir dans sa vie professionnelle va être prédéterminée par les études que l'on peut faire avant l'âge de 25 ans.
Dans ce dispositif de la réduction du temps de travail, on n'a absolument pas vu le temps de l'entreprise dans le sens où il n'a pas été introduit le temps personnel des salariés (par exemple faire un enfant) et ainsi mettre en place au sein de l'entreprise une organisation managériale pour travailler différemment.
Le financement des lois Aubry
Les lois Aubry ont crées 350.000 emplois. Le coût a été de 10 milliards répartis entre l'aide accordée aux entreprises pour faciliter leur passage aux 35 heures et l'allègements de charges sociales accordées aux entreprises. Pour financer ce dispositif, on a fait contribuer la sécurité sociale en partant du raisonnement suivant :
Le chômage affecte le budget de la sécurité sociale en ce sens que très de peu cotisations sont prélevées et beaucoup de dépenses pour financer les minima sociaux. Chaque fois qu'un emploi est crée c'est une personne qui sera moins bénéficiaire de la sécurité sociale et qui fait rentrer des cotisations. On explique que 350.000 emplois apportent des cotisations supplémentaires à la sécurité sociale et par conséquent qu'elle aura des finances supplémentaires pour financer en partie le dispositif. Les taxes sur le tabac à destination de la sécurité sociale vont aussi contribuer au financement de la réduction du temps de travail.
Les effets de la loi sur la structure du chômage
Ces lois rigides présentent l'inconvénient de considérer le travail comme substituable, ce qui n'est plus vrai. C'était vrai quand il existait un grand secteur agricole et industriel, et un secteur de services réduit comparativement aujourd'hui à la situation inverse avec un secteur de service très important face aux secteurs industriels et bâtiments et agricole rétrécis Or dans le secteur des service, il y a un certain nombre de métiers qui demande des compétences qualifiées ou non qui ne sont pas à la portée de tous, comme peut l'être un emploi dans le secteur agricole et industriel. On découvre alors qu'une part non négligeable de la population à la recherche d'un emploi n'a pas les qualifications requises pour occuper un emploi dans le secteur des services. Cela renvoie à la structure du chômage.
Le taux de chômage est actuellement de 9,6 % en moyenne sur le plan national. En revanche si dans les zones franches ce taux grimpe à 40 % et touche principalement les jeunes. Ces derniers sur le marché du travail, s'ils ont un taux important de chômage et supérieur à la normale, c'est parce qu'ils ne sont pas qualifiés avant l'âge de 25 ans. Derrière ces lois on repris conscience de la différence entre un métier, un emploi et le salariat et redécouvert la question de l'importance de la qualification.
Les aménagements Fillon
A la demande du patronat, mais aussi des catégories de salariés en demande de leur augmentation de revenu à alléger le régime des heures supplémentaires. Il permet aux employeurs d'avoir recours aux heures supplémentaires sans que ces dernières soient surtaxées. Ces allègements ont été bien accueillis d'autant que les salaires avaient très peu augmentés, voire gelés depuis les lois Aubry
Bilan des lois Aubry
Les lois Aubry posent un problème stratégique à long terme. Dans une société de plus en plus fluide au niveau international, il faut nécessairement prendre en considération le volume de travail qui est effectué. Il ne suffit pas seulement de calculer le coût du travail. Même si nous avons de bonnes performances et une très grande productivité, un décalage va progressivement s'effectuer avec d'autres sociétés pour lesquelles la durée du travail est plus longue. Si la durée de travail est de 1600 heures par an alors que dans d'autres pays de même niveau technique, elle est de 1900 heures, en quelques années il risque de se produire un décrochage au niveau de la production des richesses. L'une des conséquences sur le plan de la consommation, c'est qu'il y a un risque de vivre à crédit si le train de vie n'est pas diminué.
Les salariés travaillent en moyenne 1650 heures. Ceux qui travaillent le plus ce sont les cadres de l'hôtellerie et de la fonction hospitalière avec 2290 heures. Ceux qui travaillent le moins sont les personnels de l'enseignement primaire avec 1340 heures. (Réf Insee premières février 2006.)
La systématisation de l'incitation à la prise ou la reprise d'un emploi
(3ème volet de la politique de l'emploi du gouvernement Jospin)
Cette systématisation passe un mécanisme de cumul. L'idée est de faire en sorte que les personnes désireuses de reprendre un emploi puissent cumuler une allocation et un salaire pendant une durée de quelques mois. Cela a aboutit à une loi votée le 23 février 2006, la loi de retour à l'emploi pour les bénéficiaires des minima sociaux. L'idée est de simplifier les mesures d'intéressement à la reprise d'emploi qui seront remplacées par une prime mensuelle forfaitaire. Cette loi est en cours de promulgation. Elle vise 3 minima sociaux RMI, ASS, API.
La loi des finances : la prime pour l'emploi (PPE)
La prime à l'emploi, c'est un impôt négatif. Elle vient en complément d'une alternance de périodes travaillées et de chômage. Cette prime est néanmoins plafonnée. L'inconvénient de ce système, c'est que désormais une partie de la rémunération du travail ne tient plus au travail qui est effectué mais a ce que l'opinion publique exprime comme devant être la rémunération du travail. Normalement un travail est rémunéré pour sa valeur. Le principe de la PPE est qu'on ajoute un complément parce que l'on considère que ce travail n'est pas assez rémunéré. Cela fait en sorte que le travail que l'on effectue et la rémunération que l'on obtient ne dépend plus uniquement du travail que l'on a effectué mais elle dépend aussi de ce que la société estime de la valeur de ce travail. Si on a une société généreuse, la PPE sera à la hauteur de cette générosité.
En 1998, la loi de lutte contre l'exclusion, il y avait le dispositif TRACE. Il s'agit d'un accompagnement et suivi des jeunes très défavorisé par rapport à l'emploi. Or les jeunes dont il s'agissait avaient plus besoin d'une insertion sociale en préalable à leur insertion professionnelle.
Le gouvernement Raffarin donne la priorité à l'emploi marchand. Il pense que qu'avec la croissance l'emploi marchand va fonctionner. Il a abandonné l'option de l'emploi non marchand. Le chômage redémarre.
La loi de modernisation remet partiellement en cause la loi Aubry. La loi de cohésion sociale de 2005 est calée sur la loi de la lutte contre l'exclusion avec les trois volets de …
Dans la loi cohésion sociale, on crée la maison de l'emploi ; on demande aux chômeurs de faire des actes positifs et répétés en matière d'insertion professionnelle.
Aujourd'hui dans le secteur marchand, il existe au CI-RMA confié aux départements. Le CI-RMA est réservé aux RMI, ASS, API et AAH. Il est peu utilisé. Le contrat d'avenir se substitue peu à peu au CI-RMA.
Le CIE (personne en difficulté) et le contrat jeune en entreprise (CDI pour les jeunes entre 16 et 22 ans).
Le CNE :
Il s'adresse aux entreprises de plus de 20 salariés. Il peut être conclu depuis le 4 août 2005. La période probatoire dure 2 ans. Le salarié au bout de deux ans peut voir son contrat transformé en CDI. 350.000 contrats ont été signés depuis sa création.
Le CPE :
Il s'adresse aux entreprises de plus de 20 salariés. Ils s'adressent à des jeunes de moins de 25 ans.
Le problème, c'est que le CPE a été glissé sur le volet "de l'égalités des chances". Or rien ne l'indique dans le texte du CPE. A l'origine le CPE était adressé aux jeunes des quartiers.
Le CIVIS : 3 volets :
|
1. accompagnement renforcé pour les jeunes en difficulté | |
|
2. création d'entreprise | |
|
3. humanitaire |
Le PACTE : recrutement de 20.000 fonctionnaires pendant 5 ans. Ce dispositif permet de pouvoir devenir fonctionnaire sans l'obligation de se présenter aux concours de l'administration.
La loi sur le développement des services à la personne 26/07/2005. Elle met des plateformes regroupant des structures de services à la personne, comme "Serena" "Personnia" et France-Domicile, à disposition et le chèque emploi service (CESU). L'objectif est de créer 500.000 emplois de service à la personne. Ces plateformes vont être relayées par les banques, compagnies d'assurances, et des mutuelles.
Création de l'ANCSEC (agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances)