


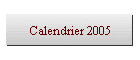


Le 9 mars 2006 Politiques sociales – la politique de l'emploi
La politique de l'emploi commence curieusement par le chômage.
1) le chômage et l'indemnisation
2) historique de 30 années de l'emploi
3) la formation continue
La population active
L'âge de qui est pris en compte pour dénombrer la population active débute au moment où l'obligation scolaire s'arrête, soit 16 ans et jusqu'à l'âge légal de la retraite, soit 60 ans. En réalité, il y a toute une génération à partir de 17 ans, qui n'est pas en train de travailler et qui n'est pas non plus demandeur d'emploi. Globalement la population estimée à 27 millions et demi.
Répartition de la population active selon les trois secteurs d'activités
|
Secteur Primaire (agriculture- agro-alimentaire)
|
Secteur Secondaire (industrie) |
Secteur tertiaire (services) |
Demandeurs d'emploi catégorie 1 (recherche de CDI et immédiatement disponible) |
|
900.000 agriculteurs |
|
|
|
|
2.500.000 au total |
6 millions |
18 millions |
2.350.000 |
Il y a moins d'un million d'agriculteurs en France. Aujourd'hui il y a plus de personnes qui travaillent dans le domaine de la santé que dans l'agriculture. C'est une révolution, en ce sens que la France a été pendant extrêmement longtemps un pays tourné vers la ruralité, et qu'il y a encore une trentaine d'année, 30 % de la population active travaillait dans l'agriculture. C'est un changement radical. Pourtant, la France est le premier pays exportateur en matière agricole.
Globalement, depuis ces trente dernières années, la création des emplois s'est effectuée dans le secteur tertiaire.
Le chômage pendant très longtemps a été jusqu'en dans les 1965, à un niveau extrêmement bas, puisqu'il était dénombré 200.000 chômeurs. La population active comptait 18 millions de personnes. C'est l'époque du plein emploi.
Le cap du premier million de chômeurs a été atteint en 1976. Puis 2 millions en 1983 et 3 millions en 1995.
Jusqu'en 1974, on crée 200.000 emplois de plus chaque année. Depuis 1974 et jusqu'en 1998, on crée 50.000 emplois de plus chaque année. En 2005, 152.000 emplois ont été crées.
Entre 1974 et 2005, chaque année la population active supplémentaire sur le marché du travail est de 140.000 personnes. C'est à dire, que chaque année, si l'on fait la différence entre ceux qui quittent l'emploi et ceux qui entrent, on trouve un solde positif de 140.000 personnes. On ne crée pas suffisamment d'emplois par rapport à la population active qui arrive.
L'augmentation de la population active, dans un premier temps, correspond à l'arrivée du baby-boom. Dans un second temps cette arrivée du baby-boom a été renforcée par le développement de l'activité féminine. Aujourd'hui les femmes en âge de travailler représentent 80 % contre moins de 50 % dans les années 1960. Les femmes ont néanmoins toujours travaillé, mais elles occupaient des emplois non salariés (la femme du boucher ou de l'agriculteur participait à l'activité de son mari) et n'apparaissaient donc pas dans les statistiques.
A l'inverse, le développement de l'activité féminine a été compensé par la baisse de l'activité des jeunes et des plus âgés. Pour les jeunes, il y a eu l'allongement de scolarité de 14 à 16 ans, et aussi le fiat que les jeunes restent globalement restent dans le système éducatif plus longtemps. Pour les plus âgés il y a eu des mesures favorisant leur départ à la retraite plus tôt. Cette combinaison a eu pour effet de faire baisser l'activité des hommes.
Le chômage est un phénomène inégalitaire et quatre inégalités sont à prendre en compte.
Le chômage est plus élevé chez les jeunes et les femmes.
On dit souvent qu'un quart des jeunes sont chômeurs. C'est surtout vrai pour les jeunes qui sont sur le marché du travail, car le nombre de jeunes qui sont sur le marché du travail est extrêmement faible. La plupart sont dans un système scolaire et de formation. Dans ce cas on ne peut pas dire, qu'un jeune sur quatre est au chômage. La formulation plus exacte serait de dire un jeune sur quatre de ceux qui sont effectivement en recherche d'emploi sont au chômage. Mais la majorité des jeunes ne sont pas encore en recherche d'emploi. Ainsi, quand on a précisé le rapport, on peut dire que le chômage chez les jeunes est supérieur à la moyenne.
Le chômage des femmes est toujours plus important que celui des hommes. Actuellement, le chômage est de 9,6 % pour l'ensemble de la population. Pour les femmes le pourcentage est de 11 % et chez les hommes, ce taux est d'environ 8 %.
Le diplôme
Le diplôme est une protection contre le chômage. Quand on fait la comparaison des personnes qui ont un diplôme de celles qui n'en possèdent pas, on constate que le diplôme, même s'il ne protège pas la personne contre les risque du chômage, constitue néanmoins, un frein contre celui-ci. Les personnes sans diplômes sont plus exposées au chômage. Ils représentent 15 % des personnes au chômage. A l'inverse le taux de chômage des BAC+2 est de 6 %.
La qualification
Les moins qualifiés sont les plus exposés. Le chômage des cadres et aux alentours de 4 % contre 12 % chez les ouvriers.
La disparité territoriale
En France pour l'ensemble de la population, le chômage est en moyenne de 9,6 %. Il existe des zones où le chômage est de moins de 5 % et des zones où le chômage, c'est plus de 20 %.
Notre moyenne de chômage en France toujours été supérieure à la moyenne de chômage à la moyenne européenne. Brutalement, on a traduit cela par : "il y a une préférence française pour le chômage".
Cela s'explique par le fait que les dispositifs visant à protéger ceux qui ont un emploi empêchent la mobilité de ceux qui n'ont pas d'emploi. En se protégeant eux même des risques du chômage, ils rendent plus difficile l'accès au travail à ceux qui sont en recherche d'un emploi.
La seconde explication réside dans le fait que la durée de l'indemnisation est beaucoup plus longue que dans les pays voisins. Cela a pour conséquence, que certains chômeurs peuvent se permettre de refuser un emploi qui ne correspond pas à ce qu'ils recherchent.
Pendant très longtemps, on a pensé que la crise serait passagère. On a donc pensé qu'il fallait soutenir l'emploi de ceux qui avaient déjà un emploi, et non pas favoriser forcément l'entrée dans l'emploi de ceux qui n'en avaient pas ou qui l'avait perdu. La représentation syndicale défendait elle aussi cette idée que de défendre ceux qui avaient un emploi. La législation allait elle aussi dans ce sens en prémunissant ceux qui avaient un emploi. C'est sous l'impulsion des associations de chômeurs que les syndicats ont commencé à prendre en compte les chômeurs.
Il y a une autre caractéristique a prendre en compte, c'est le que le chômage non rémunéré est plus important que dans les autres pays. Les personnes les plus exposées sont les travailleurs âgés. L'âge du travailleur âgé en France débute à 50 ans. Cela vient en totale contradiction avec l'amélioration et une espérance de vie qui s'allonge et une définition de l'âge du travailleur qui n'a cessé de raccourcir, d'autant que les capacités d'un homme de 60 ans aujourd'hui ne sont pas les mêmes que celles d'un homme de 60 ans au siècle dernier. On considère aujourd'hui qu'un chômeur de 55 ans et plus a très peu de chances de retrouver un emploi.
Il est aussi nécessaire de considérer d'autres situations intermédiaires qui se sont développés depuis ces dernières années en France, situées à la frontière de l'inactivité et de l'emploi, et qui visent notamment le travail à temps partiel contraint. Il concerne en France 1.400.000 personnes. Le travail à temps partiel contraint, ce sont des personnes qui voulaient travailler à temps plein mais qui n'ont pas pu en trouver.
Il existe aussi une catégorie de chômeurs qui sont dispensés de recherche d'emploi (DRE). A partir d'un certain âge on considère que les chômeurs n'ont plus besoin de rechercher un emploi. Il représente environ 450.000 personnes.
Il existe aussi des dispositifs qui permettent la cessation anticipée d'activité. Ces dispositifs sont en voie d'extinction. Ce dispositif concerne encore 100.000 personnes.
Les activités de formation professionnelle des demandeurs d'emploi font sortir temporairement le demandeur d'emploi des statistiques du chômage. Les statistiques, notamment en matière d'emploi permettent des comparaisons mais ne reflète pas la réalité. Si l'on comptait réellement les personnes demandeurs d'emploi exclues temporairement des statistiques, le nombre de chômeurs dépasserait les 3 millions. Dans les statistiques on cite seulement les demandeurs d'emplois de catégorie 1
Il s'agit des personnes qui travaillent, mais qui en même temps ont un temps réduit involontaire. Ces personnes sont payées à un pourcentage du SMIC.
Il est difficile de circonscrire avec précision le phénomène. Personne n'est véritablement outillé pour dire combien cela représenterait, bien que le chiffre de 10 % de la population active soit avancé. Il faut bien comprendre que toute société moderne ne peut fonctionner qu'avec du travail clandestin. Il contribue au lien social. Le problème est de savoir à quel moment le travail clandestin devient dangereux, a quel moment il devient intolérable.
C'est par un accord interprofessionnel du 31 décembre 1958 que se créé le régime conventionnel d'assurance et le régime de solidarité : l'UNEDIC. Cette instance gère le régime et verse les prestations par l'intermédiaire des ASSEDIC.
En 1945, lorsque l'on crée la sécurité sociale en France, il n'est pas tenu compte de l'emploi. A l'époque cela n'est pas un problème. On ne voit pas la nécessité de créer une caisse qui soit spécifique pour le chômage. Quand on verra progressivement monter un certain nombre de difficultés, c'est par le biais du paritarisme que sera créé l'UNEDIC. C'est un accord paritaire. Ce n'est pas une branche de la sécurité sociale, c'est un accord géré par les partenaires sociaux. L'ennui, dans ce type de régime, c'est que l'UNEDIC ne supporte pas le déficit et qu'il doit être équilibré.
L'assurance chômage et le régime de solidarité
L'assurance chômage
L'assurance chômage concerne par définition les salariés du privé et tous ceux qui sont rapportés au privé , soit environ 17 millions de personnes.
La réforme de 1992
En 1992, il est créé deux allocations, l'Allocation Unique Dégressive (AUD) et l'Allocation pour Chômeur Agé (ACA).
En 1998, la situation s'améliore, l'emploi reprend. A intervalle régulier, les partenaires doivent se retrouver pour signer la convention agréée par l'Etat. Cette convention sera principalement écrite sous l'égide de la CFDT qui dit qu'il faut aider les personnes à retourner à l'emploi. Pour cela il faut arrêter l'AUD et dans le même temps il faut inciter les chômeurs à se former et/ou à reprendre un emploi. La CFDT va obtenir une nouvelle convention qui va entrer en vigueur 1 er janvier 2001, relative au retour à l'emploi. L'Allocation de Retour à l'Emploi (ARE) va donc succéder à l'AUD. Le demandeur d'emploi reçu par l'ANPE va se voir proposer un Plan d'Aide de Retour à l'Emploi (PARE). Ce PARE est construit autour d'un Projet d'Action Personnalisé (PAP). Toute la question cela va être de déterminé la valeur de ce PARE et peut on ne pas signer ce PARE. Le débat entre les partenaires sociaux et syndicaux, amène la CGT à s'opposer au PARE alors que la CFDT le défend. Le PARE est finalement signé. L'idée était d'arrêter le versement de l'AUD, parce que comme le chômage diminuait, les fonds dont disposait l'UNEDIC augmentaient. Les fonds étant plus conséquents, on pouvait en terminer avec l'AUD, on donnait le même montant d'allocation aux chômeurs durant leur temps d'indemnisation, tout en les aidant, par des actions de formation à retrouver un emploi. Cependant en 2001, au moment même où l'avenant entre en vigueur, on constate que le chômage s'accroît de nouveau. Les comptes de l'UNEDIC plongent. Dans ses conditions, le PARE et l'ARE deviennent des dispositifs extrêmement chers. Comme les comptes de l'UNEDIC doivent être équilibrés, la plupart des partenaires sociaux vont se mettre d'accord pour un durcissement des conditions d'accès et le raccourcissement de la durée de l'indemnisation du versement de l'ARE. Cependant les partenaires sociaux ont effectué une erreur en ne différenciant pas ceux qui étaient déjà dans le système de ceux qui allaient y entrer. Devant les problèmes que cela posait, il a été décidé de repousser la mise en œuvre de cet avenant au 1er janvier 2004. Les personnes qui deviennent demandeurs d'emploi à cette date, voit logiquement s'appliquer les nouvelles conditions de d'accès et de versement. Ceux qui étaient entrés avant le 1er janvier 2004, se voient également imposés les nouvelles conditions. Autrement dit, ils sont "recalculés". Bien conseillés, ces "recalculés" vont déposer un recours auprès des tribunaux pour rupture abusive de contrat, le PARE étant un contrat. Les tribunaux donnent raison aux "recalculés" avec en plus des pénalités. L'avenant est immédiatement suspendu en mai 2004 et les recalculés sont réintégrés.
|
Au même moment, le régime de solidarité avait été modifié. L'ASS bénéficiait d'un régime plus dur en ce sens qu'elle était raccourcie dans le temps. Cela a entraîné un accroissement des demandeurs du RMI. De moins d'un million on est passé à un million 200.000. Ce n'est pas la seule raison. Cela s'explique à la fois par la fin d'un certain nombre de CDD et par le fait qu'on ait durci les conditions d'obtention de l'assurance chômage. Le RMI actuellement sert de 3ème filet d'indemnisation du chômage alors que ce dispositif n'était pas du tout prévu au départ pour cela.
|
Le régime de solidarité
Le régime de solidarité fonctionne avec l'Allocation de Solidarité Spécifique (ASS) et avec l'Allocation d'Insertion (AI) qui pour le moment sert aux demandeurs d'asile, rapatriés et sortants de prison. L'AI va être désormais refusée aux demandeurs d'asile, une autre allocation va être mise en place.
Le régime d'assurance chômage couvre a peu près les deux tiers des demandeurs d'emplois. Un tiers n'est pas indemnisé. . Le montant des prestations versées par l'UNEDIC est de 29 milliards. Le déficit de l'UNEDIC est de 13 milliards.
Un accord passé en 2005 entre les partenaires sociaux (sauf la CGT) vise à la réforme de l'UNEDIC. Les syndicats acceptent qu'il y ait une restriction d'entrée dans le dispositif et qu'il y ait un raccourcissement de la durée d'indemnisation de l'ARE. En échange le patronat va accepter qu'il y ait une augmentation de la cotisation chômage partagée entre les employeurs et les salariés. L'accord est en vigueur depuis le 1er janvier 2006 et a été agrée par l'Etat. Cet accord devrait équilibrer les comptes en 2006, l'UNEDIC pensant qu'il va y avoir une diminution de 130.000 chômeurs.
L'UNEDIC sait néanmoins que cela ne sera pas suffisant et prévoit de remettre réformer le système avant 2009.
Remarque sur le nombre de chômeurs
Les chiffres indiquent que nous avons 2 millions 300.000 chômeurs. Le décompte des chômeurs est fait de telle façon qui est toujours calculé à un instant T. Si nous calculions le nombre de chômeurs qui se sont inscrit au cours d'une année, nous n'aurions pas un stock mais un flux qui atteint près de 4 millions. Il y a des personnes qui sortent et qui entre du chômage au cours d'une même année et qui échappe eu décomptage fait par l'INSEE. Cela représente 1/5 personne qui est touchée par le chômage au cours d'une année
La population active est de 27 millions, dont 25 millions en activité. Mais toutes ces personnes ne sont pas égales devant le risque du chômage.
Le marché de l'emploi
Jusqu'en 1960, on craint en France une pénurie de main d'œuvre. On fait donc appel à la main-d'œuvre étrangère. Dans un premier temps il s'agit d'espagnols, italiens, portugais, puis dans un second temps aux ressortissants des pays d'outremers qui ne sont pas à l'époque encore indépendants : tunisiens, algériens, marocains. Cette population arrive à l'âge adulte et est considérée comme célibataire, alors qu'en réalité, on ne connaît rien de leur statut dans leur pays d'origine. Généralement ce sont des personnes mariées et pères de familles. C'est ultérieurement, quand on fermera ces arrivées, que l'on va voir se développer une immigration familiale.
En même temps, on sent qu'il y a un certain nombre de tensions qui se fondent sur le marché du travail puisque la population active augmente rapidement.
En 1963 on créé le Fond National de l'Emploi (FNE) destinée à restructurer l'industrie. En 1966 est créée l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), et en 1967 on crée l'ANPE. On se dote ainsi des différents outils qui vont permettre la structuration de l'emploi en France.
En 1974 – 1980 : Septennat de Giscardien
Il se subdivise en deux périodes. En 1974, alors que J. Chirac est premier ministre, on assiste à un ralentissement de la croissance et à la montée du chômage. Il va y avoir trois perceptions de ce phénomène :
1. Il faut protéger les salariés contre le licenciement (création de l'autorisation administrative avant le licenciement)
2. renforcement de l'indemnisation du chômage
3. aide aux entreprises
En 1976, J Chirac est remplacé par R. Barre. Il considère que le système ne fonctionne pas très bien et à partir de 1977 inaugure d'autres possibilités :
1) contenir la croissance de la population active : il utilise pour cela deux dispositifs qui sont la mise en préretraite et favoriser l'aide au retour dans leur pays d'origine des travailleurs étrangers. Ce dernier dispositif n'a pas fonctionné.
2) accompagner le redéploiement : aide à la reconversion des employés dont les métiers ont disparu ou vont disparaître et pour lesquels il n'est pas possible de transférer le savoir des personnes sur un nouveau métier (Exemple de l'arrosoir en zinc remplacé par l'arrosoir en plastique). Il faut accepter que des entreprises puissent fermer mais aider les gens à la reconversion vers de nouveaux métiers.
3) Faciliter l'insertion des jeunes : création des pactes pour l'emploi (PPE). C'est le début d'un ciblage d'une politique sur une population particulière.
De 1981 à 1986, du volontarisme à la rigueur
Durant la première période, il s'agit surtout de la relance de l'emploi suivie par une seconde période celle de la rigueur.
La relance de l'emploi
La relance de l'emploi s'effectue par la création d'emplois publics, par la baisse de l'horaire légal de travail à 39 heures, et par la généralisation de la 5 éme semaine de congés payés.
En avril 1983, une mesure importante est prise et concerne l'abaissement de l'âge de la retraite à 60 ans. C'est une mesure en faveur de l'emploi car elle permet de diminuer le nombre de travailleurs.
Invention du contrat solidarité préretraite. Cette mesure destinée aux employeurs les incite à libérer un poste occupé par un travailleur âgé avec son accord, pour embaucher un jeune. Elle permet à l'employeur de modifier sa pyramide des ages au sein de son entreprise, de pouvoir bénéficier un jeune travailleur plus performant, plus malléable, mais aussi de le payer moins cher. C'est un dispositif très favorable pour l'employeur.
Toujours dans la perspective de R. Barre, c'est à dire, un ciblage[1] sur l'insertion des jeunes, un certain nombre de mesures issues du rapport B. Schwartz sont prises.
Le temps de la rigueur
La politique de la relance keynésienne ne fonctionne pas, et plusieurs modifications vont avoir lieu. On abandonne les mesures contraignantes de réduction du temps de travail pour les entreprises. On va essayer de multiplier les publics cibles (femmes qui ont deux enfants et qui veulent reprendre un emploi, travailleurs âgés, etc…). Le risque de ce type de politique de ciblage est qu'il enferme les gens dans un certain nombre de statut dans lesquels s'active la stigmatisation.
La multiplication dans publics cibles va entraîner la multiplication des dispositifs. Sur l'insertion professionnelle des jeunes, on invente les Travaux d'utilité collective (TUC), Les contrats de qualifications, les contrats d'adaptation et les stages d'initiation à la vie professionnelle (SIVP).
Sur les chômeurs de longue durée des programmes sont faits aussi en leur faveur
De 1986 – 1992 : les politiques ciblées
En 1986 c'est la cohabitation avec un gouvernement Chirac. La première mesure qui est prise par le gouvernement Chirac, c'est de considérer qu'il y a un droit du travail trop contraignant et il va supprimer l'autorisation administrative de licenciement économique (Inventée par lui même quelques années plus tôt…)et va faciliter l'utilisation de contrat à durée déterminée.[2]
On va également utiliser le secteur non marchand avec en particulier la création des associations intermédiaires en 1987.
La cohabitation se termine en 1988 et la mesure importante qui est crée en faveur de l'emploi c'est le RMI. L'objectif du RMI est de réinsérer professionnellement des personnes qui sont dans le filet du RMI. C'est un dispositif transitoire provisoire de secours dans lequel certaines personnes peuvent passer entre 6 mois et deux ans dans une perspective professionnelle. Si ce dispositif a été voté à l'unanimité à l'assemblée nationale, c'est pour des raisons totalement différentes entre la Gauche et la Droite. Pour la Gauche, c'est une allocation alors que pour la Droite c'est une insertion à caractère professionnelle. Seul le rapporteur, J.M Belorgey indique qu'il s'agit d'une insertion sans préciser les caractéristiques de celle-ci.
L'idée qui se dessine, est qu'il faut favoriser l'emploi dans le secteur non marchand par des contrats spécifiques et en exonérant les charges sociales. Le débat qui s'est posé alors, dans une conjoncture où la mondialisation est de plus en plus prégnante, c'est : le travail en France coûte trop cher donc faut-il supprimer le SMIC ?
Le coût du travail est trop important, mais le travail c'est des cotisations et une rémunération. La rémunération est insuffisante donc on va agir sur les cotisations. Mais comment agir sur les cotisations sans abaisser la protection des travailleurs ? En exonérant de charges les employeurs et en les prenant en charge au titre de la solidarité nationale. Ces charges sont ciblées sur les jeunes, c'est l'exo jeune de Rocard en 1990. Dans cette même période est crée le Contrat Emploi Solidarité (CES) pour développer le secteur non marchand.
L'étape suivante en 1992, c'est le basculement systématique du coût du travail par l'allègement des cotisations patronales.
C'est aussi une période de cohabitation notamment avec le gouvernement Balladur. Son objectif c'est la baisse du coût du travail. On va alléger les cotisations patronales jusqu'à 1,2 fois le SMIC. L'effet pervers, c'est que cela bloque les demandes d'augmentation car l'employeur qui bénéficie d'exonération de charges sortirait du système de l'exonération et donc devrait s'acquitter des charges sociales. Cela explique aujourd'hui, le nombre important de personnes qui sont payées en référence au SMIC.
Balladur propose 1994,et fait également une loi quinquennale. Dans cette loi, il y a un assouplissement et une adaptation de la réglementation du marché du travail. Dans cet assouplissement il y a un dispositif qui s'appelle le contrat d'insertion professionnelle (CIP rebaptisé "smic jeunes"). Il s'agit d'un contrat payé à 80 % du SMIC pour les jeunes jusqu'à BAC+2 entrant sur le marché du travail. Il a été retiré sous la pression des manifestations.
L'autre idée est de décentraliser la formation professionnelle qui est confiée aux régions.
On poursuit également la baisse des charges patronales, et, on encourage le temps partiel en référence au modèle nordique. Dans une perspective d'emploi, on multiplie le nombre d'emploi.
G de Robien crée une loi qui encourage à la réduction du temps de travail (loi de Robien). C'est un dispositif défensif. Dans la situation d'une entreprise dont l'activité décroît, il est demandé aux salariés de diminuer leur temps de travail entraînant en partie une réduction de leur rémunération. L'Etat considérant que l'entreprise n'a pas licencié va contribuer en faveur de l'entreprise de telle manière que la baisse de l'activité, et donc des rémunérations, ne soit pas totalement répercutée sur les salaires des employés. Cette loi a été créée dans la perspective du maintien de l'emploi et contre la destruction de l'emploi. Cette loi se confond parfois avec des éléments des lois Aubry.
1997 – 2005 : dissolution de l'assemblée
Il y a un gouvernement de Gauche plurielle qui arrive au pouvoir, mais n'avait pas prévu d'y arriver aussi rapidement. Ils ont quelques lignes au programme mais insuffisamment travaillées. Ils ont à proposer deux programmes : les nouveaux emplois nouveaux services et la Réduction du temps de travail.
Les nouveaux emplois, nouveaux services : c'est 375.000 emplois potentiels. Ce sont des CDD de 5 ans, qui sont proposés par les collectivités territoriales ou des associations. Ce ne sont pas des contrats renouvelables. Au bout de 5 ans il faut qu'ils aient été rendus pérennes. Ces emplois ne sont pas attachés à la personne mais au poste. Ils sont payés à partir du SMIC. C'est l'Etat qui sous forme de subventions dégressive paient aux associations le salaire lié à cet emploi. Il ne s'agit pas d'emploi existant mais de nouveaux emplois. L'interrogation était de savoir si cela étaient véritablement de nouveaux emplois. Le bilan est contrasté. Du coté des personnes recrutés, à 80 % ils ont été satisfaits en ce sens que cela leur apporté une expérience professionnelle. Du coté des employeurs le constat est plus mitigé. Pour l'éducation Nationale, l'objectif n'était pas de pérennisé ces emplois. Pour rentrer à l'EN il faut passer les concours. L'EN pour fonctionner a besoin d'un "volant" de personnes immédiatement disponibles pour permettre des remplacements rapides de ses fonctionnaires en divers endroits sur le territoire. Dès lors que l'on titularise, les personnes ne sont plus déplaçables et donc il faut de nouveau créer ce type de personnel…
Il y a eu deux autres corps administratifs qui ont largement contribué au développement des "emplois jeunes" la police et la gendarmerie. Ces services ont rapidement compris qu'ils ne pouvaient pas mettre dans la rue ces emplois jeunes sans formation. L'expérience a été concluante car la quasi-totalité a été titularisée.
Les postes ont-elles aussi contribuer aux emplois jeunes et ce de deux manières. Tout d'abord elles ont essayé de créer un nouveau service d'aide et d'assistance en faveur de la clientèle (personnes âgées, ou toutes personnes rencontrant des difficultés à effectuer des opérations simples au sein de la poste). Puis elles ont mis aussi des emplois derrières les guichets.
Les associations ont-elles aussi abondamment utiliser ce dispositif, qui succédait à celui du service civil (les objecteurs de conscience) qui avait été supprimé en même temps que le service militaire. Ces personnes étaient souvent une manne pour les associations, car elles étaient généralement bien formées. Dans le secteur associatif bien souvent les "emplois jeunes" n'étaient pas de nouveaux emplois. Les taches pour lesquelles ils ont été recrutés étaient déjà déterminées. Progressivement ces personnels ont été recrutés sur de vrais emplois au sein du secteur associatif.
Dans les collectivités territoriales, les emplois jeunes ont été utilisés dans les secteurs culturels et sociaux. C'est par exemple le cas du "grand frère" médiateur dans les cités. Cependant la difficulté, c'est qu'est-ce que peuvent devenir ces personnes à l'issue du programme. Leur faire passer le concours administratif était illusoire dans la mesure où la plupart n'avait pas un niveau d'étude suffisant. De plus ce "nouveau métier" ne possédait pas réellement de fondement en terme de formation, ni même en terme de statut administratif…. Néanmoins, les collectivités territoriales ont pu les absorber ou les réaffecter sur des missions de service public réelles.
Le bilan global de ce dispositif sur la création de les nouveaux emplois et de nouveaux services est un leurre. Par contre elle a été une expérience professionnelle réelle et importante dans la durée pour beaucoup de jeunes. Cela a été une erreur fondamentale pour le nouveau gouvernement de ne pas avoir reproduit ce dispositif en le relançant peut-être d'une autre manière…
|
Secteur Marchand |
Secteur Non Marchand |
Formation en alternance |
||||||
|
Contra d'insertion revenu minimum d'activité (CI/RMA) |
Contrat d'Avenir (CA)
|
Contrat d'Apprentissage |
||||||
|
Contrat Initiative Emploi (CIE) |
Contrat d'Accompagnement dans l'emploi (CAE) |
Contrat de professionnalisation |
||||||
|
1Contrat Nouvelle Embauche (CNE)
|
|
Parcours d'accès aux carrières territoriales hospitalières de l'Etat (PACTE) |
||||||
|
Contrat Première Embauche (CPE) |
CIVIS : Contrat d'initiation à la Vie et l'Insertion Sociale Il comporte 3 volets :
|
|
||||||
|
Contrat d'Accès à l'Emploi : (réservé aux DOM) |
emplois tremplins |
|
||||||
|
CDD Seniors |
|
|